Article extrait du Plein droit n° 44, décembre 1999
« Asile(s) degré zéro »
De nouvelles procédures mais peu de bénéficiaires
Patrick Delouvin
responsable du service Réfugiés à Amnesty International Section Française (AISF)
Aujourd’hui, le système d’accueil des demandeurs d’asile qui arrivent sur le territoire français est en crise. L’accroissement de leur nombre n’en est pourtant pas la cause. Si les demandes enregistrées aux frontières extérieures ont fortement augmenté ces dernières années(1), il n’en est pas de même sur le territoire, malgré une poussée en 1999(2). Le dispositif « exceptionnel » mis en place en 1999, après quelques hésitations, pour accueillir 6 000 Kosovars, ne doit pas masquer les difficultés rencontrées par les demandeurs dans leurs démarches. La loi relative à « l’entrée et au séjour des étrangers en France et à l’asile », adoptée le 11 mai 1998, s’est révélée globalement décevante, notamment au regard de l’intention affichée par le Parti socialiste dans son projet pré-électoral d’avril 1997, « Pour une nouvelle politique de l’immigration et de l’intégration »(3). En présentant son projet de loi, le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement, avait affirmé sa volonté de contrebalancer l’application « restrictive » faite en France de la Convention de Genève de 1951 concernant les auteurs de persécutions. Mais l’asile constitutionnel et l’asile territorial institués par la loi n’ont constitué que des palliatifs(4). Très peu d’étrangers en ont bénéficié depuis l’entrée en vigueur de la loi. En outre, l’extension simultanée de la procédure dite « prioritaire » à une nouvelle catégorie de demandeurs ne s’est pas accompagnée d’une amélioration des procédures d’asile comme l’avait pourtant promis le ministre. La procédure s’allonge, dans plus de la moitié des cas les demandeurs continuent à recevoir un rejet sans avoir été entendus en première instance et seuls 10 % se voient reconnaître le statut de réfugié. Le grand nombre de rejets nous inquiète d’autant plus aujourd’hui que les préfets viennent d’être incités à augmenter les éloignements de manière « significative »(5).
La loi du 11 mai 1998 n’a pas fondamentalement changé le traitement des demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Le nombre de statuts accordés chaque année reste sensiblement le même pour les premières demandes : environ 5 % de reconnaissance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et 5 % par la Commission des recours(6).
Avant la loi du 11 mai 1998, les persécutions n’émanant pas des autorités publiques ou officielles du pays d’origine n’étaient admises, pour la reconnaissance du statut, que dans quelques cas limités : les situations où « les autorités publiques ont volontairement toléré ou encouragé les agissements », puis, plus récemment, les cas où toute demande de protection à ces autorités aurait été vaine.
Désormais, à l’application de la Convention de Genève s’ajoute la référence au préambule de la Constitution qui permet de reconnaître la qualité de réfugié à toute personne « persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ». Cet « asile
constitutionnel » est censé protéger les « combattants de la liberté » mais, pour la première année de son application, la Commission des recours n’aura attribué le statut de réfugié en l’invoquant qu’une seule fois. D’ailleurs, comme le reconnaît Jean-François Terral, directeur de l’OFPRA, « la grande majorité des combattants de la liberté sont également éligibles à la Convention de Genève ».
Nous avions craint, apparemment avec juste raison, le côté symbolique de cet ajout en raison des déclarations gouvernementales pendant les débats. Le ministre de l’intérieur avait en effet estimé que « les combattants de la liberté sont par définition en petit nombre […]. Il s’agira d’un flux minime ». Quant à Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères, il annonçait déjà que « la pratique suivie devra maintenir un juste équilibre avec la préoccupation de maîtrise des flux migratoires ».
L’asile territorial : un leurre ?
De même, si aujourd’hui un « véritable » asile territorial existe bien dans la loi, il restera de peu d’efficacité tant qu’il sera accordé au compte-gouttes. Les premières indications confirment en effet les craintes d’une application restrictive de ce dispositif (voir cas n° 1). Le ministère de l’intérieur a refusé de donner des informations chiffrées sur l’application de cette nouvelle mesure, les réservant pour le Parlement. Mais il semble que sur 5 000 demandes déposées la première année(7), moins de 10 % seulement aient été acceptées. Les heureux élus, Algériens pour la plupart, ne seraient ainsi pas plus nombreux que sous les dispositifs discrétionnaires précédents.
En effet, entre 1994 et 1998, 3 000 à 4 000 Algériens menacés « du fait des activités des groupes islamistes » se sont vu remettre un titre de séjour en application du télégramme du 22 décembre 1993. En France, l’asile « territorial » a ainsi longtemps résulté de textes du ministère de l’intérieur généralement non publiés (circulaires, télégrammes, instructions) afin de ne pas créer d’« effet d’appel ». Pour supprimer le caractère « totalement arbitraire et discrétionnaire » de ces dispositions dénoncé par le projet socialiste d’avril 1997, le gouvernement a agi en deux temps.
Dans un premier temps, il a voulu régler par circulaire les « situations inextricables » de certains étrangers se retrouvant « sans papiers » du fait des législations antérieures(8) et, parmi eux, de ceux qui couraient des « risques vitaux » en cas de retour dans leur pays. Sur 6 300 demandes fondées sur ce seul critère examinées au ministère de l’intérieur, environ 6 % seulement ont été acceptées, permettant l’accès au séjour d’environ 400 personnes(9).
Quatre associations(10) ont alors, en janvier 1999, alerté le Premier ministre, Lionel Jospin, sur le trop grand nombre de rejets au titre de ce critère en affirmant, dossiers à l’appui, que certains des recalés seraient en danger en cas de renvoi dans leur pays. Les contacts avec le cabinet du ministre de l’intérieur ont permis d’apprendre que la situation des personnes déboutées de leur demande d’asile n’avait pas été réexaminée sauf si elles avaient fait valoir un élément nouveau ou une persécution non étatique. Pour sa part, le Premier ministre n’a pas répondu malgré les relances.
Dans un deuxième temps, la loi du 11 mai 1998 a donné au ministre de l’intérieur le pouvoir d’accorder l’asile territorial à l’étranger dont « la vie ou la liberté est menacée dans son pays » ou qui y est « exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme »(11). Malheureusement, dès l’adoption du texte, le ministre a donné le ton en précisant qu’il s’agirait d’une « mesure humanitaire d’urgence […], d’application restreinte […], largement discrétionnaire […], pour des cas exceptionnels […], de portée limitée »(12).
La procédure n’est effectivement pas très attractive. Tout d’abord, pendant la période d’examen qui peut durer de nombreux mois, le demandeur ne bénéficie d’aucune possibilité d’hébergement ni d’aide sociale. Ensuite, l’amendement adopté à la demande du ministre selon lequel l’asile ne sera accordé que « dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays » fait craindre des décisions prises pour des raisons autres que la seule nécessité d’apporter une protection à une personne. Cette crainte n’est pas infondée si l’on sait que Jean-Pierre Chevènement a une vision très étendue de ces intérêts qu’il a en effet définis comme « politiques, diplomatiques, économiques, culturels, stratégiques ». En outre, l’absence de motivation des décisions de rejet et le caractère non suspensif des recours limitent de fait la possibilité de faire réviser une décision erronée ou mal fondée.
Recours en annulation
La situation des étrangers dont la demande de statut de réfugié a été préalablement rejetée est particulière. La loi du 11 mai 1998 donne en effet le pouvoir à l’OFPRA et à la Commission des recours de se prononcer sur l’opportunité d’accorder l’asile territorial lorsqu’ils estiment qu’un dossier ne relève pas du statut de réfugié.
En 1998, après l’entrée en vigueur de la loi, trente dossiers ont ainsi été recommandés par l’Office au ministre de l’intérieur. Toutefois, ce dernier n’est pas lié par cette saisine et peut rejeter la demande d’une personne alors même que ses craintes de persécution en cas de retour ont été jugées fondées (voir cas n° 2). En outre, des personnes éligibles à la protection du statut de réfugié sont parfois orientées abusivement vers la procédure d’asile territorial dont les droits sont bien moindres (voir cas n° 3). Enfin, le ministère risque de réserver un examen moins attentif aux dossiers qui ne lui auront pas été signalés. Le décret du 23 juin 1998 prévoit en effet une procédure d’urgence, notamment pour ces situations ; le demandeur peut alors être interpellé et placé en rétention pendant l’examen « en urgence » de son dossier.
La loi n’est déjà pas favorable aux demandeurs ; la circulaire du 25 juin 98 vient encore réduire leurs chances. Au point que France Terre d’Asile et Amnesty international ont intenté un recours en Conseil d’État pour en demander l’annulation. D’une part, ces associations considèrent illégale la disposition prévoyant que l’assistance des éventuels interprètes sera à la charge des étrangers.
D’autre part, elles estiment abusive la restriction de l’attribution de l’asile territorial aux seuls cas où « les menaces ou les risques émanent de personnes ou de groupes distincts des autorités publiques de ce pays ».
Cette restriction peut permettre au ministre de l’intérieur d’exclure systématiquement les ressortissants de pays comme l’Afghanistan, la République Démocratique du Congo, le Sri Lanka, la Turquie… s’ils invoquent des menaces des autorités de leur pays. Combien de ces ressortissants ont eu gain de cause depuis l’entrée en vigueur de la loi ? Toujours la crainte de l’« effet d’appel » ?
La loi du 11 mai 1998 a par ailleurs augmenté les cas de recours à la procédure « prioritaire » qui réduit les droits des demandeurs. Depuis 1993, cette procédure permet au préfet de refuser l’admission au séjour d’un demandeur en cas de menace grave pour l’ordre public, de fraude délibérée, de recours abusif ou de demande présentée uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement(13). La nouvelle catégorie concerne les ressortissants originaires des pays pour lesquels la « clause de cessation » de la Convention de Genève a été appliquée c’est-à-dire les pays dans lesquels les circonstances qui ont poussé des personnes à fuir ont cessé d’exister.
Cette décision est regrettable car les personnes concernées ne bénéficient pas de toutes les garanties de procédure : manque de temps pour en comprendre les subtilités et rassembler les documents nécessaires, examen des dossiers par l’OFPRA souvent trop rapide, sans entretien avec les intéressés, recours contre la décision de rejet perdant son caractère suspensif.
Le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale avait regretté « l’approche collective » de cette nouvelle mesure et souligné que « cette rédaction subordonne l’exercice de garanties à l’appartenance à une nationalité ». Or, le nombre de demandes traitées selon cette procédure s’est encore accru : 516 en 1994, 620 en 1995, 581 en 1996, 1 080 en 1997 et 2225 en 1998. Comme le ministre le recherchait, cette dernière augmentation concerne principalement les Roumains touchés par la modification apportée par la loi du 11 mai 98(14).
Promesses non tenues
Le ministre de l’intérieur avait annoncé que l’extension de la procédure prioritaire s’accompagnerait d’une amélioration des procédures d’asile et, notamment, de l’assurance d’un « entretien individualisé à l’OFPRA pour chaque demandeur ». Nous sommes loin des promesses. La durée de traitement des dossiers augmente et les moyens humains et financiers, pourtant déterminants, diminuent. En 1998, l’Office a en effet connu une forte érosion en personnel (dix départs) qui ne sera rattrapée que fin 1999 et aucun accroissement n’est prévu au budget de l’année 2000. Après l’augmentation des demandes d’asile constatée en 1999, l’OFPRA a dû « restocker » 4 600 dossiers en neuf mois. Ces restrictions ont des conséquences multiples.
Tout d’abord, aujourd’hui encore, plus de la moitié des demandeurs d’asile ne sont pas entendus pour expliquer personnellement et en détail les raisons qui les ont poussés à
quitter leur pays : les ressortissants de certains pays sont convoqués systématiquement, mais les personnes dont les dossiers sont considérés comme « ne contenant aucun élément substantiel » n’ont pratiquement aucune chance de se faire entendre. Dans ces cas, l’OFPRA se contente de l’examen du formulaire rempli par le demandeur au moment de son arrivée en France alors que celui-ci, par manque de conseils bien souvent, n’a pas su présenter correctement sa demande. Or, il est largement reconnu que seul le contact direct permet d’apprécier l’importance des menaces et des persécutions vécues par une personne. L’audition systématique avait d’ailleurs été recommandée par une mission d’audit de l’OFPRA.
Par ailleurs, les demandeurs qui sont hébergés dans des foyers(15) pendant la durée de leur procédure y demeurent plus longtemps. Depuis 1997, environ six cents places nouvelles ont bien été créées(16) mais cela ne suffit pas à couvrir la demande. Près de deux mille demandeurs sont à la porte, dans l’attente d’une place hypothétique, et il ne semble pas prévu d’accroître la capacité dans l’immédiat. Une récente circulaire rappelle que « l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés constitue une obligation découlant de la Convention de Genève » mais préfère recommander aux préfets de mettre en place localement « des solutions innovantes »(17). Enfin, le versement de l’allocation mensuelle aux demandeurs ne bénéficiant pas de cet hébergement s’interrompt rapidement. Cette allocation dite d’insertion a certes été portée de 1 300 à 1 700 francs en 1998 mais la durée de son versement est toujours limitée à une année. Plus la procédure traîne, plus le nombre des demandeurs qui se retrouvent complètement démunis est important.
Pour toutes ces raisons, la mise à plat de toute la politique d’asile en France est urgente. En novembre 1998, Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la solidarité, constatait que certaines difficultés étaient « liées à l’allongement des délais de procédures » et elle indiquait qu’un groupe de travail avait été mis en place pour « améliorer les délais d’instruction des demandes »(18). Notre association a demandé au gouvernement d’associer sans tarder à ces travaux le HCR, les experts et associations concernés afin de mener ensemble une évaluation rigoureuse et de discuter des améliorations à envisager. Espérons que ces lignes susciteront des réactions utiles permettant de lancer ces travaux afin que l’objectif affirmé par les chefs d’État et de gouvernements à Tampere en octobre n’en reste pas au stade de la pétition de principe : « notre objectif est une Union européenne ouverte et sûre, pleinement attachée au respect des obligations de la Convention de Genève et des autres instruments pertinents en matière de droits de l´homme, et capable de répondre aux besoins humanitaires sur la base de la solidarité ».
Cas n° 1 – Refus d’asile territorial à un Albanais du Kosovo
Cas n° 2 – Refus d’asile territorial à une Algérienne
Cas n° 3 – Orientation vers l’asile territorial d’un Tunisien
|
(1) 526 en 1996, 1010 en 1997, 2484 en 1998, environ 2500 pour les huit premiers mois de 1999. [Cette note ne traite pas de la situation de ces demandeurs].
(2) 61 422 en 1989, 54 813 en 1990, 47 380 en 1991, 28 872 en 1992, 26 507 en 1993, 25 964 en 1994, 20 415 en 1995, 17 405 en 1996, 21 416 en 1997, 22 375 en 1998, 21 589 pour les neuf premiers mois de 1999.
(3) Amnesty International, section française (AISF) qui avait adressé au ministre de l’intérieur, à plusieurs reprises, puis aux parlementaires, diverses recommandations d’amélioration concernant les dispositions relatives à l’asile, avait alors déploré qu’aucune d’entre elles n’ait été suivie.
(4) Le gouvernement et les parlementaires ont refusé de suivre le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) qui recommande que, conformément à l’esprit et à la lettre de la Convention de 1951, la qualité de réfugié puisse être reconnue même en cas de persécutions non étatiques.
(5) Circulaire du ministère de l’intérieur du 11/10/99.
(6) Les chiffres communiqués par l’OFPRA font apparaître un taux moyen de reconnaissance de 20% car ils comprennent notamment les décisions concernant les enfants de réfugiés lorsqu’ils atteignent leur majorité (voir Droit d’asile en France – Etat des lieux, juillet 1997, rédigé par AISF et FTDA, page 43).
(7) Pour cette première année d’application, nombreux auraient été des déboutés du droit d’asile, recalés ensuite de la procédure de régularisation exceptionnelle de 1997.
(8) La circulaire du ministre de l’intérieur du 24/6/97 a permis de régulariser 80 000 personnes sur 140 000 demandes.
(9) En produisant ces chiffres, le ministère de l’intérieur a précisé qu’il fallait ajouter 1200 personnes régularisées directement par les grandes préfectures sans pouvoir communiquer le nombre correspondant de demandes déposées.
(10) Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, Amnesty International Section Française, Association Primo Levi, France Terre d’Asile.
(11) La décision est prise après consultation du ministre des affaires étrangères, un document de séjour d’un an est remis, le renouvellement peut être refusé en cas de disparition des raisons qui l’avaient justifiée ou de menace pour l’ordre public.
(12) Assemblée nationale le 15/12/97.
(13) Cette procédure peut malheureusement être appliquée à un étranger contrôlé à proximité de la frontière, n’ayant pas encore eu le temps matériel de se rendre à la préfecture.
(14) La clause de cessation a été appliquée à leur pays en juin 1995.
(15) Il existe 63 centres d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) pour une capacité totale de 3744 places.
(16) En 1999, bonne nouvelle : ouverture à titre expérimental de la structure d’accueil attendue depuis longtemps réservée aux mineurs demandeurs d’asile non accompagnés.
(17) Circulaire du 15/7/99 du ministère de l’emploi et de la solidarité relative au dispositif national d’accueil.
(18) Discours devant la Commission nationale consultative des droits de l’homme du 19/11/98.

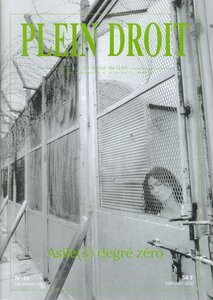
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?