|
|
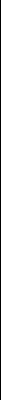
|
Rapport « Immigration,
emploi et chômage » du CERC
Pendant longtemps, aucune mesure de contrôle a priori
n'était effectuée sur l'entrée et le séjour [28] mais les autorités disposaient
d'un pouvoir discrétionnaire total en matière d'expulsion.
La procédure d'expulsion a commencé à être
très légèrement encadrée à partir
de la loi du 3 décembre 1849. Cette longue période
de liberté des flux migratoires va être suivie à
la fin du XIXe siècle des premières mesures de contrôle
exercée sur la population étrangère. Jusqu'à
la crise économique et politique des années 1880, le patronat
et les autorités sont restés favorables à l'immigration
et à la concurrence que les immigrés exerçaient
vis-à-vis des ouvriers plus anciennement installés. Le
patronat conservera ensuite cette position favorable à l'immigration [29].
Les grandes compagnies minières et métallurgiques cherchent
toutefois peu à peu à organiser l'immigration à
leur avantage en mettant en place dans les années 1880 des systèmes
de recrutement collectif à distance de jeunes hommes célibataires
à qui sont offerts des contrats à durée limitée.
III.1.1 - Premières convulsions xénophobes de
la fin du XIXe et impact sur la situation juridique des étrangers
A partir des difficultés des années 1880 au moment de
la Deuxième révolution industrielle [30] et jusqu'à la fin du siècle, la pression
xénophobe s'accentue. Le nombre d'incidents graves opposant ouvriers
français et étrangers se multiplie, et culmine entre 1881
et 1893. Les Belges sont tout particulièrement visés et
de nombreuses manifestations de xénophobie à leur égard
sont notées jusque dans les premières années du
XXe siècle. La violence atteint son paroxysme à Aigues-Mortes
en 1893 avec la tuerie de nombreux Italiens travaillant dans les salines.
Le climat xénophobe et antisémite sera particulièrement
virulent au moment de l'affaire Dreyfus.
i - Débats parlementaires et premières mesures
de contrôle sur les étrangers
La question de l'opportunité de laisser s'installer en France
les étrangers a été soulevée dès
les années 1880 à l'occasion du débat parlementaire
sur la nationalité. Si certains élus rejetaient les étrangers
et dénonçaient, entre autres motifs, l'afflux excessif
d'immigrants venant « accaparer des places et des emplois
que nos nationaux occuperaient tout aussi bien qu'eux »,
les partisans de l'intégration finiront par l'emporter finalement
avec la loi sur la nationalité du 26 juin 1889 en invoquant la
faiblesse de la natalité française, l'intérêt
de la défense nationale ou encore les besoins économiques
de la France [Laval-Reviglio, 1996, pp. 85-87].
En janvier 1887, il est décidé que les étrangers
nouvellement installés devront être recensés et
le décret du 2 octobre 1888 impose pour la première fois
une déclaration de résidence à la mairie à
tous les étrangers et leur famille dans les quinze jours après
leur arrivée en France. La non application de ce décret
conduit à la loi du 9 août 1893 « relative
au séjour des étrangers en France et à la protection
du travail national », qui impose à tous les travailleurs
étrangers résidant en France de s'inscrire sur un registre
d'immatriculation des étrangers de la commune de leur domicile
tandis qu'obligation est faite aux personnes logeant des étrangers
d'en signaler la présence dans les vingt-quatre heures. Avec
ce « régime de la déclaration », l'étranger
devait mentionner sa profession. Interdiction est faite aux employeurs
d'embaucher les étrangers qui ne se sont pas soumis à
ces formalités. Si cette loi permettait un contrôle policier
sur les étrangers, elle n'apportait aucune restriction légale
à l'emploi, au travail et à la circulation des étrangers :
du point de vue économique, on demeure bien dans un contexte
libéral [Lochak, 1985].
Lors des débats sur la loi de 1893, des élus soulèvent
de nouveau la question de la concurrence exercée par les étrangers
sur le marché du travail. Certains évoquent la somme exorbitante
que représente l'ensemble des salaires pris en France par les
travailleurs étrangers. Les boulangistes dénoncent la
concurrence exercée par les étrangers au détriment
des travailleurs français, à l'origine de la dégradation
de leurs conditions de vie, de la baisse des salaires et des niveaux
de vie. Antoine Jourde, républicain socialiste et boulangiste
propose en 1893 à la Chambre la taxation des ouvriers étrangers
ou de tous les employeurs d'ouvriers étrangers dans l'industrie
privée et l'agriculture et propose que « défense
soit faite à l'Etat, aux départements ou aux communes
pour les travaux qu'ils ont à faire exécuter, d'employer
des ouvriers étrangers » [Laval-Reviglio, 1996, p. 94].
Au plus fort de l'affaire Dreyfus en 1895, Michelin propose un projet
de loi préconisant d'écarter de la Fonction publique tous
les descendants d'étrangers jusqu'à la quatrième
génération. Un projet de loi du 25 novembre 1899 « contre
les étrangers » expose ainsi ses motivations :
« l'étranger est partout, il envahit la banque, les
professions libérales, il accapare à son profit certains
commerces, certaines industries qui jusqu'alors étaient entre
les mains des Français ». [Mekachera, 1993, p20].
ii - Premières interdictions sur le marché du travail
A partir de cette époque, « les critères de
l'appartenance nationale vont devenir des éléments fondamentaux
servant à "découper" le marché du travail en zones
interdites, permises ou fortement conseillées à ceux qui
ne font pas partie du "club". La notion extensive et manipulable à
souhait de "souveraineté nationale" et de "Fonction publique"
est à cet égard le moyen de légitimation le plus
répandu » [Noiriel, 1988, p. 283].
Si les étrangers étaient empêchés d'accéder
aux emplois de fonctionnaires, la même évolution se dessine
dans les professions « libérales ». Les avocats
se retranchent derrière un décret de 1810 pour écarter
les postulants étrangers. Les médecins obtiennent en 1892,
après une forte mobilisation de la corporation (toujours au moment
de la montée de la xénophobie), que l'exercice de la profession
soit interdit aux praticiens non munis de diplômes français
; le système des équivalences est supprimé.
Les dentistes et les sages-femmes obtiennent les mêmes avantages.
Dans le monde ouvrier, tous les secteurs travaillant pour l'Etat sont
peu à peu réservés aux travailleurs français
au nom de la « sécurité nationale ».
C'est dans les Chemins de fer que le problème apparaît
avec le plus de netteté. Dès 1888, la direction de la
Compagnie d'Orléans exige la nationalité française,
puis rapidement toutes les compagnies effectuent cette épuration.
Reprenant la proposition de 1893 du député Jourde, le
décret Millerand du 10 août 1899 permet à l'administration
de fixer la proportion maximale d'étrangers employés dans
des travaux entrepris à la suite de marchés proposés
par l'Etat, les départements ou les communes et impose aux industriels
de ne faire appel aux étrangers que dans des proportions comprises
entre 5 % et 30 % des effectifs. En 1900, des dockers français
iront jusqu'à faire grève pour faire appliquer ce décret.
Les autorités locales ne sont pas en reste et légifèrent
également dans le même sens [Milza, 1995, pp. 152-153].
Dans le milieu des années 1890, la municipalité marseillaise
interdit la pratique du commerce ambulant aux Italiens pour la réserver
aux seuls citoyens français. Dans le département du Doubs,
les Italiens ne peuvent être rempailleurs de chaises ambulants
car l'exercice de cette profession est réservé aux travailleurs
nationaux. A Cannes, les cireurs de bottes ont dû se faire naturaliser
pour échapper à la rigueur des arrêts municipaux,
et ils sont à peine tolérés à Sète,
La Ciotat, Montpellier et Lyon où, à la moindre bagarre,
ils peuvent être interdits ou expulsés. A Nice, le pouvoir
municipal élu en 1896 sur le thème « Nice aux
Niçois » s'applique à affecter aux nationaux
les emplois distribués par la mairie. L'adjudication des kiosques
à journaux est réservée aux Français, les
musiciens italiens de l'harmonie municipale sont congédiés
et la mairie va poursuivre une politique protectionniste, dirigée
notamment contre les cochers de fiacre transalpins.
Mis à part ces pratiques, les interdictions d'étrangers
s'arrêteront finalement à la Fonction publique, aux secteurs
travaillant pour l'Etat ou à des professions libérales,
ce qui était déjà considérable même
si ces secteurs représentaient encore une part réduite
des emplois [31].
III.1.2 - La rupture de 1914-1918 et les années 1920
i - Naissance d'une politique de main-d'oeuvre, premières
cartes d'identité et persistance de mesures exceptionnelles de
temps de guerre
En raison de la pénurie de main-d'oeuvre due à l'économie
de guerre, la période qui va de 1914 à 1918 voit « la
naissance d'une politique de la main d'oeuvre » [Viet,
1996, pp. 20-26]. Cette politique se caractérise par deux
axes, une « fonction de placement » avec la création
d'offices ou bureaux sous la double tutelle du ministère du Travail
et de l'Intérieur et un recours organisé à un demi-million
de travailleurs des colonies et de l'étranger, la main d'oeuvre
« exotique » comme on dit alors. Un décret
du 14 septembre 1915 permettra en effet à l'Etat de recruter
par réquisition près de 80 000 Algériens.
Au total, 132 000 Maghrébins travaillaient en remplacement
des Français dans les fermes et les usines d'armement ;
leur liberté de circulation était très limitée
et les récalcitrants étaient passibles du conseil de guerre.
Plus de 140 000 Chinois viendront également en France pour contribuer
à l'effort de guerre. « On peut voir là l'ébauche
d'une réglementation spécifique du travail migrant en
même temps que le début de l'institutionnalisation du double
marché français/étranger » [Lochak, 1985,
p161]. Il s'agit d'un tournant décisif pour la politique d'immigration
qui se dessine derrière la mise en place de cette nouvelle politique
du placement : « Si le droit du travail, droit transnational,
était reconnu à tous les travailleurs pourvus d'un emploi,
quelle que soit leur nationalité, le « droit »
au travail, droit national non garanti, pouvait dorénavant épouser
les caprices de la conjoncture et les réserves des syndicats
ouvriers, en induisant des réflexes administratifs et juridiques
de défense de l'emploi national. Si bien qu'une protection de
l'emploi aux accents discriminatoires pouvait se greffer sur une protection
légale issue d'un droit du travail indifférent aux origines »
[Viet, 1996, p. 22].
Sur le plan du contrôle du séjour, on va passer entre
1914 et 1918 du régime de la déclaration au régime
de l'autorisation avec des préoccupations de police en vue
de contrôler la présence et les déplacements des
étrangers [Lochak, 1995a]. La première carte d'identité
autorisant le séjour, prévue par une circulaire de juin
1916, est officialisée par un décret du 2 avril 1917 [32]. Obligatoire pour tout travailleur, elle est délivrée
par le préfet pour tout étranger de plus de 15 ans appelé
à séjourner plus de quinze jours en France et doit être
visée à chaque changement de résidence. Ce dispositif
est complété par la tenue d'un fichier central des étrangers
au ministère de l'Intérieur. Le décret du 21 avril
1917 précise, s'agissant des travailleurs, que la carte d'identité
est délivrée sur présentation du contrat d'embauche
visé par les services de placement. La carte comporte un visa
qui doit être renouvelé tous les ans et la profession est
précisée.
Dès son invention en 1917, la couleur joue un rôle important
dans cette politique de classement et d'affectation de la main-d'oeuvre :
le vert est attribué au travailleur immigré de l'industrie
et le chamois à celui de l'agriculture. Avec la multiplication
des catégories la palette se diversifie : jaune pour l'agriculteur,
gris-bleu pour le travailleur industriel, vert pour le non travailleur,
bleu avec texte à l'encre rouge pour l'artisan, orange pour le
commerçant. Après la guerre, on optera pour le rouge s'il
s'agit d'une carte de séjour temporaire, le vert pour la carte
ordinaire et le bleu pour le résident étranger « privilégié ».
On ne sait toutefois pas exactement quelles pratiques réelles
recouvraient ces règles définissant les premières
cartes de séjour réservées aux travailleurs.
ii - Les années 1920
A la fin de la guerre, l'immigration est une nécessité
pour la reconstruction du fait des immenses pertes de la guerre. La
croissance de l'immigration sera très forte dans les années
1920, avec 250 000 immigrations annuelles de 1921 à 1926.
Après avoir rapatrié la main d'oeuvre « exotique »
jugée inassimilable et insuffisamment productive, le gouvernement
maintient les organismes mis en place pendant la guerre et cherche à
passer des conventions de travail et d'immigration avec d'autres pays.
Les services patronaux de recrutement à l'étranger sont
constitués ou réactivés après la première
guerre mondiale dans les secteurs de la sidérurgie, des mines
ou de l'agriculture afin de pallier le manque de main d'oeuvre consécutif
à la Grande guerre, notamment dans les départements sinistrés
de l'Est et du Nord. Les services patronaux fusionneront pour former
en 1924, sous l'égide du Comité des Forges (le CNPF de
l'époque), la Société générale d'immigration
agricole et industrielle. Ces activités des organisations patronales
à l'étranger sont facilitées par l'Etat qui se
cantonne à nouveau dans son rôle de police. Cette systématisation
du recrutement d'immigrés non qualifiés permet au patronat
d'opérer une forte segmentation interne de la main d'oeuvre.
S'opposant au patronat, la CGT a obtenu dès le début
des années 1920 un droit de regard pour limiter la concurrence
étrangère sur le marché du travail, par l'intermédiaire
des organismes paritaires dans lesquels elle siège, notamment
les offices de placement créés lors de la guerre [Noiriel,
1988, p. 119]. Elle s'oppose à l'immigration, véritable
« armée de réserve » utilisée
par le patronat pour peser sur les salaires et les conditions de travail [33].
A la xénophobie de la droite qui dénonce le « complot
juif » et stigmatise les « métèques »
ou les étrangers impliqués dans l'agitation politique,
la gauche ne s'oppose d'ailleurs pas toujours farouchement [Milza, 1988,
p. 35]. Si elle soutient des étrangers impliqués
dans son combat politique, elle exprime des réticences au danger
que représenterait l'immigration en période de chômage.
« Ainsi, l'étranger était courtisé quand
son combat servait celui de certains nationaux mais marginalisé
quand son existence matérielle semblait menacer celle des Français »
[Milza, 1988, p. 36].
iii - Des décisions prises lors des crises passagères
(1920-21, 1924 et 1927)
Le poids de la conjoncture s'avère essentiel et les décisions
politiques relatives aux étrangers sont prises lors des crises
passagères de 1920-21, de 1924 et de 1927. Le chômage devient
alors immédiatement perçu comme la conséquence
d'un excès de main-d'oeuvre étrangère.
Ainsi, le député socialiste Albert Inghels interpelle
le gouvernement le 28 janvier 1921 en invoquant un argument qui allait
faire florès par la suite, celui de la subsidiarité de
la main-d'oeuvre étrangère « Il ne doit être
fait appel aux étrangers qu'à titre de complément
dans une mesure propre à garantir les droits de nos nationaux »
[Laval-Reviglio, 1996, p. 95]. Le 17 décembre 1920,
le gouvernement avait déjà décidé que tout
travailleur étranger doit présenter un certificat d'engagement
visé par les services du ministère du Travail. Un décret
de juin 1922 donne au maire ou au commissaire de police un rôle
en matière d'immigration. Quand l'étranger vient demander
à la mairie une carte d'identité, le maire doit notamment
évaluer « les sentiments francophiles, les moyens d'existence,
la conduite, la moralité et les fréquentations de l'étranger »
et vérifier si l'intéressé travaille pour son compte
ou pour autrui, s'il possède la carte verte (agriculture) ou
la carte chamois (industrie), s'il possède un contrat d'embauche
pour le département, etc. Ces tracasseries participent à
l'accentuation de la surveillance et à la stigmatisation des
étrangers. Jusqu'à la fin des années 1930, l'application
des mesures de contrôle des étrangers par les maires variera
fortement selon les communes et selon les périodes, tantôt
par ignorance, tantôt par malveillance [Pierre, 1998].
Avec la crise de 1924, une offensive anti-étrangère
de plus grande ampleur est déclenchée à la Chambre.
Les étrangers se voient affublés du qualificatif d'indésirables
et, fait nouveau, ce ne sont plus des membres de la droite nationaliste
mais des députés de gauche, surtout les radicaux, à
l'image de leur représentant Édouard Herriot. Ce dernier
invoque des questions de sécurité et demande le 20 mars
1924 qu'on " assainisse le marché du travail »
en invoquant le problème du débauchage des étrangers
et de la concurrence déloyale pour les ouvriers français
[Laval-Reviglio, 1996, p96]. Ce thème est repris le 6 avril 1925
par Léon Jénouvrier, sénateur de la gauche républicaine
qui dénonce l'embauche par les patrons de l'industrie de la main-d'oeuvre
étrangère agricole, portant préjudice à
l'agriculture et aux ouvriers français. Il dénonce en
l'étranger « cet indésirable qui se livre aux
pires excès », qui « du jour où il
ne travaille plus, frappe » et de citer les ouvriers italiens
ou polonais « qui la plupart du temps sont d'excellents ouvriers
mais aussi parfois des êtres exécrables ».
Le ministre du Travail radical-socialiste, Antoine Durafour proposera
un texte de loi le 5 novembre 1925, discuté rapidement
les 7 et 8 juillet 1926 à la Chambre et adopté sans discussion
au sénat le 6 août 1926. Pour le député Georges
Mazerand, républicain de gauche, qui expose l'objectif de ce
texte, « il importe de canaliser l'afflux des travailleurs
venus de l'extérieur vers les professions et les régions
où leur concours peut nous être utile. Il ne faut pas qu'ils
entrent dans des professions ou des régions déjà
encombrées et où, par suite de cet afflux, il en résulterait
pour nos nationaux des perturbations graves telles que le chômage
ou l'avilissement des salaires » [Laval-Reviglio, 1996, p. 96].
Si le texte initial avait le seul objectif affiché d'interrompre
la débauche d'ouvriers agricoles vers l'industrie, il couvrira
en fait tous les salariés étrangers. Cette loi du 11 août
1926, modifiant les décrets de 1917, innove en consacrant l'existence
de la carte d'identité portant la mention « travailleur ».
Entre temps, la carte d'identité avait déjà été
transformée en carte à durée limitée et
payante.
Jusque là, tout étranger régulièrement
entré en France possesseur de la carte d'identité d'étranger
qui existait depuis 1917, pouvait se faire librement embaucher. Avec
la loi du 11 août 1926, la carte est établie au vu d'un
contrat de travail. La loi du 11 août 1926 interdit à quiconque
d'employer un étranger non muni de cette carte ; il devient
même impossible d'employer un étranger dans une profession
autre que celle mentionnée sur la carte, pendant un délai
d'un an après la délivrance de la carte afin d'éviter
toute embauche de l'ouvrier étranger par un autre employeur [Viet,
1996, p31]. Désormais l'administration disposera d'un moyen commode
pour accorder plus ou moins de cartes de travailleur, et dans la pratique,
l'application sera effectivement variable selon le contexte économique
et politique [Lochak, 1995a, Laval-Reviglio, 1996, p. 97].
La crise économique de 1927 est une nouvelle occasion pour
les parlementaires d'interpeller le gouvernement à propos du
chômage et du problème de l'immigration. C'est dans ce
contexte que le débat sur la nationalité se déroule
et s'achèvera par la loi du 10 août 1927. Comme
lors des débats de la précédente loi de 1889, les
arguments xénophobes et racistes ne sont pas absents. Des élus
craignent que les naturalisations ne remettent en cause « la
vraie race française [qui] est de granit » ; d'autres
préconisent de n'accepter que les plus assimilables (d'abord
les Italiens, Belges, Espagnols, Suisses français) et veulent
écarter les « éléments mal assimilables »,
au premier rang desquels les « Orientaux » et « Levantins »,
suspectés d'être davantage enclin à la criminalité.
Les relents de racisme et d'antisémitisme ne sont plus le seul
fait des députés nationalistes extrémistes, comme
lors des débats de la fin du XIXe siècle, mais aussi d'élus
modérés, de républicains et de socialistes [Laval-Reviglio,
1996, pp. 88-91]. Finalement, les fortes préoccupations
liées à la natalité, à la défense
nationale et à la nécessité de protéger
l'empire colonial l'emporteront comme lors des débats de la fin
du XIXe siècle au détriment des préoccupations
liées à la protection de la main d'oeuvre française.
La loi de 1927 apparaît à première vue très
libérale mais elle laisse une large part d'arbitraire à
l'administration en matière de naturalisation [Laval-Reviglio,
1996, pp. 88-92]. Dans la pratique, les naturalisations deviennent
moins nombreuses et plus difficiles du fait du climat d'exacerbation
des concurrences et de la xénophobie. Ce phénomène
contribue à renforcer la segmentation du marché du travail.
Le climat anti-étranger de 1927 aboutira à l'adoption
de la loi du 26 mars 1927, complétée par des décrets
jusqu'en 1928, exigeant de tout étranger, et non plus du seul
travailleur, qui veut résider plus de deux mois en France, la
possession d'un carte d'identité valable deux ans. Cette disposition
institue de facto la notion d'étranger en situation irrégulière.
De nombreux travailleurs « illégaux » deviendront
ainsi menacés de refoulements qui feront des ravages dans les
années 1930, notamment parmi les juifs d'Europe Centrale. Un
décret prévoyait en outre des cas de retraits laissant
une large part à l'arbitraire administratif puisqu'était
notamment prévu le cas où l'étranger cessait « d'offrir
les garanties désirables », auquel cas il avait huit
jours pour quitter le territoire.
Notes
[28] Sur ce point,
voir les passages éclairants de Stéfan Zweig (1944)
dans le Le monde d'hier. Souvenirs d'un européen, Le
Livre de poche, pp.477-481 (repris in Plein Droit n°32,
juillet 1996, pp. 33-34).
[29] Pour une explication
économique de cette position traditionnelle du patronat, et
celle opposée des syndicats, se reporter à la deuxième
partie de ce dossier consacrée aux théories économiques.
[30] L'emploi industriel
connaît un important repli de 1876 à 1886.
[31] Malgré
l'industrialisation rapide, près de 60 % de la population
est encore rurale au tout début du XXe siècle. Un peu
plus de 40 % de la population active travaille encore dans l'agriculture,
30 % environ dans l'industrie et le reste dans les services.
Les professions libérales ne représentent que 0,4 %
de la population active contre trois fois plus aujourd'hui. La part
des personnes travaillant dans la Fonction publique et les secteurs
travaillant pour l'Etat était relativement faible et a également
beaucoup cru par la suite. Au début du siècle, l'Etat
compte environ un demi million de fonctionnaires civils, soit entre
2 et 3 % de la population active (sources : Marchand et
Thélot, 1997, Le travail en France. 1800-2000, Essais
et Recherches, Nathan Alternatives Économiques
n°165, décembre 1998, p. 33).
[32] La carte d'identité
pour les nationaux sera introduite bien plus tard sous Vichy.
[33] La théorie
économique permet de comprendre ces positions traditionnelles
opposées du patronat et des syndicats (cf deuxième
partie de ce dossier).

Dernière mise à jour :
13-11-2000 16:46.
Cette page : https://www.gisti.org/doc/presse/1999/cerc/chapitre-3-2.html
|



 En ligne
En ligne


 En ligne
En ligne
