|
|
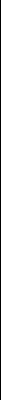
|
Rapport « Immigration,
emploi et chômage » du CERC
Les théories des migrations internationales distinguent deux
types de courants migratoires. Les grands courants de réfugiés
sont provoqués par des effondrements politiques et sociaux majeurs,
ou des persécutions systématiques subies par des populations
particulières pour des raisons diverses. Ils mettent en mouvement
de vastes ensembles de populations et se concentrent sur de courtes
périodes de temps ; le plus souvent ils concernent des populations
pauvres et s'effectuent, pour cette raison même, entre pays limitrophes ;
une exception majeure étant l'émigration vietnamienne
et cambodgienne, dont une fraction significative s'est produite vers
les Etats-Unis dans les années 70-80. Ainsi l'immense majorité
des réfugiés africains (Nigérians, Ethiopiens,
Rwandais, etc....) sont restés en Afrique ; les réfugiés
Afghans au Pakistan, etc.[7] La politique récente du HCR tend même à
organiser ces déplacements minimums et à garantir des
statuts temporaires plutôt que ceux reconnus par la Convention
de Genève.
Les courants de travailleurs, eux, se déroulent sur des périodes
beaucoup plus longues, et peuvent concerner des pays très distants.
On s'intéressera naturellement, dans ce dossier, à ces
derniers courants, qui sont en pratique de loin les plus importants
aujourd'hui dans le cas français[8]
.
Pourquoi des travailleurs choisissent-ils d'émigrer ?
Pourquoi les courants migratoires, une fois établis, tendent-ils
à se perpétuer ? En particulier, est-il exact de
dire que la meilleure façon de réduire la « pression
migratoire » des pays du Sud est de favoriser leur développement
pour que leurs citoyens n'aient plus intérêt à émigrer ?
Une synthèse proposée par Massey et alii, [1993]
permet de faire un tour d'horizon des principales théories des
migrations internationales [9].
II.1.1 - Le déclenchement des migrations
La théorie économique, on le sait, est riche de courants
de pensée divers, qui partent de prémisses différentes
et parviennent à des conclusions souvent contrastées.
Il n'en va pas différemment en matière de migrations,
notamment pour l'explication de leur déclenchement. Sans prétention
à l'exhaustivité, on évoquera ici quatre courants
théoriques, les deux premiers se situant dans le champ de la
théorie « standard », les deux derniers parmi
les courants « hétérodoxes ».
i - L'approche néo-classique
Développée initialement par Lewis [1954] et Harris et
Todaro [1970], cette théorie se rapproche du sens commun spontané :
les travailleurs migrent parce qu'ils sont pauvres chez eux et qu'ils
préféreraient l'être moins dans un pays développé.
C'est le modèle du type « répulsion - attraction »
(push-pull en anglais), qui constitue le « B-A-BA »
de la théorie économique standard des migrations.
Au niveau macro-économique, « les migrations internationales,
comme les migrations internes, sont provoquées par des différences
géographiques entre l'offre et la demande de travail. Les pays
richement dotés en travail relativement au capital ont un salaire
d'équilibre bas, alors que les pays où le travail est
rare relativement au capital ont un salaire de marché élevé.
Le différentiel de salaire qui en résulte provoque le
déplacement de travailleurs du pays à bas salaires vers
le pays à hauts salaires. (..). A l'équilibre le différentiel
international de salaires reflète seulement le coût, monétaire
et psychologique, de la mobilité internationale »
[Massey et al., p. 433].
Mais ce modèle, qui semble le bon sens même, n'a qu'une
valeur scientifique relative car il n'a guère de pouvoir prédictif et
est largement contredit par l'expérience. « La tendance
du modèle push-pull à être appliqué
aux flux constatés dissimule son incapacité à expliquer
pourquoi des mouvements similaires ne se produisent pas en provenance
d'autres pays également pauvres, ou pourquoi les sources d'émigration
se concentrent dans certaines régions et non dans d'autres, à
l'intérieur d'un même pays » [p. 607]. Selon
deux autres auteurs, « s'il fallait prendre au sérieux
les théories push-pull, les courants les plus intenses
d'émigration devraient provenir d'Afrique équatoriale
ou de pays aussi misérables ; à l'intérieur
de ces pays, les migrants devraient provenir des régions les
plus pauvres. Si nous devions prendre les modèles d'offre-demande
à la lettre, les migrations devraient suivre, avec un décalage,
le cycle économique, et décliner ou s'interrompre pendant
les récessions (...). Ces généralisations (...)
ont été constamment démenties par les recherches
empiriques » [Portes et Borocz, 1989, p. 625].
On peut certes dire qu'en général, les migrations se
produisent de pays pauvres vers des pays riches : mais il n'y a
pas là une théorie des migrations, car une telle généralité
n'explique pas pourquoi les migrations se produisent à un moment
et pas à un autre, depuis un pays donné et non depuis
un autre (à niveau de revenu équivalent), vers un pays
et non vers un autre. L'introduction des « coûts de
migration » peut améliorer la capacité prédictive
du modèle, mais il est en général impossible de
mesurer les « coûts psychologiques » que doivent
supporter les migrants qui abandonnent leur pays.
Au niveau micro-économique, le modèle push-pull
repose sur des comportements individuels « rationnels »
au sens de la théorie économique standard : « les
migrants potentiels évaluent les coûts et avantages de
se déplacer vers différentes destinations internationales
alternatives, et émigrent là où le rendement net
escompté de la migration est le plus élevé compte
tenu de leur horizon temporel. Le rendement escompté pour chaque
période future est obtenu en considérant les revenus
correspondant au niveau de qualification de la personne dans le pays
de destination, et en les multipliant par la probabilité d'obtenir
un emploi là-bas (...). On déduit ensuite de ce revenu
espéré celui qu'on s'attend à obtenir dans son
pays d'origine (le revenu observé multiplié par la probabilité
d'emploi), et la différence est cumulée sur une période
de 0 à n années, incluant un facteur d'actualisation qui
reflète la plus grande utilité de l'argent gagné
aujourd'hui par rapport à celui qu'on gagnera dans l'avenir. »
[p. 434]. Si le rendement net escompté est positif, l'individu
migre : il va alors là où le rendement escompté
est le plus élevé. Par rapport à l'approche macro-économique,
on notera que le taux de chômage intervient dans la décision
individuelle.
Un autre argument souvent évoqué pour prédire
une inévitable intensification des flux migratoires est la « pression
démographique » : la croissance démographique
beaucoup plus rapide des pays du Sud inciterait, comme par un phénomène
thermodynamique d'égalisation des pressions de deux gaz mis en
contact, à un accroissement de l'émigration vers le Nord.
Or cette hypothèse suppose que la croissance démographique
provoque en général une baisse du revenu par tête,
ce qui est loin d'être démontré (cf infra).
Au plan empirique, rien n'indique que le taux d'accroissement de la
population du pays d'émigration soit un facteur explicatif de
l'intensité des flux d'émigration, comme l'indique encore
une récente étude allemande [Rotte et Vogler, 1998].
Ce modèle permet de faire des hypothèses pour expliquer
pourquoi, dans un pays d'émigration, certains individus choisissent
d'émigrer plutôt que d'autres, vers certains pays plutôt
que vers d'autres. Toutefois « la valeur prédictive
du modèle est faible » [Cogneau et Tapinos, 1997],
ce qui le rend peu utile dans la conception de politiques en la matière.
ii - La « nouvelle économie des migrations »
Inaugurée notamment par l'article de Stark et Bloom [1985],
cette théorie se situe dans le cadre de ce que Olivier Favereau
[1986] appelle la « théorie standard élargie » :
elle abandonne les hypothèses les plus caricaturales du modèle
standard pour donner plus de réalisme à la modélisation,
sans renoncer toutefois à la méthode « individualiste »
selon laquelle les phénomènes économiques résultent
entièrement des interactions entre agents micro-économiques.
La « nouvelle économie des migrations » ne
part pas d'un individu, isolé au milieu de marchés parfaits,
et qui maximiserait son revenu en disposant d'une information complète
et instantanée sur les perspectives d'emploi et de salaire dans
son pays et dans les pays d'accueil potentiels. Elle considère
au contraire que les migrations résultent de décisions
collectives prises dans des situations d'incertitude et d'imperfections
des marchés. « Les décisions de migration ne
sont pas prises par des agents isolés, mais par des ensembles
plus larges de personnes liées entre elles - surtout des
familles et des ménages -, dans lesquelles les agents agissent
collectivement non seulement pour maximiser leur revenu, mais aussi
pour minimiser les risques et pour relâcher les contraintes qui
proviennent de diverses limites des marchés, au delà du
marché du travail » [Massey et al., p. 436].
En effet les marchés d'assurance, pour les populations rurales
qui représentent la grande majorité des habitants, sont
peu ou pas développés dans les pays d'émigration ;
il s'agit notamment :
- des marchés de l'assurance des récoltes : en
cas de calamité naturelle la survie même du ménage
est menacée, faute d'institutions adéquates de mutualisation
des risques ;
- des marchés de « futurs » : en cas
de chute des cours des produits agricoles, il n'y a pas de garantie
de prix pour les récoltes, et les revenus peuvent subir de
très fortes fluctuations ;
- de l'assurance chômage : en cas de perte d'emploi salarié
suite par exemple à une chute de la production ou des prix,
aucun revenu de remplacement n'est versé ;
- des marchés de capitaux : les institutions d'épargne
ne sont pas fiables, le risque de spoliation est permanent, ce qui
limite les capacités d'épargne et d'investissement :
il existe un rationnement du crédit.
Pour surmonter les risques liés à ces insuffisances
des institutions locales, les familles peuvent choisir de diversifier
leurs activités en envoyant l'un de leurs membres à l'étranger.
Même s'il ne gagne pas plus qu'au pays, ce revenu sera soumis
à des risques différents, et des compensations pourront
s'établir, par exemple entre une mauvaise année au village
et une bonne année pour l'émigré.
Les différentiels de revenu entre pays d'émigration
et d'accueil ne sont plus une condition nécessaire de la décision
de migration ; au contraire les préoccupations d'assurance
contre l'incertitude poussent les ménages à s'engager
à la fois dans des activités internes risquées
(innovations, entreprise) et vers l'émigration : « le
développement économique des régions d'émigration
ne réduit pas nécessairement les pressions à l'émigration »
[id, p. 439]. Car les ménages qui accroissent leurs ressources
au pays sont aussi ceux qui sont susceptibles de mener cette stratégie
complexe de diversification des risques ; au contraire les ménages
les plus pauvres ne peuvent même pas financer le départ
de l'un de leurs membres.
Dans ce cadre, et contrairement aux prédictions du modèle
néo-classique originel, le développement des pays du Sud
n'est pas, du moins à court et moyen terme, de nature à
réduire l'intensité des migrations : « les
transformations structurelles de l'économie favorisent la propension
à émigrer » [Cogneau et Tapinos, 1997]. Une
étude récente estime à environ 4 000 $
par habitant le niveau de revenu à partir duquel la croissance
économique dans les pays d'émigration va réduire
la propension de leurs ressortissants à émigrer [Faini,
1996] [10]. Une autre étude concernant
l'immigration vers l'Allemagne trouve une relation croissante entre
revenu national par tête et émigration pour les pays africains,
et une relation en « U inversé » pour l'Asie
[Rotte, Vogler, 1998] : aucun pays d'Afrique n'est encore arrivé
au stade où la croissance interne commence à réduire
l'émigration.
A l'inverse le simple constat d'un écart croissant de richesses
entre le Nord et le Sud, par exemple, ne permet pas de prédire
une intensification des pressions migratoires. Certes, à long
terme, le rattrapage économique tarit l'émigration, comme
le montrent les exemples de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, devenus
depuis peu des pays d'immigration : ceci explique la relation en
« U inversé » entre émigration et
développement. Mais dans l'intervalle - ;qui peut représenter
plusieurs décennies [Cogneau et Tapinos, 1997] - il faut
s'attendre à une poursuite, voire une accélération
des migrations.
iii - La théorie du dualisme du marché du travail
Cette théorie s'oppose elle aussi à la théorie
néo-classique conventionnelle, mais elle le fait en attribuant
le rôle déterminant à la demande de travail émanant
des entreprises des pays d'accueil. « Selon Piore (1979],
l'immigration n'est pas causée par des facteurs de répulsion
(push) dans les pays d'origine (bas salaires ou chômage
élevé), mais par des facteurs d'attraction (pull)
dans les pays d'accueil (un besoin chronique et inévitable de
travailleurs étrangers). » [Massey et al., p. 441].
En effet, dans les pays d'accueil, les hiérarchies de salaires
sont aussi des hiérarchies de prestige. « Si les employeurs
veulent attirer des travailleurs pour des emplois situés au bas
de l'échelle, ils ne peuvent se contenter d'élever les
salaires. Si les salaires les plus faibles sont augmentés, il
en résultera de fortes pressions pour une augmentation équivalente
des salaires aux autres niveaux de la hiérarchie ».
D'où une « inflation structurelle », et une
forte incitation à faire venir des travailleurs étrangers,
non sensibles (du moins au début) aux exigences de statut social
des sociétés d'accueil. Les immigrants sont des target
earners, des travailleurs qui visent un objectif précis (accumuler
suffisamment d'argent pour construire une maison, lancer une affaire
ou acheter une terre chez eux). Ils acceptent donc les emplois considérés
comme « dégradants » dans les sociétés
d'accueil.
En outre les entreprises segmentent le marché du travail :
les méthodes intensives en capital sont utilisées pour
satisfaire la partie prévisible de la demande, et les méthodes
intensives en travail pour la partie imprévisible. Dans le premier
segment (« primaire ») les travailleurs sont stables
et relativement bien payés. Dans le deuxième (« secondaire »)
ils sont précaires et mal payés. Les travailleurs
autochtones fuient le segment secondaire, considéré comme
dégradant ; les femmes désirent désormais
des carrières équivalentes à celles des hommes,
et les jeunes veulent poursuivre leurs études. Les entreprises
ont donc un besoin structurel d'immigration pour pourvoir les postes
de travail dans ce secteur sans déclencher de spirale des salaires.
Ce schéma correspond aux politiques d'immigration des entreprises
françaises dans les années soixante : des recruteurs
étaient envoyés par les constructeurs automobiles au Maroc
et en Algérie pour alimenter les usines en main-d'oeuvre
obéissante et bon marché ; les employeurs de l'agriculture,
du bâtiment ou de la confection profitaient eux aussi de ces courants
migratoires. « La migration issue d'anciennes colonies et
le système des « travailleurs invités »
(gastarbeiter) ont été les deux formes majeures
de l'émigration de travailleurs vers l'Europe occidentale dans
l'après-guerre. Ces deux phénomènes appuient, chacun
à sa manière, l'idée selon laquelle ces flux ne
s'expliquent pas par l'arriération en elle-même. (...)
500 à 600 agences de recrutements de travailleurs ouest-allemandes
opéraient dans le bassin méditerranéen à
la fin des années soixante » [Portes et Borocz, 1989,
p. 609].
Cette analyse, proposée par Piore à la fin des années
soixante-dix, a perdu de son actualité pour le cas européen.
Depuis le début de la crise économique des années
soixante-dix, la perspective a changé : l'immigration de
travail est très réduite, la proportion de travailleurs
non qualifiés dans le système productif décline
rapidement. Pourtant certains auteurs ont adapté la théorie
du dualisme du marché du travail aux évolutions observées.
Depuis 1975, les politiques de gestion de la main d'oeuvre ont connu
une inflexion radicale. Au lieu de concentrer les salariés dans
de grandes unités de production, avec des emplois stables, des
tâches strictement définies et une hiérarchie omniprésente
(comme dans l'après-guerre), les entreprises ont choisi la voie
de la flexibilité. Diminution rapide des effectifs des établissements,
recours systématique à la sous-traitance en cascade (avec
des cercles concentriques autour du donneur d'ordre), développement
de l'emploi précaire, tout a été fait pour flexibiliser
les conditions d'usage de la main d'oeuvre dans son ensemble. Autrement
dit, les « marchés primaires » ont été
largement entamés, et la main d'oeuvre a été progressivement
« secondarisée ». Dans ce nouveau contexte,
au tournant des années quatre-vingt, le développement
de la sous-traitance s'est fait en partie par un recours à la
main d'oeuvre immigrante (de préférence illégale).
La vraie ou fausse sous-traitance et le travail au noir étaient
plus faciles à faire accepter par des salariés étrangers
illégaux, grâce à la menace permanente de non renouvellement
des titres de séjour, qui les rend plus malléables. Dans
les années quatre-vingt les étrangers, plus « souples »,
moins syndiqués, plus « court-termistes »,
ont donc été utilisés comme cobayes des politiques
de précarisation : « en fournissant le modèle
d'un nouveau rapport employeur-salarié, l'emploi d'étrangers
sans titre a ouvert la voie à un mode de régulation sociale
exactement inverse de celui qui prédominait dans la phase antérieure »,
ce que Claude-Valentin Marie appelle l' « avènement
du salarié néo-libéral » [Marie,
1997] (cf. infra).
Comme l'explique un économiste libéral, « la
France paie sous la forme d'une immigration non négligeable la
rigidité de son mode de formation des salaires réels due
à l'existence du SMIC, de dispositifs de « protection
de l'emploi », d'un système d'indemnisation du chômage
plutôt généreux et de bien d'autres facteurs, notamment
le niveau du RMI. C'est à ces rigidités qu'il faut s'attaquer
si l'on souhaite réduire l'immigration » [Courier P.L.,
1997] : on ne saurait mieux dire que l'immigration correspond à
des facteurs « pull », c'est-à-dire
aux besoins des employeurs de disposer d'un personnel plus flexible.
iv - L'approche par « l'économie monde »
Cette approche, inspirée du cadre théorique marxiste,
prend encore davantage de recul par rapport aux phénomènes
de migrations pour les situer dans des évolutions globales et
de long terme. Selon I. Wallerstein [1974] et M. Castells [1989],
ce sont des facteurs socio-historiques de grande ampleur qui provoquent
les courants migratoires, et non des micro-décisions individuelles
ou d'entreprises particulières. « La pénétration
des relations économiques capitalistes dans des sociétés
périphériques non capitalistes crée une population
mobile disposée à émigrer » [Massey et
al., p. 444]. « A mesure que la terre, les matières
premières et le travail dans les régions périphériques
deviennent des marchandises, des flux migratoires en découlent
inévitablement ». Car « la substitution de
l'agriculture marchande à l'agriculture de subsistance sape les
relations économiques et sociales traditionnelles ; l'utilisation
d'intrants modernes produit des récoltes à haut rendement
et à bas prix, qui évincent les producteurs non capitalistes
des marchés » [id.]. De même la salarisation
d'un nombre croissant de paysans, pour les besoins des mines, puis des
entreprises multinationales, « sape les formes traditionnelles
d'organisation économique et sociale basées sur des systèmes
de réciprocité et des rôles fixés d'avance,
et crée des marchés du travail basés sur de nouvelles
conceptions individualistes, sur le gain privé et sur le changement
social. Ces tendances favorisent vraisemblablement la mobilité
géographique du travail dans les régions en développement,
avec souvent des conséquences internationales » [id.,
p. 445]. C'est donc la déstructuration des sociétés
du Sud, par le colonialisme puis le néocolonialisme, qui « libère »
une main-d'oeuvre qui va alimenter les marchés du travail des
pays du Nord.
Les destinations de ces travailleurs ne résultent pas de calculs
économiques d'individus rationnels, mais des liens historiquement
tissés entre métropole et semi-colonies : « la
mondialisation des échanges crée des liens matériels
et idéologiques avec les pays d'où sont originaires les
capitaux ». Les liens matériels se constituent autour
des moyens de transport et de commerce international ; les liens
idéologiques proviennent du pouvoir de pénétration
des modèles culturels et sociaux des pays économiquement
dominants. Les « villes globales », où se
concentrent les richesses et les capitaux, attirent des flux d'immigrants
pour remplir les milliers d'emplois peu qualifiés nécessaires,
que les travailleurs autochtones tendent à refuser. « Finalement
les migrations internationales n'ont guère de rapport avec des
écarts de salaire ou de taux de chômage : elles découlent
de la dynamique de la pénétration des marchés et
de la structure de l'économie globale » [id.,
p. 448]. A l'ère de la mondialisation accélérée
des échanges, économiques et financiers, au moment où
les forces du marché pénètrent l'ensemble des pays
de la planète sous l'impact des politiques libérales « d'ajustement
structurel » et y détruisent les protections traditionnelles,
cette approche théorique estime largement illusoire le projet
des pays riches d'inverser la tendance à la mobilité internationale
croissante des hommes. Sans nier l'intérêt d'une analyse
historique globalisante, on peut cependant regretter que ce courant
soumette rarement ces hypothèses à des vérifications
empiriques concluantes.
II.1. 2 - La perpétuation des mouvements migratoires
Une fois les courants de migration établis, ils tendent à
se reproduire d'eux-mêmes au cours du temps, même quand
les conditions qui leur ont donné naissance changent où
disparaissent. Plusieurs approches théoriques rendent compte
de cette perpétuation :
i - La théorie des réseaux
Les premiers migrants constituent des ressources pour les candidats
futurs à l'émigration : les réseaux qu'ils
constituent forment un « capital social sur lequel les personnes
peuvent s'appuyer pour trouver un emploi à l'étranger »
[Hugo, 1981]. « Une fois un certain seuil atteint, l'expansion
des réseaux réduit les coûts et les risques de l'émigration,
ce qui provoque une hausse du taux d'émigration, ce qui à
son tour renforce les réseaux, etc. » [Massey et
al., p. 449]. Les migrations sont donc des processus auto-entretenus.
« Plus que des calculs de gains individuels c'est l'insertion
des personnes dans des réseaux qui contribue à expliquer
les différences dans les propensions à émigrer
et le caractère durable des flux migratoires » [Portes
et Borocz, 1989, p. 612].
ii - La théorie « institutionnelle »
Une fois les courants d'immigration enclenchés, des opportunités
économiques apparaissent pour aider les candidats à l'émigration
à réaliser leur projet, à contourner les éventuelles
barrières ou restrictions mises en place par les pays d'accueil.
Les filières d'immigration constituent un secteur d'activité
hautement rentable. « Puisque ce marché souterrain
crée des conditions propices à l'exploitation et à
l'oppression, apparaissent également des organisations humanitaires
dans les pays d'accueil, pour assurer le respect des droits et améliorer
la situation des migrants légaux et illégaux »
[Massey et al., p. 450]. A la longue, les filières
souterraines et les organisations humanitaires « constituent
de nouvelles formes de capital social sur lesquelles les migrants peuvent
s'appuyer pour accéder aux marchés du travail étrangers »
[id., p. 451].
iii - La « causalité cumulative »
[Myrdal, 1957]
« Chaque migration modifie le contexte social dans lequel
les décisions ultérieures de migration sont prises, généralement
d'une manière qui accroît les probabilités de migrations
supplémentaires ». Plusieurs mécanismes sont
à l'oeuvre dans le déclenchement d'une causalité
cumulative :
- Imitation : les premiers émigrés envoient des
ressources au pays ou reviennent avec des économies qui accroissent
les inégalités et introduisent des frustrations parmi
les familles dont aucun membre n'a encore émigré, favorisant
ainsi l'émigration ultérieure.
- Distribution des terres : les émigrés achètent
des terres qu'ils exploitent peu, diminuant la demande de travail
agricole et favorisant ainsi l'émigration.
- Techniques agricoles : les émigrés utilisent
des techniques plus intensives en capital, diminuant ainsi encore
la demande de travail agricole.
- Changement culturel : les migrations deviennent un rite de
passage, et ceux qui n'y ont pas réussi sont considérés
comme paresseux et indésirables.
- Capital humain : l'émigration étant un processus
sélectif, les mieux éduqués et les plus productifs
sont ceux qui émigrent en premier ; ceci ralentit la croissance
économique du pays d'émigration et accélère
celle des pays d'accueil, ce qui renforce les incitations à
l'émigration. En outre le développement de l'éducation
dans les pays d'émigration accroît les rendements escomptés
de l'émigration, et favorise donc cette dernière.
- Stigmatisation : dans les pays d'accueil les emplois occupés
de façon croissante par des immigrants sont étiquetés
comme non désirables par les autochtones, qui les fuient, renforçant
ainsi le recours des employeurs à l'immigration.
Ce survol de littérature permet de montrer la complexité
des phénomènes en jeu : les « pressions
migratoires » ne s'expliquent simplement par l'écart
de richesse entre Sud et Nord que dans la théorie néo-classique
élémentaire, qui apparaît singulièrement
réductrice par rapport à la diversité des facteurs
en cause. Cette théorie rudimentaire a d'ailleurs été
abandonnée au profit des approches plus complexes évoquées
ci-dessus : il apparaît ainsi clairement, aussi bien au plan
théorique qu'au plan empirique, que le développement des
pays d'émigration n'est pas, dans un premier temps qui peut s'étendre
sur plusieurs décennies, un facteur de ralentissement de l'émigration,
bien au contraire. Ce n'est que lorsque les niveaux de revenu par tête
ont atteint un degré de convergence suffisant entre pays d'émigration
et pays d'accueil que les flux migratoires peuvent ralentir, voire s'inverser
(comme dans le cas de l'Europe du Sud).
Notes
[7] Les statistiques du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR) indiquent qu'en 1995, sur un total de 14,4 millions de réfugiés,
l'Afrique en comptait 6,7 millions , l'Asie 5 millions et l'Europe 1,8
million, dont 1 million pour la seule Allemagne et 150 000 pour
la France.
[8] Cela pourrait changer
si la crise algérienne s'aggravait et si un droit d'asile était
accordé plus largement qu'aujourd'hui aux ressortissants algériens.
[9] Les citations ci-dessous,
sauf indication contraire, sont extraites de cet article de référence
qui figure dans le recueil d'articles édité par Robin
Cohen, Theories of Migration, Elgar, Cheltenham, 1996.
[10] Le Maroc se situe
aujourd'hui à 2000 $ et la Tunisie à 3000 $ / habitant.

Dernière mise à jour :
13-11-2000 16:40.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/presse/1999/cerc/chapitre-2-2.html
|



 En ligne
En ligne


 En ligne
En ligne
