|
|
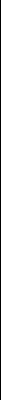
|
L'immigration,
une question trop sensible (2)
par Danièle Lochak
Page 1
| Page 2
L'ombre portée du Front national
Mais le véritable tournant dans la politique de la gauche intervient
après les élections municipales de mars 1983. Sous l'impulsion
de l'extrême-droite, désormais présente dans la
bataille électorale et qui n'hésite pas à miser
sur les penchants xénophobes et racistes de l'électorat,
l'immigration va devenir l'objet de toutes les surenchères. La
campagne des municipales de mars 1983 laissera à cet égard
des stigmates durables. A Le Pen, qui juge que « les Français
ont l'impression d'être submergés », font
écho des candidats du RPR et de l'UDF proclamant qu'« il
faut arrêter cette invasion » et « en
finir avec la délinquance bronzée ».
Face à une droite qui s'aligne progressivement sur l'extrême-droite,
quand elle ne fait pas alliance avec elle, la gauche se replie sur une
ligne de défense qui consiste à essayer de démentir
par ses discours et par ses actes le laxisme dont on l'accuse :
la lutte contre l'immigration clandestine va dès lors mobiliser
l'essentiel de son énergie. Elle pense ainsi couper l'herbe sous
le pied à la droite ; mais en lui emboîtant le pas
elle contribue à populariser des thèmes dangereux et à
rendre la question de l'immigration encore plus sensible.
Le nouveau discours officiel, inauguré par une déclaration
de François Mitterrand au Conseil des ministres du 31 août
1983, s'articule sur l'opposition désormais classique entre les
immigrés installés, « qui font partie de
la réalité nationale » et dont il faut favoriser
l'insertion, et les clandestins qu'il faut renvoyer et contre lesquels
il est d'autant plus légitime de sévir qu'ils risquent
de gêner l'insertion de la population immigrée en situation
régulière.
Ni le changement du discours officiel, ni le resserrement du contrôle
sur la population immigrée ne suffisant à produire les
effets escomptés sur l'image du gouvernement dans l'opinion,
la fuite en avant continue, d'autant qu'il faut aussi rassurer les élus
socialistes de base, inquiets de la baisse d'audience de la gauche à
l'approche des élections. « L'extrême-droite,
ce sont de fausses réponses à de vraies questions »,
déclare Laurent Fabius lors d'une émission télévisée
en septembre 1984, avant d'annoncer, en 10 octobre, de nouvelles mesures
restrictives.
L'année 1985, marquée par la proximité des élections
législatives, inaugure une nouvelle étape dans la contamination
du discours par les thèses de l'extrême-droite. Ce ne sont
plus seulement les clandestins, en effet, que l'on désigne comme
la source des maux dont les Français sont victimes : chômage
et insécurité ; c'est la présence d'une population
étrangère nombreuse qui représente par elle-même,
dit-on, une menace pour la nation française. C'est ainsi que
la logique économique, axée sur la protection du marché
de l'emploi, et la logique policière, qui voit dans tout étranger
un irrégulier ou un délinquant en puissance se voient
relayées par une logique plus pernicieuse encore, aux forts relents
xénophobes, qui considère la population immigrée
comme menaçant non plus seulement l'emploi ou l'ordre public,
mais plus fondamentalement l'identité nationale.
A l'approche des législatives de 1986, et faisant écho
à ces préoccupations, tous les partis de droite inscrivent
dans leur programme la nécessité de modifier le Code de
la nationalité de façon à ce qu'au minimum la naissance
en France n'entraîne plus de plein droit l'acquisition de la nationalité
française. On relève que c'est la première fois,
depuis Vichy, que la question de la nationalité ressurgit au
premier plan de l'actualité, et qu'elle y ressurgit comme question
ô combien sensible : sensible car objet d'un débat
opposant cette fois clairement la gauche et la droite, sensible aussi
parce que ce débat est ouvertement idéologique, mettant
en jeu des conceptions différentes, voire concurrentes de la
communauté nationale.
Lorsque la droite revient au pouvoir, en mars 1986, l'immigration
occupe donc une place importante dans sa liste de ses priorités,
d'autant plus importante qu'elle s'est engagée à fond
sur ce point au cours de la campagne électorale, en attaquant
violemment l'attitude laxiste et irresponsable de la gauche. Le dispositif
qu'elle entend faire adopter comporte deux volets distincts mais complémentaires :
le projet qui deviendra la loi du 9 septembre 1986, dite « loi
Pasqua », sur l'entrée et le séjour des étrangers,
et le projet de réforme du code de la nationalité.
En proposant ces deux textes au vote du Parlement, le nouveau gouvernement
entend bien marquer sa différence et se démarquer de son
prédecesseur. Curieusement, pourtant, lorsqu'il s'agit de défendre
son projet, le ministre de l'Intérieur tient devant les parlementaires
un discours lénifiant, empreint d'une tonalité humaniste :
comme si une compensation s'opérait entre actes et paroles, et
comme si, après avoir pratiqué une dangereuse surenchère
verbale lorsqu'elle était dans l'opposition, la droite s'efforçait
au contraire, une fois au pouvoir et dotée des moyens d'agir,
de parler le langage de la raison. Le gouvernement, en effet, tient
à minimiser la portée des mesures qu'il propose, présentées
comme un simple renforcement des moyens de lutte contre la clandestinité,
en passant sous silence les importantes restrictions qu'il apporte aux
droits des étrangers.
De même, le projet de réforme du code de la nationalité
déposé par le ministre de la Justice devant l'Assemblée
nationale à l'automne 1986 ne reprend pas l'intégralité
des propositions formulées par la droite lorsqu'elle était
dans l'opposition, même si l'esprit de la réforme proposée
reste le même. L'exposé des motifs s'efforce là
encore de minimiser la portée du texte, illustrant parfaitement
le nouveau langage de la droite passée de l'opposition au gouvernement,
et qui adopte un « profil bas » sur le plan idéologique.
La loi, lit-on dans l'exposé des motifs, est inspirée
par le souci de « mieux respecter... les aspirations des
diverses communautés étrangères implantées
sur notre sol en vue de garder leur identité nationale et culturelle »
(on relèvera le retournement spectaculaire de la problématique,
la réforme ayant été présentée initialement
comme inspirée par le souci de protéger l'identité
nationale et culturelle de la France...). « Il convient
dès lors, poursuit le texte, de s'assurer que l'acquisition de
la nationalité française correspond à une volonté
véritable des intéressés », ce qui
suppose une modification de la législation tendant à éviter
« d'intégrer des personnes qui ne le souhaitent
pas réellement ou qui n'ont pas conscience d'être devenues
françaises ».
De façon inattendue, c'est la mobilisation d'une fraction de
l'opinion qui va, pour une fois, provoquer l'échec de la réforme.
Ni les réticences de certains à remettre en cause des
dispositions qu'on pouvait considérer, en raison même de
leur ancienneté, comme l'expression de la « tradition
républicaine », ni l'opposition déterminée
de la gauche et des milieux associatifs n'auraient suffi à faire
reculer le gouvernement. Mais celui-ci, aux prises avec un mouvement
étudiant de grande ampleur suscité par un projet de réforme
de l'université, juge opportun de faire marche arrière
lorsque les étudiants réclament à leur tour le
retrait du projet. Pour ne pas donner l'impression d'y renoncer définitivement,
il met en place une commission présidée par le vice-président
du Conseil d'Etat et qui remettra son rapport en janvier 1988. En dépit
du consensus que semblent recueillir les propositions de cette commission,
la droite, pendant les quelques mois qui lui restent à gouverner,
ne prend pas d'initiative pour les mettre en oeuvre : peut-être
juge-t-elle, malgré la dépolitisation apparente du débat
qu'ont permis les travaux de la Commission, que la question est encore
trop brûlante. Mais le rapport servira de référence
à la réforme de 1993, adoptée à un moment
où la droite semble à nouveau toute puissante.
L'impossible tactique de l'évitement
Mai 1988 marque le début d'une nouvelle alternance. Compte
tenu des protestations de la gauche contre la loi Pasqua, on pouvait
penser que son retour au pouvoir conduirait rapidement à l'abrogation
de ce texte. Or c'est l'inverse qui se produit : le gouvernement
Rocard adopte sur la question de l'immigration une tactique d'évitement,
estimant sans doute que la gauche n'a rien à gagner à
réouvrir le débat. Il s'abstient donc soigneusement de
prendre une quelconque initiative dans ce domaine, se montrant sourd
aux sollicitations des défenseurs traditionnels des droits des
étrangers. Après que le Président de la République,
dans ses voeux de Nouvel An ait annoncé une révision des
dispositions législatives « inéquitables
et injustifiées », il faut encore attendre le printemps
1989 pour que soit enfin présenté au Parlement un projet
de loi qui deviendra la « loi Joxe », finalement
promulguée le 2 août 1989, et qui revient à l'esprit
des textes votés en 1981 et 1984.
Après cet intermède législatif, le gouvernement
espère sans doute avoir évacué pour un temps la
question de l'immigration de l'agenda politique. Mais le répit
est de courte durée. La fin de l'année 1989 est marquée
par l'affaire du foulard. Le spectre de l'intégrisme islamique,
agité non seulement par la droite mais également dans
des cercles influents de la gauche, les incidents répétés
dans les banlieues, obligent le gouvernement à réagir.
Pour une fois, la question de l'immigration est abordée autrement
qu'en termes de répression. Des mesures en faveur de l'intégration
sont annoncées et de nouvelles structures sont mises en place :
un haut conseil de l'intégration, composé la fois d'experts
et d'hommes politiques de différentes sensiblités, pour
la réflexion, un secrétariat général à
l'intégration pour l'action.
Mais très vite le ton du discours s'emballe à nouveau.
Le succès du Front national à l'élection législative
partielle de Dreux en décembre 1989 a créé un choc
dans la classe politique. François Mitterrand laisse échapper
à la télévision que « le seuil de
tolérance a été atteint ». Lors des
Etats généraux de l'opposition sur l'immigration, le RPR,
exhumant ses anciens projets qu'il s'était abstenu de mettre
en oeuvre pendant la période de cohabitation, propose de réserver
les prestations sociales aux Français, tandis que Valéry
Giscard d'Estaing propose de soumettre une nouvelle loi sur la nationalité
à référendum.
L'escalade se poursuit après la nomination d'Edith Cresson
au poste de Premier ministre, en mai 1991. Jacques Chirac dénonce
une « overdose » d'immigrés en France et
s'aventure à évoquer les odeurs désagréables
aux narines françaises que dégage leur voisinage ;
Valéry Giscard d'Estaing propose, pour lutter contre « l'invasion »
dont la France est l'objet, d'abandonner le jus soli au profit
du seul jus sanguinis pour l'attribution de la nationalité
française. On assiste alors à la répétition
exacte d'un scénario déjà expérimenté
entre les municipales de 1983 et les législatives de 1986 :
à la surenchère des discours répond la fuite en
avant du gouvernement qui s'inquiète de la baisse d'audience
de la gauche à l'approche des échéances électorales
et qui cherche donc à frapper l'opinion en recherchant l'effet
d'annonce sur la question décidément sensible de l'immigration.
C'est ainsi qu'au début de l'été 1991 est annoncé
et mis en place un nouveau train de mesures tendant à la « maîtrise
de l'immigration ».
A droite, toute...
Le durcissement du discours et des pratiques en matière d'immigration
ne suffit pas à sauver la gauche de la déroute électorale.
Les élections législatives de mars 1993 ramènent
donc au pouvoir une droite plus puissante que jamais qui s'empare précipitamment
de la question de l'immigration en faisant voter par le Parlement deux
textes : la réforme du code de la nationalité d'une
part, la « loi
Pasqua » qui modifie à nouveau les conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France dans le sens d'une
sévérité encore accrue par rapport à 1986,
d'autre part.
Le bon accueil fait au rapport demandé à la Commission
de la nationalité pendant la première cohabitation, considéré
comme un texte modéré et de consensus, permet au gouvernement
de faire adopter cette fois sans difficulté la réforme
du code de la nationalité. La légitimité de la
réforme étant étroitement liée à
la légitimité reconnue aux propositions de la Commission,
le gouvernement s'efforce d'en minimiser la portée en la présentant
comme une simple adaptation des règles en vigueur, et de coller
au mieux à la problématique dégagée par
la Commission. Il va répétant qu'il ne faut pas confondre
la question de la nationalité et celle de l'immigration, que
le texte n'a d'autre objet que de renforcer l'identité nationale
pour permettre de mieux intégrer les étrangers qui le
désirent et auxquels il est normal et sain de demander qu'ils
manifestent leur volonté de devenir français, conformément
à la conception élective, et proprement française,
de la nation.
La lecture des débats parlementaires montre que l'ombre de
la Commission plane sur les hémicycles, députés
et sénateurs s'efforçant à leur tour de se tenir
au plus près de cette problématique imposée. Mais
ils n'y parviennent pas toujours : comme on pouvait s'y attendre
sur une question aussi pétrie d'idéologie, la discussion
parlementaire est l'occasion de quelques dérapages. A l'arrière-plan
des débats se profile la figure de l'étranger délinquant,
de l'étranger fraudeur, du clandestin — et plus nettement
encore le spectre de l'Islam. Car s'il convient de demander désormais
aux personnes nées et élevées en France une marque
d'adhésion explicite à la nation française avant
qu'ils puissent être considérés comme Français,
c'est bien parce que désormais ces étrangers, issus d'une
autre civilisation, sont réputés plus difficilement assimilables.
Si elle combat avec conviction la réforme du code de la nationalité,
la gauche ne livre en revanche que mollement bataille contre la loi
Pasqua, convaincue qu'il n'est pas payant, électoralement, de
s'élever contre des mesures présentées à
l'opinion comme destinées à renforcer la lutte contre
l'immigration clandestine. Par la suite, on ne l'entendra guère
non plus protester face aux situations dramatiques qu'engendrent des
textes excessivement rigoureux mis en oeuvre avec une brutalité
extrême.
La gauche institutionnelle se désintéresse également
des mouvements de « sans-papiers » qui commencent
à prendre de l'ampleur au printemps 1996. Elle ne se manifeste
qu'à partir du moment où un courant de sympathie se dessine
dans l'opinion en faveur des sans-papiers. La mobilisation culmine le
28 septembre : après l'évacuation par la force, à
la fin du mois d'août, de l'Eglise Saint-Bernard, les syndicats,
partis et associations appellent à une manifestation unitaire
au cours de laquelle 15.000 personnes défilent dans les rues
de Paris.
Mais lorsque, en novembre 1996, le gouvernement dépose un nouveau
projet de loi qui,
tout en ouvrant la voie à la régularisation de certaines
catégories de sans-papiers, renforce encore la dimension répressive
de la législation en vigueur, les députés socialistes,
en majorité absents de l'hémicycle, se font surtout remarquer
par leur peu d'empressement à combattre le projet. Cette fois
encore, c'est la mobilisation
— inattendue — d'une partie de l'opinion qui l'oblige
à sortir de son attentisme prudent. La disposition du projet
de loi qui oblige les personnes hébergeant des visiteurs étrangers
à déclarer à la préfecture le départ
de ces visiteurs est interprétée comme une incitation
à la délation et dénoncée dans des pétitions
qui recueillent des dizaines de milliers de signatures. Cette fois la
gauche parlementaire ne peut faire autrement que de suivre le mouvement :
en seconde lecture députés et sénateurs se livrent
à de virulentes
attaques contre le texte gouvernemental (qui sera néanmoins
adopté,
à l'exception de la disposition contestée retirée
par le gouvernement).
Le juste milieu : du « ni-nisme »
au « consensus républicain »
Confronté à cette opposition momentanément combative,
le ministre de l'Intérieur va alors s'efforcer de démontrer
que son texte est équilibré en recourant au procédé
rhétorique bien connu du « ni-nisme », jadis
décrit par Roland Barthes dans Mythologies. Fondé
sur une « mécanique de la double exclusion »,
il vise à se présenter comme étant à égale
distance des extrêmes et comme ayant de ce fait nécessairement
raison.
« L'économie générale du texte,
déclare le ministre de l'Intérieur devant le Parlement,
tient en équation simple : oui à l'immigration régulière,
non à l'immigration irrégulière. Les dispositions
qu'il contient ne font que tirer les conséquences pratiques de
cette affirmation, avec pragmatisme et sans dogmatisme, avec mesure
et sans excès, avec fermeté et sans inhumanité,
en un mot, avec le souci de l'équilibre qui nous distingue,
qui distingue la majorité des extrémistes de tous
bords [...]. D'un côté des pétitions
qui fleurissent, d'autant plus nourries que les problèmes concrets
sont largement méconnus. De l'autre des discours truffés
de références à l'inégalité des races
et le rêve d'une France ethnique si contraire à l'âme
même de notre nation ».
Le ni-nisme, comme l'ont montré Pierre Bourdieu et Luc Boltanski,
est une des figures privilégiées de la rhétorique
politique qui aime à cultiver l'idée du juste milieu.
Le procédé est d'usage commode pour imposer la légitimité
d'un choix ou accréditer le bien-fondé d'une politique.
D'autant que le milieu n'étant jamais que la double négation
des extrêmes, il est facile, en manipulant ces extrêmes,
de produire une fausse symétrie et de dégager une position
moyenne, médiane, modérée, parée de toutes
les vertus.
Avec des nuances, la stratégie utilisée par le ministre
de l'Intérieur de la gauche, une fois celle-ci revenue au pouvoir
en 1997, n'est pas foncièrement différente, dans son ambition
de parvenir à un consensus — qu'il baptisera de « républicain » —
avec la droite sur une politique « raisonnable »
de l'immigration à égale distance des extrêmes.
Au départ, certes, le gouvernement est contraint de tenir compte
du contexte dans lequel la gauche a remporté les élections :
parce que l'émotion qui, en février 1997, s'est emparée
de larges couches de la population, venant après le mouvement
de sympathie pour les sans-papiers, n'a sans doute pas été
étrangère à la défaite de la droite, il
décide très vite d'engager une opération de régularisation
et de mettre en chantier d'une nouvelle réforme de la législation.
Mais en même temps on prend soin de minimiser la portée
de ces initiatives. Il ne faut « ni laxisme, ni repli
frileux », déclare Jean-Pierre Chevènement
au journal Le Monde au lendemain de la parution de la circulaire
annonçant des régularisations, ajoutant : « Je
suis convaincu qu'il y a place pour une politique d'immigration généreuse
mais ferme, conforme à l'intérêt national, sur laquelle
le consentement d'une immense majorité de nos concitoyens peut
être réuni ».
Au début du mois de juillet, le gouvernement confie à
Patrick Weil la mission de proposer des règles « simples,
réalistes et humaines » pour l'entrée et
le séjour des étrangers en France, « dans
le cadre d'une politique de l'immigration ferme et digne, sans renier
nos valeurs et sans compromettre notre équilibre social ».
Sur la base de ce
rapport, jugé « équilibré »
par le gouvernement, deux projets de loi, l'un portant sur la nationalité,
l'autre sur l'entrée et le séjour, sont adoptés. Le
gouvernement renonce de facto à abroger les lois Pasqua
et Debré.
Se souciant peu de décevoir ceux qui attendaient qu'il tienne
l'engagement pris pendant la campagne électorale — avec
beaucoup de réticence il est vrai — d'abroger ces textes,
a fortiori ceux qui auraient souhaité une véritable
rupture avec la politique suivie depuis plus de vingt ans, le gouvernement
fait en effet le pari d'un consensus possible transcendant les clivages
politiques sur les principales orientations de la politique d'immigration.
« Il faut en finir avec les surenchères polémiques
qui dissimulent souvent un consensus implicite entre la droite et la
gauche républicaine, déclare encore Jean-Pierre Chevènement.
Aucun parti représenté à l'Assemblée
nationale ne s'oppose à la maîtrise des flux migratoires.
Nul ne conteste la nécessité de stabiliser, voire d'intégrer,
les immigrés durablement établis de notre sol. »
La stratégie consiste donc à faire adopter le plus rapidement
possible des réformes législatives limitées, sur
lesquelles on espère obtenir au minimum la neutralité
de la droite, pour pouvoir ensuite mettre de côté la question
de façon à ce qu'elle n'envenime plus le débat
politique. Et devant le Parlement, le ministre de l'Intérieur
cultive à son tour la figure du ni-nisme : « Certains
intervenants ont trouvé le projet laxiste, d'autres trop répressif.
Où est la vérité ? Nul n'est infaillible,
mais je crois que nous sommes à peu près parvenus à
mettre le curseur au bon endroit »
Cette stratégie échoue : malgré le caractère
modéré du projet présenté la droite ne se
laisse pas convaincre d'adhérer aux réformes proposées.
Non pas que celles-ci lui paraissent par elles-mêmes inacceptables,
mais elle refuse par principe le consensus sur l'immigration dont elle
n'a pas renoncé à faire un enjeu de dispute.
Malgré cet échec, ce n'est pas avec la droite que la
gauche entend croiser le fer. Le combat principal, elle le livre aux
« extrêmistes » de son propre camp, aux « utopistes »
et aux « irresponsables » qui, s'interrogeant sur
la pertinence de la politique menée depuis vingt-cinq ans, demandent
un véritable débat sur la politique d'immigration qui
ne récuserait pas par avance l'hypothèse de l'ouverture
des frontières.
Au lendemain des élections régionales de mars 1998 et
des douteuses alliances auxquelles elles ont donné lieu, ce n'est
pas la droite qui est accusée de faire le jeu du Front national
mais les sans-papiers qui, en désespoir de cause, recommencent
à occuper les églises comme du temps de Debré ou
les militants qui tentent d'entraver la mise en oeuvre des mesures de
reconduite à la frontière. Quelle impression peut-on tirer
de cette chronique, sinon que l'immigration est décidément
une question trop sensible pour faire l'objet d'un véritable
traitement politique ? La « maîtrise des flux migratoires »
est plus un slogan qu'une politique : elle repose sur l'illusion
— dont personne n'est dupe — qu'il est possible
de contrôler vraiment les frontières. Elle conduit à
donner la priorité à la répression de l'immigration
irrégulière au détriment de l'intégration,
sans voir ou en faisant semblant de ne pas voir que les problèmes
liés à l'immigration résultent moins de l'existence
des « clandestins » que du déficit de mesures
qui auraient permis d'intégrer la population immigrée
dans la cité et d'éviter que ne se cristallisent craintes
et fantasmes : ces craintes et ces fantasmes que l'on brandit ensuite
pour justifier de nouvelles mesurs répressives.
Car la lutte contre l'immigration clandestine est censée répondre
aux craintes et aux attentes de l'opinion publique. Mais à force
d'aller au devant de ce qu'ils pensent être les attentes de l'opinion
publique, non seulement les hommes politiques faillissent à leur
mission mais ils entretiennent et même confortent les dérives
xénophobes qu'ils prétendent conjurer.
Si le Front national continue à être marginalisé
sur l'échiquier politique officiel, depuis quinze ans son ombre
plane sur la politique d'immigration. A défaut d'imposer entièrement
ses vues, il a imposé une problématique — une
problématique purement négative, qui a empêché
de traiter la question de l'immigration autrement qu'en termes protectionnistes
et policiers.

Dernière mise à jour :
23-05-2000
22:44.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/presse/1998/lochak/question-2.html
|



 En ligne
En ligne


 En ligne
En ligne
