|
|
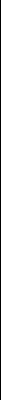
|
La politique de l'immigration au prisme
de la législation
sur les étrangers
par Danièle Lochak
Page 1 | Page
2
Texte publié dans « Les lois de l'inhospitalité »,
La Découverte, 1997. Reproduction interdite
sauf pour usage personnel.
Si le droit ne peut pas, à lui seul, rendre compte des politiques
d'immigration, il n'en fournit pas moins une clé d'analyse précieuse
pour étudier ces politiques et repérer leurs évolutions.
Plus que dans aucun autre domaine, en effet, la législation est
ici directement et immédiatement subordonnée à
des considérations qui reflètent fidèlement les
buts et les moyens des gouvernants en la matière, mais aussi
les aléas de la conjoncture politique et les variations de l'opinion
publique.
On peut par conséquent lire l'histoire récente des politiques
d'immigration à travers les changements de la législation
sur les étrangers.
Du contrôle policier
au contrôle de la main-d'oeuvre
Pendant longtemps, l'entrée et le séjour des étrangers
n'ont fait l'objet d'aucune mesure de contrôle a priori.
Lorsqu'un étranger était considéré comme indésirable
parce que représentant un danger pour l'ordre public, le problème
se réglait en aval, par l'expulsion : dans ce domaine, les
autorités jouissaient d'un entier pouvoir discrétionnaire
que même la loi du 3 décembre 1849, qui pour la première
fois visait à encadrer la procédure d'expulsion, n'avait
guère limité.
Le décret du 2 octobre 1888 impose pour la première
fois aux étrangers séjournant en France une déclaration
de résidence à la mairie. Cinq ans plus tard, la loi du
9 août 1893 perfectionne le système en instituant un registre
d'immatriculation des étrangers dans chaque commune et en obligeant
les personnes logeant des étrangers à en signaler la présence
dans les vingt-quatre heures.
On passe du régime de la déclaration à celui
de l'autorisation avec l'instauration, pendant la Première Guerre
mondiale, de la carte d'identité d'étranger. Prévue
par une circulaire de juin 1916, officialisée par un décret
du 2 avril 1917, elle est directement inspirée par des considérations
de police. Cette carte, délivrée par le préfet,
et que doit posséder tout étranger de plus de 15 ans appelé
à séjourner plus de quinze jours en France, doit être
visée à chaque changement de résidence, de façon
à contrôler la présence et le déplacement
des étrangers sur le territoire. Le décret du 21 avril
1917 vient préciser, s'agissant des travailleurs, que la carte
d'identité est délivrée sur présentation
d'un contrat d'embauche visé par les services de placement.
Ce système va être par la suite aménagé
en vue de permettre de contrôler non seulement le séjour
mais aussi l'emploi des étrangers. La loi du 11 août 1926
impose à l'étranger qui veut travailler en France d'être
en possession d'une carte d'identité portant la mention « travailleur »,
établie au vu d'un contrat de travail ; de leur côté,
les employeurs n'ont pas le droit d'embaucher un travailleur qui n'est
pas muni de cette carte. La réglementation sera appliquée
de façon très variable en fonction du contexte économique
et politique : libérale dans les périodes de plein
emploi, rigoureuse en période de crise. Mais elle reste encore
assez rudimentaire et ne permet en aucune façon aux pouvoirs
publics de s'assurer une quelconque maîtrise de l'immigration ;
tel n'est d'ailleurs pas son objet et, sauf pendant une brève
période qui suit la Première Guerre mondiale, l'Etat reste
cantonné dans un rôle de police tandis que ce sont les
associations patronales, regroupées dans la Société
générale d'immigration, qui détiennent le monopole
de fait de l'immigration organisée.
Dans le contexte de crise dû à l'approche de la Seconde
Guerre mondiale, le gouvernement entreprend une refonte importante de
la réglementation existante avec le décret-loi du 2 mai
1938, complété ou modifié à plusieurs reprises
dans les mois qui suivent, notamment par le décret-loi du 12
novembre 1938. Ces textes tissent une surveillance policière
intense autour de chaque étranger ; mais au-delà
de leur contenu nettement répressif, ils représentent
la première tentative pour réglementer tous les aspects
de l'entrée et du séjour des étrangers en France :
l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'en inspirera sur beaucoup de points.
1945 : rupture et continuité
1945 semble représenter une rupture avec la période de l'entre-deux-guerres
car on trouve à la Libération une volonté politique
clairement affirmée, concrétisée par un ensemble
législatif et réglementaire complet et cohérent,
de contrôler l'immigration au lieu de l'abandonner aux fluctuations
de l'offre et de la demande et aux initiatives du patronat. Mais la rupture
est plus apparente que réelle.
D'abord parce que lorsqu'on compare les dispositions de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour
des étrangers en France avec celles du décret-loi du 2 mai
1938, on constate des ressemblances frappantes entre les deux textes.
L'ordonnance de 1945 se borne à gommer ou atténuer l'effet
des dispositions les plus sévères précédemment
en vigueur : elle n'est pas et n'a jamais été un
texte libéral ; c'est une loi de police qui conserve un
régime de contrôle et de répression.
Ensuite parce que la volonté d'encadrer l'immigration de main-d'oeuvre
a été très vite prise en défaut. L'ordonnance
de 1945 contenait aussi une réglementation stricte du travail.
Elle conférait à l'Office national d'immigration (ONI)
le monopole du recrutement et de l'introduction en France des travailleurs
étrangers et subordonnait le droit au séjour à
la production d'un contrat de travail dûment visé par les
services de l'emploi. Mais très vite l'immigration s'est échappée
du cadre institutionnel prévu et s'est laissée porter
par les besoins économiques. Jusqu'à la fin des années
soixante, les besoins de main-d'oeuvre sont tels que la réglementation
n'est guère respectée. En dépit des textes, les
travailleurs étrangers entrent en France sous couvert d'un simple
passeport de touriste, ou même clandestinement ; ils trouvent
sans peine à s'embaucher et obtiennent ensuite aisément
les documents — carte de séjour et carte de travail —
qui régularisent leur situation.
Une proportion croissante d'étrangers échappent au demeurant
à ce monopole de plus en plus théorique de l'ONI :
les Italiens, en tant que ressortissants de la Communauté économique
européenne (CEE), les Algériens, auxquels, même
après l'indépendance, les accords d'Evian reconnaissent
la liberté de circulation et d'établissement ainsi que
l'égalité des droits avec les Français, les Africains
de l'ancienne Communauté, bénéficiaires eux aussi
de la liberté d'établissement.
Autrement dit, le dispositif législatif, à l'évidence
inadapté, reste inappliqué, sans que cela semble gêner
les autorités politiques et administratives.
L'immigration dite « sauvage », mais en fait
encouragée par les pouvoirs publics aussi longtemps qu'elle répond
aux besoins immédiats de l'économie française,
ne commence à apparaître comme un problème qu'à
partir du moment où l'on enregistre les premières tensions
sur le marché de l'emploi, à la fin des années
soixante. Le Vè Plan préconise un contrôle
de l'immigration spontanée ; et en 1968, alors que le taux
des régularisations représente 82 % des admissions
au séjour, un premier coup d'arrêt est donné à
la procédure de régularisation. En 1972, les circulaires
dites Marcellin-Fontanet — respectivement ministres de l'Intérieur
et du Travail — interdisent pour l'avenir la régularisation
des travailleurs entrés en France sans être munis d'un
contrat de travail. Elles entraînent les premières luttes
des « sans-papiers » : entre octobre 1972
et janvier 1975, on comptera une vingtaine de grèves de la faim
dans 17 villes de France ; le gouvernement refuse d'abord de céder,
puis finit par accepter des « régularisations »
au cas par cas.
1974 : la fermeture des frontières
Deux ans plus tard, à la suite du « premier choc pétrolier »,
les pouvoirs publics décident de suspendre l'immigration de travailleurs.
Va alors s'instaurer progressivement, au nom de la « maîtrise
des flux migratoires » et à mesure que la situation
de l'emploi se dégrade, un contrôle de plus en plus sévère
sur les étrangers.
Car maîtriser les flux, cela veut dire, après avoir décidé
de stopper toute immigration de travailleurs : fermer les frontières
et instaurer des contrôles draconiens à l'entrée
du territoire, sans trop d'égards pour la liberté de circulation
et au risque de compromettre l'exercice du droit d'asile ; puis
contraindre au départ ceux qui sont entrés et se sont
maintenus irrégulièrement sur le territoire, ce qui suppose,
pour les repérer, d'organiser des contrôles d'identité
à grande échelle qui ne peuvent manquer de désigner
l'ensemble des étrangers comme objet de suspicion à l'opinion
publique ; s'efforcer enfin de colmater toutes les brèches
par où les « flux » pourraient encore pénétrer,
en entravant l'arrivée des familles, des étudiants, des
demandeurs d'asile, des simples touristes, des conjoints de Français,
soupçonnés d'être de faux étudiants, de faux
demandeurs d'asile, de faux touristes, des conjoints de complaisance...
L'accession de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence
de la République coïncide avec les premières retombées
économiques du choc pétrolier. Tout au long de son septennat,
l'étau va se resserrer sur la population immigrée, sous
le double effet de l'extension du chômage et du développement
de l'idéologie sécuritaire.
Une série de mesures restrictives sont adoptées dès
le début : blocage de l'immigration des travailleurs, et
même des familles entre octobre 1974 et juillet 1975, contrôle
accru aux frontières, refus de toute régularisation pour
les étrangers déjà en France, suppression du régime
de la libre circulation pour la plupart des ressortissants des Etats
africains de l'ancienne Communauté qui en bénéficiaient
jusque-là. Parallèlement, on introduit dans le code du
travail une disposition prévoyant que la délivrance des
autorisations de travail pourra être refusée pour des motifs
tirés de la situation de l'emploi (décret du 21 novembre
1975).
A partir de 1977, ces aménagements apparaissent comme insuffisants.
Le secrétaire d'Etat au Travail manuel, Lionel Stoléru,
attachera son nom à une politique d'extrême rigueur, dont
l'objectif n'est plus seulement de stopper l'immigration mais d'obtenir
une diminution de la population étrangère résidant
en France (il escompte le départ d'environ 35 000 personnes
par an). Il s'agit d'abord d'encourager les retours volontaires par
l'instauration d'une « aide au retour » (circulaire
de juin 1977), mais aussi de ne plus procéder au renouvellement
systématique des autorisations de travail, le non-renouvellement
entraînant la perte du droit au séjour (circulaire du 10
juin 1980). Le regroupement familial, considéré comme
générateur de demandes d'emploi supplémentaires,
est lui aussi restreint : un an et demi après qu'un décret
du 29 avril 1976 ait posé pour la première fois en principe
le droit de l'étranger à faire venir sa famille, sous
certaines conditions de ressources et de logement, le gouvernement décide
d'en suspendre l'application pour trois ans : le décret
du 10 décembre 1977 n'autorise l'entrée des membres de
la famille que s'ils s'engagent à ne pas occuper un emploi salarié
(le décret sera annulé par le Conseil d'Etat un an plus
tard, sur le recours du Gisti, de la CFDT et de la CGT, comme violant
le droit de mener une vie familiale normale reconnu aux étrangers
comme aux nationaux).
Mais le dispositif ainsi mis en place, inspiré par des préoccupations
économiques, ne se suffit pas à lui seul, dans la mesure
où l'on ne peut espérer que les étrangers en situation
irrégulière partiront spontanément : il faut
donc se donner les moyens de les contraindre à partir et compléter
le volet « emploi » de la politique d'immigration
par un volet « policier ». Ce sera l'objet de
la loi du 10 janvier 1980, dite loi Bonnet, qui modifie pour la première
fois de façon substantielle l'ordonnance de 1945. Elle rend plus
strictes les conditions d'entrée sur le territoire ; elle
fait de l'entrée ou du séjour irréguliers un motif
d'expulsion au même titre que la menace pour l'ordre public, et
permet par conséquent d'éloigner du territoire les « clandestins »
ou ceux dont le titre de séjour n'a pas été renouvelé ;
enfin, elle prévoit la double faculté de reconduire l'étranger
expulsé à la frontière et de le détenir
dans un établissement pénitentiaire pendant un délai
pouvant aller jusqu'à sept jours s'il n'est pas en mesure de
quitter immédiatement le territoire, donnant ainsi un fondement
légal à des pratiques qui s'opéraient jusque-là
en marge de la loi. La loi Peyrefitte, adoptée en février
1981, parachève le dispositif de contrôle policier sur
la population immigrée en légalisant les contrôles
d'identité à titre préventif.
Le gouvernement n'hésitera pas à l'utiliser à
plein, en procédant à des expulsions massives d'étrangers
en situation irrégulière, dans le cadre de la lutte contre
« l'immigration clandestine », mais aussi à des
expulsions systématiques pour des délits mineurs, dans
le cadre de sa campagne pour la « sécurité »
des Français : la loi Bonnet, indistinctement tournée
vers la répression des clandestins et des délinquants,
favorise l'amalgame entre immigration et clandestinité et entre
clandestinité et délinquance.
1981 : un état de grâce de courte
durée
La victoire de la gauche en mai 1981 semble ouvrir une ère nouvelle
pour les étrangers résidant en France. C'est en termes de
rupture, en effet, que s'inaugure la politique de la gauche en matière
d'immigration : rupture avec la logique économique qui voit
dans la population immigrée avant tout un réservoir de main
d'oeuvre ; rupture avec la logique sécuritaire qui considère
tout étranger comme un délinquant en puissance et entend
sanctionner le moindre écart par l'expulsion. Le nouveau discours
gouvernemental se traduit immédiatement par des actes concrets :
les expulsions en cours sont suspendues et les arrêtés d'expulsion
pris sur le fondement des dispositions contestées de la loi Bonnet
sont abrogés ; plusieurs circulaires viennent assouplir les
conditions du regroupement familial, en permettant notamment l'admission
au séjour des membres de famille résidant déjà
en France ; l'aide au retour instaurée par Stoléru,
symbole d'une politique désormais récusée, est supprimée.
Parallèlement, une procédure de régularisation exceptionnelle
est engagée : il s'agit, pour apurer le passé, de permettre
aux étrangers en situation irrégulière mais qui sont
entrés en France avant le 1er janvier 1981 et qui occupent un emploi
stable d'obtenir une carte de séjour. L'opération se révélera
plus complexe que prévu et nécessitera plusieurs réajustements
successifs ; elle aboutira finalement à la régularisation
d'environ 130.000 personnes.
Dans le même temps, le gouvernement entreprend de modifier la
législation dans un sens plus libéral. La loi du 9 octobre
1981 supprime le régime dérogatoire des associations étrangères
institué par le décret-loi de 1939, qui subordonnait la
constitution de de ces associations à l'autorisation du ministre
de l'Intérieur (la réforme donnera un élan spectaculaire
au développement du mouvement associatif immigré). La
loi du 27 octobre 1981 abroge les dispositions de la loi Bonnet
et introduit dans l'ordonnance une série de garanties nouvelles
et importantes : l'expulsion ne peut être prononcée
que si l'étranger a été condamné à
une peine au moins égale à un an de prison ferme ;
les garanties de procédure entourant l'expulsion sont accrues ;
les étrangers en situation irrégulière ne peuvent
être reconduits à la frontière qu'après un
jugement et non plus par la voie administrative ; les étrangers
mineurs ne peuvent plus faire l'objet d'une mesure d'éloignement,
et ceux qui ont des attaches personnelles ou familiales en France ne
peuvent être expulsés qu'en cas d'urgence absolue, lorsque
la mesure constitue « une nécessité impérieuse
pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité
publique ».
Toutes ces mesures indiquent un changement d'attitude radical vis-à-vis
de la population immigrée : on ne parle plus de renvoyer
chez eux ceux qui sont au chômage, mais on proclame au contraire
le droit de demeurer pour les immigrés installés en France.
La loi du 17 juillet 1984 viendra ultérieurement concrétiser
la reconnaissance du caractère durable de l'installation en France
de la population immigrée et la dissociation du droit au séjour
d'avec l'occupation d'un emploi : en créant une carte de
résident qu'a vocation à obtenir tout étranger
qui réside en France régulièrement depuis plus
de trois ans et qui est délivrée de plein droit à
tous ceux qui ont des attaches personnelles ou familiales en France,
en reconnaissant au titulaire de cette carte, valable dix ans et renouvelable
automatiquement, le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire la
profession de son choix, cette loi opère dans le droit de l'immigration
une rupture dont la portée symbolique est aussi importante que
la portée pratique : elle signifie que la population immigrée
n'est plus considérée comme un volant de main-d'oeuvre
mais comme une composante de la société française.
Pour spectaculaire qu'elle soit, la rupture avec le passé ne
saurait masquer la continuité du raisonnement et des pratiques
sur un certain nombre de points. Le contrôle aux frontières
est non seulement maintenu mais renforcé et la lutte contre l'immigration
clandestine reste un objectif prioritaire. Les peines encourues pour
entrée et séjour irréguliers sont aggravées,
et la loi maintient en vigueur deux dispositions parmi les plus contestées
de la loi Bonnet : la faculté de reconduire de force à
la frontière l'étranger expulsé, et la possibilité
de « maintenir » les étrangers en instance de départ
forcé dans des locaux placés sous surveillance policière
(« centres de rétention » ou locaux de police)
jusqu'à leur départ effectif.
Lire la
suite

Dernière mise à jour :
29-11-2000 11:28.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/presse/1997/lochak/politique.html
|



 En ligne
En ligne


 En ligne
En ligne
