|
|
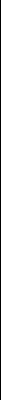
|
Migrants : libre circulation
et lutte contre la précarité (2)
Alain Morice
Page 1
| Page 2
Quant à la question de la « prévention économique »,
l'auteur s'étonne comme beaucoup d'autres que, dès lors
« que la lutte contre le chômage
est une priorité », la question de l'« assèchement
progressif du marché du travail irrégulier »
soit totalement négligée (p. 147). L'historien s'efface
ici devant le citoyen car, comme nous tentons de le démontrer ici,
la complaisance des pouvoirs publics pour le travail clandestin, si détestable
soit-elle, n'a rien d'étonnant. Il s'agit d'un phénomène
trop universel pour qu'on puisse le traiter de manière volontariste
avant d'en analyser les causes. P. Weil propose une négociation
entre les syndicats professionnels des secteurs concernés avec
les administrations compétentes. Pourtant, de nombreuses conventions
de partenariat existent déjà, aussi belles qu'inappliquées.
Mais là n'est pas la proposition essentielle de l'auteur, qui
énonce la nécessité de « briser
des tabous et des réglementations » pour substituer
les travailleurs résidents aux étrangers irréguliers
sur le marché du travail (p. 147-148). Il faudrait, précise-t-il,
que les employeurs aient « intérêt »
à offrir des « travaux à
des chômeurs, à des jeunes, à des étudiants
plutôt qu'à des illégaux ». Le dispositif
se compléterait d'exonérations de charges sociales et
fiscales (« tout devrait être envisagé »).
Ce qu'il propose ainsi, c'est donc un alignement du coût
du travail moyen sur celui du travail clandestin — sinon,
les employeurs n'y auraient aucun intérêt —, le chômage
national servant de prétexte à cette baisse tendancielle :
ce ne serait rien d'autre que le blanchiment généralisé
du travail au noir combiné au subventionnement croissant de l'économie
par l'État. On voit trop où cela pourrait mener :
après avoir opéré cette substitution (si tant est
que cela soit possible car il n'est pas certain que les jeunes chômeurs
ou Rmistes soient tentés par ce marché de dupes), le patronat
se tournerait à nouveau vers les embauches illégales,
à un prix encore moindre.
Un autre dispositif emporte l'agrément de l'auteur : c'est
celui du travail saisonnier par quotas tel qu'il existe dans l'agriculture
allemande [17]. Le débat sur
les quotas dépasserait le cadre de ce texte, mais certaines phrases
de P. Weil peuvent surprendre : c'est ainsi que, à
l'heure où l'Afrique du Sud s'est débarrassée du
sinistre procédé des passes, il entreprend l'éloge
du système des Grenzarbeitnehmer, ces travailleurs est-européens
qui « peuvent travailler tous les jours
dans une zone de cinquante kilomètres à l'ouest de la
frontière allemande, à condition qu'ils rentrent
chaque soir chez eux ou qu'ils ne travaillent que les week-ends »
(moins gâtés par les hasards de la géographie, nous
faudra-t-il imposer à nos saisonniers le franchissement quotidien
des Pyrénées ou de la Méditerranée ?)
; ou encore de ce statut permettant « à
des compagnies étrangères de venir honorer des contrats
en Allemagne en y important leurs travailleurs »
(p. 148, soul. par nous). Ce dernier statut n'est pas, par nature,
quant à l'enfermement et aux abus qu'il permet, différent
d'un autre : celui de l'extraterritorialité des ambassades
étrangères, qui leur permet parfois de maintenir leur
personnel « importé » dans un état
a-juridique proche de la servitude. Non, il n'est pas vrai que « tout
vaut mieux que le développement des migrations illégales »
(ibid).
Enfin, le troisième volet de la « nouvelle politique »
de prévention est la « coopération internationale »,
oùil faut distinguer celle avec les pays de l'Union européenne
et celle avec les pays d'émigration. Le lecteur qui se reportera
au texte verra que, pour la première, rien de nouveau n'est proposé,
si ce n'est « l'implantation aux frontières
communes de brigades intereuropéennes composées de fonctionnaires
de plusieurs nationalités » (p. 151) —
ce qui existe déjà [18].
Quant à la seconde, il paraît un peu usurpé de la
qualifier de « coopération », tant la suggestion
de P. Weil ressemble à celle d'une intimidation érigée
en principe. Il est bien connu, comme il le rappelle, que certains pays
d'origine « coopèrent très
difficilement » à reconnaître leurs ressortissants
(sous-entendu : ceux qui ont perdu ou feint de perdre leurs passeports
et qui, de ce fait, sont protégés de l'éloignement
par une situation qui s'apparente à une apatridie de facto).
Mais il est également bien connu que nombre de ces pays, dont le
budget est tenu à bout de bras par le Trésor public français,
n'ont d'indépendant que le titre formel. Alors, que doit-on penser
de cette idée selon laquelle « une
bonne coopération internationale est beaucoup plus efficace que
toute mesure de police, notamment avec les pays qui bénéficient
de notre coopération financière »
(ibid, soul. par nous) ? En clair, cela se traduit ainsi :
« Si vous ne voulez pas récupérer vos émigrés
(et — pourquoi pas ? — si vous ne les retenez pas), on
vous coupe les vivres ». Cette ultime proposition est-elle dictée
par le respect, sinon de « nos
intérêts », du moins de « nos
valeurs », comme il est dit ailleurs (p. 146, soul.
par nous) ?
Concluons ainsi sur ce point : la politique proposée par
P. Weil n'est pas « nouvelle » [19].
Si elle reproduit les ambiguïtés et les désordres
de l'actuelle, ce n'est pas l'effet d'une complicité idéologique
de l'auteur puisque c'est l'indignation devant ses effets malins sur
le corps social qui dicte sa démarche. Mais c'est parce qu'il
ne peut pas en être autrement. La politique d'immigration de notre
pays est plus fonctionnelle et cohérente qu'il n'y paraît,
à condition d'accepter de faire une séparation entre les
intentions affichées et les motifs réels. L'assimilation
de tous les étrangers aux seuls irréguliers, si justement
dénoncée par P. Weil, ne se réduit pas à
un sordide calcul électoraliste. Elle a pour fonction de fragiliser
l'ensemble des immigrés et même de leurs descendants dans
la société civile et de tracer un chemin expérimental
— un véritable « boulevard », cette
fois aussi — vers la précarisation d'une part croissante
de la population laborieuse. Nous tenterons à présent
de montrer en quoi il n'y a pas de « problème »
spécifique de l'immigration.
Avant d'être (pour nous) un principe démocratique qui ne
devrait souffrir aucune restriction, la libre circulation des hommes est
en soi et par définition un mot d'ordre de l'économie libérale.
Une minorité d'analystes, en général proches de la
sphère patronale, avancent ainsi deux arguments en faveur d'une
plus grande ouverture des frontières. Tout d'abord, on fait remarquer
que dans le monde contemporain, tout circule librement : argent,
marchandises, information ; ce serait donc une anomalie que cette poche
persistante de protectionnisme entravant seulement les mouvements humains.
Ensuite, certaines prospectives annonçant une prochaine reprise
de la croissance, la France pourrait bien avoir alors besoin de bras supplémentaires,
au vu du vieillissement de sa pyramide des âges [20].
Moins explicitement, ces thèses se complètent parfois du
souci d'assurer, même en période de sous-emploi, une plus
grande « souplesse » sur le marché de travail
en constituant une réserve de main-d'oeuvre dans les secteurs sensibles
à la conjoncture. Nous ne faisons pas nôtre cet argumentaire
mais nous le trouvons symptomatique de ce que la règle de l'« immigration
zéro » ne trouve pas nécessairement sa source
dans l'intérêt bien senti des entrepreneurs : la crainte
d'ouvrir les frontières se présente avant tout comme une
manifestation idéologique.
Et l'on doit bien noter ceci : dans l'ensemble, le patronat reste
étonnamment silencieux sur la question de l'immigration, comme
s'il trouvait avantage à voir se perpétuer l'actuelle
réglementation qui autorise de facto les flux tout en
les interdisant, et comme si cette situation bâtarde était
le summum du libéralisme.
Une réflexion sur l'ouverture des frontières ne
saurait écarter de son champ une analyse globale du libéralisme
économique, dont l'expression la plus accomplie se trouve
dans la politique des institutions de Bretton Woods. En matière
de migrations internationales, la doctrine du FMI se met en porte-à-faux.
Si le principe de la libre circulation en découle, son action dans
le monde donne cependant deux effets cumulatifs qui poussent les pays
riches à vouloir se prémunir toujours plus contre ce qu'il
est convenu officiellement d'appeler le « risque »
migratoire. D'une part, ces pays sont incités à baisser
le coût du travail et à livrer leurs propres populations
au chômage en mettant les pays dominés en concurrence pour
produire les biens qu'ils consomment. D'autre part, cette stratégie
induit une politique de prix, d'« aide » et de crédits
affameuse et génératrice d'un détournement généralisé
des richesses dans les pays dominés. Cela n'a même pas le
mérite d'y créer des emplois plus que proportionnellement
au poids démographique : en effet, mues par la concurrence,
les entreprises qui se livrent à la délocalisation se tournent
vers les gisements de main-d'oeuvre les plus avantageux en termas de coût
et de disponibilité. Ainsi, les enfants — dont la procréation
est dès lors conçue comme un investissement et la mise au
travail comme une ressource — sont mis en compétition avec
leurs aînés sur le marché du travail, d'où
une pression migratoire accrue chez ces derniers [21].
Des deux côtés, la régression constante des fonctions
redistributives de l'État, rouage essentiel du libéralisme,
entre dans cette même spirale.
C'est ainsi que le spectre de l'invasion brandi par les partisans,
avoués ou non, d'une politique xénophobe est un fantasme,
mais un fantasme qui s'alimente d'une réalité macro-économique.
Nous en tirons cette leçon : à supposer,
comme nous le croyons, que le combat pour la libre circulation soit
juste et raisonnable (c'est-à-dire nullement irresponsable),
il ne peut être séparé d'un combat plus global contre
les méfaits du néo-libéralisme à l'échelle
planétaire. Car paradoxalement la pensée « unique »
libérale secrète le dessein protectionniste en matière
de migrations. Corollaire : on ne saurait décréter
une ouverture des frontières dans un environnement politique
et économique international inchangé, et sans que soient
dénoncés les accords qui, comme au niveau européen,
rendraient impossible cette ouverture dans un seul pays. Mais l'État
français est mal placé pour invoquer la contrainte de
ses engagements internationaux à l'appui d'une politique anti-immigration,
alors qu'il a grandement contribué à les promouvoir.
Si nous rappelons la dimension planétaire de cette question,
ce n'est pas seulement pour constater qu'à l'évidence
la libre circulation n'est pas pour demain. C'est pour que ceux qui
partagent notre point de vue comprennent qu'elle n'a pas de réponse
humanitaire, caeteris paribus. En particulier, à l'occasion
des récentes luttes mettant en scène des Maliens, on a
vu resurgir un vieux serpent de mer : l'« aide »
aux pays pauvres. Dans la conjoncture libérale actuelle, cette
aide est génératrice de dépendance, d'endettement
et de corruption, mais non significativement d'emplois : elle ne
saurait enrayer l'émigration [22].
En outre, ce qu'un curieux euphémisme désigne comme la
« coopération » cache, c'est la constitution
de territoires d'influence où les pays occidentaux se battent
par pays interposés en s'appuyant sur des régimes souvent
autoritaires : nous avons ici, avec les guerres civiles et les
persécutions qu'entraîne ce partage, une cause supplémentaire
importante de migration. Et ceci sans compter que la xénophobie
européenne reporte massivement les mouvements humains sur les
pays pauvres entre eux, avec les conséquences dramatiques que
l'on sait.
Malgré toutes ces limites, le spectre de l'invasion ressortit largement
au domaine de l'imaginaire. La seule conséquence plausible d'une
ouverture subite des frontières sur laquelle on peut conjecturer
serait un effet d'appel à court terme. A partir de cela, deux positions
se font face, toutes deux fondées sur un paradigme néo-classique.
La première, observant que les gisements d'émigrants potentiels
sont sans limites, conduit à faire sienne la peur du déferlement.
La deuxième observe qu'en économie de marché, la
régulation se fait par le jeu de l'offre et de la demande :
les immigrants viendront voir, le prix du travail baissera et la migration
atteindra un point d'équilibre — ce à quoi les tenants
de la première hypothèse rétorqueront que beaucoup
d'avantages sociaux hors travail resteront attractifs [23].
Ce sont deux points de vue qui ont en commun d'écarter toute
dimension historique et anthropologique du phénomène migratoire,
qu'ils assimilent à un effet mécanique d'osmose. La décision
de s'exiler, plus souvent vécue comme un arrachement que comme
une belle aventure, résulte d'un ensemble complexe de motivations
et de contraintes qu'on ne saurait réduire au froid calcul de
l'homo oeconomicus. La situation politique du pays natal y
a sa part mais, sauf dans les cas extrêmes d'exodes dus à
des massacres, rien ne vient confirmer l'hypothèse fantasmatique
d'un déferlement incontrolé.
Durant les « trente glorieuses », où l'ordonnance
de 1945 était appliquée avec mollesse au nom de la
croissance, il fallait souvent aller chercher les gens chez eux et les
appâter avec des promesses de gains et de bons statuts :
quoique autorisés à le faire, ceux-là ne venaient
pas toujours spontanément.
Même au début des années 1970, quand une terrible
famine régnait sur les pays sahéliens — se souvient-on
encore qu'à cette époque les ressortissants de l'ancien
empire français bénéficiaient ici de la libre circulation ?
—, les habitants du Tchad, du Niger, de la Haute-Volta (maintenant
Burkina Faso) et du Mali oriental n'ont pas « envahi »
la France : il n'y eut guère que les rives du Sénégal
pour expatrier, par rotations, leurs cadets afin de subvenir aux besoins
des communautés villageoises, selon des normes quantitatives
qui ne devaient rien à l'anarchie. Notons aussi ceci : trois
pays ont jusqu'à maintenant bénéficié d'un
statut dérogatoire permettant le libre accès de leurs
ressortissants au marché du travail français. Il s'agit
de la Centrafrique, du Gabon et du Togo [24],
les deux derniers au moins se signalant par des atteintes systématiques
aux droits de l'homme et par une situation économique bloquée
qui n'ont pourtant pas, à ce qu'il paraît, engendré
de « risque » migratoire démesuré.
On pourrait multiplier les exemples, le dernier étant fourni
par la suppression des frontières intérieures de l'Union
européenne : en dépit d'un développement inégal,
les pays ou régions les plus pauvres (non plus que l'ex-Allemagne
de l'est) n'ont pas significativement contribué au peuplement
des plus riches. Dans certains cas, comme celui des Portugais
en France, l'ouverture définitive et complète des frontières
n'a été ni plus ni moins que la ratification d'un ancien
état des choses, sans aucun effet accélérateur.
Il serait certes possible de démentir ces constats avec d'autres
exemples, notamment ceux où l'absence d'immigration massive paraît
due à la mise en place de barrières : loin de nous
l'idée que les flux migratoires potentiels ne sont jamais immodérés,
notamment dans les pays en guerre. Mais lorsque c'est le cas, il y a
lieu de croire que le « risque » est considérablement
grossi par la propagande des autorités, qui croient pouvoir fonder
toute l'efficacité de leur action sur le postulat suivant :
pour dissuader mille personnes d'immigrer, il faut faire savoir qu'on
empêchera les cent premières de le faire, voire la première
parmi ces cent — telle est la tournure que prend l'« accueil »
des réfugiés d'Algérie en France. Les entretiens
avec les immigrants récents de ce pays révèlent
que le plus souvent ces derniers vivent sur un espoir de retour —
ce qu'évidemment les lois actuelles sur l'entrée et le
séjour empêcheront de se concrétiser le moment venu
— et que, parmi leurs compatriotes, les candidats à l'exil
sont, sans qu'interviennent les difficultés qui leur seraient
faites, infiniment moins nombreux que la paranoïa officielle ne
le fait croire.
La question des conséquences possibles de la libre circulation
sur le monde du travail est sans doute la plus délicate et la plus
épineuse. Délicate car le sens commun a décrété
une fois pour toutes, comme une évidence que seuls des ignorants
ou des gens de mauvaise foi pourraient contester, que l'immigration est
source de chômage. Epineuse car, s'il est hasardeux de faire de
la prospective, l'ouverture sans restriction du marché du travail
aux étrangers pourrait bien avoir, dans l'ordre économique
actuel, des implications dangereuses quant aux droits de la classe
laborieuse dans son ensemble.
A l'opposé du mythe selon lequel les immigrés « volent
l'emploi des Français » — mythe dont la diffusion
transcende tous les choix politiques —, nous sommes tenté
de poser que, si vraiment il faut établir des causalités,
le chômage et l'immigration sont deux conséquences d'une
même cause, à savoir l'instauration d'un modèle
concurrent au travail contractuel : le salariat précaire
[25]. Les données statistiques
officielles sont elles-mêmes trompeuses car elles ne rendent compte
que très imparfaitement des emplois à courte durée
ou à temps partiel, et évidemment encore moins du travail
non déclaré. Or ces emplois occupent par prédilection
les immigrants, toutes catégories juridiques confondues. Dans
le BTP comme ailleurs, ces derniers sont en quelque sorte instrumentalisés
au bénéfice d'une décontractualisation qui est
en passe de devenir le modèle dominant : le travail clandestin
se présente ainsi comme le laboratoire de la flexibilité
généralisée [26].
La passivité des pouvoirs publics — sauf en paroles et hormis
quelques actions d'éclat — vient de la puissance de lobbying
des secteurs concernés, prompts à invoquer les contraintes
du marché et une structure des coûts dans laquelle le poids
du salaire et des charges est excessif : il importe donc que les
autorités répressives ferment les yeux devant les manquements
au droit du travail, évidemment plus aisés lorsque les
travailleurs sont dans une situation juridique précaire. C'est
pourquoi la classe patronale n'est, quant à elle, nullement dans
son ensemble hostile à l'immigration : elle se tourne sans
état d'âme vers le travailleur le moins cher. Cependant,
il est vraisemblable qu'une levée des restrictions aux flux migratoires
introduirait en son sein des divisions.
L'ouverture des frontières pourrait en effet engendrer deux
tendances théoriques apparemment contradictoires, dont l'agencement
mutuel ne saurait être isolé de l'évolution prévisible
des relations entre les employeurs et l'État. La première
serait une hausse du prix du travail, par respect obligé du Code
du travail : lors des régularisations de 1981-1982, on a
vu ainsi des travailleurs, précédemment embauchés
au noir, réclamer un contrat et tous leurs droits salariaux.
Et a contrario, dans des secteurs comme le nettoyage ou la
restauration, on entend souvent les syndicats se plaindre de ce que
les étrangers en situation irrégulière « cassent »
les prix : leur action pour la régularisation prend dès
lors l'allure d'une reconquête des acquis sociaux. Ce facteur
n'est pas à négliger : devenus citoyens à
part entière, les immigrants auraient de meilleures raisons de
se défendre contre la rente de situation qu'était auparavant,
pour ceux qui les employaient, leur exclusion juridique. La deuxième
tendance, sous l'effet d'une offre accrue de bras, mettrait au contraire
les employeurs en position favorable pour négocier les salaires
à la baisse ; ce qu'ils ne pourraient obtenir cependant que de
deux manières : soit par une expansion correspondante du
travail au noir, soit par une action visant à mettre en cause
le droit actuel du travail, et notamment le salaire minimum garanti.
De ce point de vue, l'ouverture des frontières laisserait l'ordre
des choses actuel en l'état et n'aurait pour autre effet qu'une
accélération du processus de précarisation de la
main-d'oeuvre, lequel « envahit » plus sûrement
la société française que les immigrants.
Mais l'hypothèse optimiste d'un renchérissement des
salaires consécutif à l'abolition du statut, si commode
pour les employeurs, de « travailleur immigré »,
est elle-même lourde de conséquences quant aux stratégies
politico-économiques des employeurs. Soucieux de maintenir intactes
leurs marges et enclins par habitude à invoquer le marasme (plus
fictif que réel) de leurs affaires, ces derniers auraient plusieurs
solutions face à une main-d'oeuvre plus exigeante. La première
tentation serait celle de l'extériorisation des productions vers
des pays à bas salaire et faible niveau de protection du travailleur.
Cela est largement entamé dans le textile industriel. Mais, par
nature, la plupart des secteurs à fort emploi d'étrangers
ne se prêtent pas à la délocalisation (sauf à
imaginer que les entreprises délaissent le marché national
et redéploient leurs chiffres d'affaires vers de nouveaux marchés
mondiaux) : le bâtiment, les services, les récoltes
et même les vêtements de mode sont autant d'industries qui
s'effectuent nécessairement in situ. Ce serait du reste
illusoire : les maquiladoras du nord-Mexique n'ont guère
freiné les traversées du Rio Grande, providence des planteurs
et des industriels du sud-ouest américain [27].
Pour des raisons analogues, on peut aussi écarter l'hypothèse
d'une modernisation accrue de l'appareil productif.
Il reste alors aux employeurs trois solutions non exclusives :
se tourner vers la manne publique ; substituer à la nouvelle
main-d'oeuvre immigrante des résidents fragilisés par
la situation économique ; enfin, oeuvrer pour ce qu'on appelle
(souvent à tort) une « déréglementation »
du droit du travail.
La chasse aux rentes servies par l'État est désormais,
à la faveur de la crise, une tradition bien ancrée du
patronat français. Dégrèvements fiscaux, exonération
des charges patronales, aides à l'embauche de toute nature, voire
primes au consommateur, constituent une panoplie légale qui,
même dans la présente conjoncture de fermeture officielle
des frontières, déguise des transferts considérables
du Trésor public au secteur privé. Mais cette solution,
dans un pays dont les autorités admettent que la pression fiscale
atteint le seuil de l'acceptable, connaîtra d'autant plus vite
des limites qu'elle sera incompatible avec la volonté keynésienne
de relancer la consommation — une autre revendication du même
patronat.
Subsistent deux options complémentaires qui, de même,
se font jour dès maintenant avec une telle insistance qu'on en
vient à se demander si réellement l'irruption de nouveaux
migrants y changerait quoi que ce soit [28].
D'une part, il s'agirait de se tourner vers des gisements de main-d'oeuvre
que le sous-emploi met dans une position particulièrement défavorable.
Si le patronat a renoncé à tout espoir de mettre au travail
certaines catégories (notamment parmi les jeunes marginalisés
des quartiers pauvres), il lui reste la possibilité, notamment
grâce aux progrès de la théorie du travail à
temps partiel et grâce à une législation particulièrement
souple (et pas même respectée) de l'apprentissage, de se
tourner vers les femmes et les enfants. La croissance considérable
de l'emploi de ces derniers en Grande Bretagne à la faveur du
thatchérisme indique que ce n'est pas une hypothèse exagérée
[29]. A ces gisements nouveaux s'ajoutent
les marchés captifs de travailleurs au sein même des communautés
immigrées : la sous-traitance aux façonniers chinois
a ainsi permis de contenir les coûts de production dans le secteur
de la mode, de même que certaines filières d'embauche par
nationalité pour les sous-traitants du bâtiment —
certes, tout cela dans un contexte fréquent de travail clandestin
[30]. D'autre part, il resterait à
s'en remettre au législateur pour accélérer le
processus de « déréglementation »
en cours (qui est en fait plutôt une sur-réglementation,
par ajouts dérogatoires successifs au Code du travail) :
encadrée par un recul du droit, une pression migratoire accrue
serait alors une aubaine permettant une diminution progressive de l'écart
entre le prix du travail ici et dans les pays dominés.
Dans les faits, cette possible évolution peut être vraisemblablement
envisagée comme la mise en place d'une combinaison organique
et durable de deux phénomènes : d'un côté,
un blanchiment du travail au noir par élimination des garanties
contractuelles du travailleur et, de l'autre, la persistance du travail
clandestin proprement dit. On remarquera que d'ores et déjà
tout un flou juridique, et pratique surtout, s'installe à propos
de certaines formes de travail en plein essor. Malaisément
identifiables et encore moins susceptibles de sanctions systématiques,
le faux intérim, le faux travail indépendant, le prêt
de main-d'oeuvre déguisé en sous-traitance, les emplois
de « stagiaires » etc. sont autant, par leur débordement,
de prodromes de ce qui, théoriquement punissable aujourd'hui,
pourrait être ouvertement autorisé par la loi de demain.
S'il en va ainsi, cela signifie que, malheureusement pour eux, le marché
du travail ne serait pas plus attractif pour les candidats à
l'immigration libre qu'il ne l'est actuellement.
Mais ces observations signifient surtout, pour notre propos, qu'on
ne saurait appeler à l'ouverture des frontières sans,
simultanément, élargir cet appel à un combat pour
l'instauration d'un droit du travail réellement contractuel et
identique pour tous. Ce souci rejoint celui que nous avons évoqué
concernant la lutte contre la doctrine néo-libérale. Si,
en matière d'immigration, les défenseurs des droits de
l'homme sont prisonniers de contradictions qui les font si souvent apparaître
comme des gens irréalistes ou intellectuellement malhonnêtes,
c'est sans doute parce que, précisément, ils croient pouvoir
s'en tenir à la question des droits de l'étranger, alors
que la politique migratoire de ce pays ne peut pas être dissociée
de sa politique globale : abroger d'un même mouvement les
lois Pasqua et les derniers lambeaux d'un Code du travail déjà
très atteint dans certains de ses justes principes, ce ne serait
pas un mal pour un bien, mais le signal d'une formidable régression.
Il est donc urgent de cesser de conforter, fût-ce à son
corps défendant, les orientations contemporaines de l'économie
par une vision isolée d'un prétendu problème migratoire.
29 septembre 1996
Notes
[17] Le système
des quotas également pratiqué pour les récoltes
en France. S'il paraît actuellement en régression, cela
est sans doute en partie imputable à ce qu'il ne concerne plus
les saisonniers ibériques.
[18] Cf. Didier Bigo,
Police en réseaux : l'expérience européenne,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris,
1996. Cf. aussi « Une révolution
culturelle pour la police des frontières — Robert Broussard
initie ses hommes à la coopération transfrontalière »,
Le Monde, 29 mars 1996.
[19] Cette politique,
quoique proposée avec des moyens assurément plus « humains »,
est dictée par un souci rigoureusement semblable à celui
des maîtres de ce pays. Cf. le titre éloquent de cet
article de Christian Vanneste, député RPR : « Stopper
l'immigration clandestine est le seul moyen de s'opposer au racisme
et de permettre l'intégration », où l'on
trouve une phrase qui semble presque reprise de P. Weil : « Par
son laxisme, la gauche a accéléré l'immigration
clandestine et favorisé l'essor de l'extrême-droite. »
(Le quotidien de Paris, 6 juin 1996).
[20] Cf. Jean Boissonnat,
Le travail dans vingt ans, Commissariat
général du plan — Odile Jacob, Paris, 1995.
[21] Cf. nos analyses
et celles de Claude Meillassoux dans : Bernard Schlemmer (éd.),
L'enfant exploité — Oppression,
mise au travail et prolétarisation, Karthala-ORSTOM, Paris,
1996 (sous presse)
[22] Cf. la critique
mordante de Mario Vargas Llosa dans « Les
immigrés, bénédiction des pays riches »,
Le Monde, 6 septembre 1996. Au terme
d'un fervent plaidoyer pour l'ouverture des frontières, l'auteur
ne résiste cependant pas au credo libéral de l'aide
au secteur privé et du libre échange.
[23] C'est ainsi
que, faisant à la fois l'impasse sur l'origine du développement
inégal des pays et sur le recul des droits sociaux en France,
Alain Finkielkraut énonce que « l'État-providence
a nécessairement des frontières » (Le
Figaro, 19 août 1996).
[24] La Centrafrique
et le Gabon ont, semble-t-il, signé récemment avec la
France une convention d'établissement mettant fin à
ce privilège.
[25] Cette notion
rejoint celle de « salariat bridé » proposée
par Yann Moulier-Boutang. Pour plus de détails, cf. notre article
« Précarisation de l'économie
et clandestinité — Une politique délibérée »,
Plein droit n° 31,
avril 1996, p. 44-50.
[26] Cette thèse
est présente dans tous les travaux de Claude-Valentin Marie.
[27] Cf. « Le
renforcement des contrôles ne freine pas la ruée des
Mexicains vers les États-Unis », Le
Monde, 12 avril 1996.
[28] « Si
on expulse les immigrés clandestins sous-payés, notre
économie crèvera. — Si on les paye un salaire décent,
aussi. » : ainsi dialoguent les passagers d'une
voiture symbolisant l'économie française, dont les roues
sont figurées par quatre Africains (dessin de Willem dans Humanité
dimanche, 29 août 1996).
[29] Cf. L'enfant
exploité..., op. cit.
[30] Cf. Yann Moulier-Boutang
et al., Economie politique des migrations
clandestines de main-d'oeuvre, Publisud, Paris, 1986.

Dernière mise à jour :
19-11-2000 12:37.
Cette page : https://www.gisti.org/doc/presse/1996/morice/precarite-2.html
|



 En ligne
En ligne


 En ligne
En ligne
