|
|
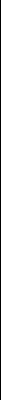
|
Projet
de loi portant diverses dispositions
relatives à l'immigration
Analyse et commentaires
du projet Debré
Paris, le 14 novembre 1996
Décision du Conseil Constitutionnel du 14 octobre 1996
- Nouvelles conditions de délivrance
des certificats d'hébergement (article 1 du projet de loi)
- Confiscation des passeports (article 3
du projet de loi)
- Fouilles des véhicules (article 3
du projet de loi)
- Nouveaux cas d'attribution de plein droit d'une
carte de séjour temporaire (article 4 du projet de
loi)
- La suppression de la commission du séjour
(article 5 du projet de loi)
- Compétence des cours administratives d'appel
(article 6 du projet de loi)
- Droit d'asile (article 7 du projet de loi)
- Rétention administrative (article 8
du projet de loi)
- Rétention judiciaire (article 8
du projet de loi)
- Contrôles d'identité et de la régularité
du séjour sur les lieux de travail (articles 2 et 10
du projet de loi)
NB :
Voir le
du GISTI en date du 8 novembre 96 .
Voir le texte du projet
de loi Debré.
Rappel des dispositions existantes - Le certificat d'hébergement
est une des pièces nécessaires aux étrangers qui
sollicitent la délivrance d'un visa de court séjour pour
entrer en France dans le cadre d'une visite privée. Il concerne
donc principalement les personnes dont le but de la venue en France est
à caractère familial ou amical.
Le visa de court séjour permet également aux étrangers,
mariés à des Français depuis moins d'un an, de
demander à l'arrivée en France la délivrance d'un
titre de séjour en tant que conjoints de Français.
Le certificat d'hébergement est établi, en France, par
une personne, française ou étrangère, qui s'engage
à héberger l'étranger pendant la durée de
son séjour.
En l'état actuel de la législation, le certificat, qui
doit être visé par le maire de la commune où réside
l'hébergeant, peut être refusé par celui-ci s'il
apparaît que l'étranger ne peut être hébergé
dans des conditions normales ou que les mentions portées sur
le certificat sont inexactes. S'il a des doutes sur ces points, le maire
peut faire vérifier si ces conditions sont remplies en demandant
à l'OMI d'effectuer des vérifications à domicile.
Le projet introduit les modifications suivantes :
- Obligation pour le signataire d'un certificat d'hébergement
qui aurait accueilli l'étranger à qui il était
destiné d'informer la mairie de sa commune du départ
de cet l'étranger (le projet ne précise pas s'il s'agit
du départ du domicile de l'hébergeant ou du départ
de France, mais on peut penser qu'il s'agit du départ du domicile).
- Aux motifs déjà prévus de refus opposables
par le maire à la délivrance, en seraient ajoutés
deux :
- les demandes antérieures de l'hébergeant font
apparaître un détournement de la procédure
au terme d'une enquête de police demandée par le
préfet ;
- le signataire du certificat d'hébergement n'a pas, dans
les deux ans qui précèdent, signalé à
la mairie le départ d'un étranger qu'il aurait accueilli.
Toutefois l'absence de signalement n'est pas opposable, si le
signataire est de bonne foi ou s'il fait état, à
bon droit, de circonstances personnelles ou familiales graves.
Bien qu'aucune disposition ne figure dans ce projet de loi sur l'utilisation
des données recueillies par le maire, l'obligation d'informer
du départ de l'étranger hébergé et la sanction
qui l'accompagne en cas de non-respect de cette obligation (refus de
délivrer de nouveau visas pendant deux ans) impliquent nécessairement
la création d'un fichier. Un précédent projet de
loi du ministère de l'intérieur du 19 mars 1996
prévoyait la création d'un « fichier des hébergeants ».
Le silence du nouveau texte permettrait à chaque mairie de
mettre en place son propre fichier en y inscrivant toutes les personnes
qui demanderaient un certificat d'hébergement. A moins que le
dispositif prévu dans l'avant-projet du 19 mars 1996,
créant un fichier départemental tenu par les préfectures,
réapparaisse dans un texte réglementaire.
Commentaire :
Cédant aux pressions réitérées de certains
maires qui revendiquent depuis plusieurs années davantage de
pouvoirs en matière de lutte contre l'immigration clandestine,
le gouvernement se propose donc d'une part de légaliser des pratiques
qui sont devenues courantes quoiqu'à l'heure actuelle illégales,
d'autre part de mettre en place un dispositif lourd de conséquences
pour toute personne ayant des attaches, même à titre amical,
avec un étranger :
- En ne faisant figurer aucune disposition dans le projet de loi sur
l'utilisation des données fournies par les hébergeants,
le gouvernement fait l'économie d'un débat devant le
parlement sur la création de fichiers, qu'ils soient gérés
par les préfectures, comme cela était prévu par
le premier projet de loi, ou par les mairies. D'une part, l'obligation
de déclarer le départ de l'étranger nécessite
un fichage qui peut porter atteinte à la vie privée
des individus, au regard des informations qui devront être fournies
aux mairies (occupation du logement, nom des personnes hébergées...).
D'autre part, rien n'empêcherait que ce fichage, théoriquement
destiné à informer les mairies des précédentes
demandes de certificat d'hébergement par une personne déterminée
et à vérifier que l'hébergeant a effectivement
prévenu la mairie du départ de l'étranger, soit
également consulté dans d'autres circonstances, par
exemple en cas d'interpellation d'un étranger en situation
irrégulière, afin d'établir l'identité
de la personne qui lui a permis d'entrer en France et éventuellement
d'engager des poursuites à l'encontre de celle-ci pour « aide
à l'entrée et au séjour irrégulier »,
en alléguant éventuellement un prétendu « détournement
de procédure »
- La notion de « détournement de procédure »,
qui pourrait constituer un motif de refus de délivrance d'un
certificat d'hébergement, n'est pas claire. Elle vise probablement
les situations dans lesquelles un étranger, entré en
France sous couvert d'un visa de tourisme, s'est maintenu sur le territoire
au-delà de la durée autorisée par ce visa. Mais
c'est aussi le cas des étrangers qui, pendant la durée
de validité de leur visa de tourisme, sollicitent un titre
de séjour pour rester en France (par exemple, les conjoints
de Français, ou les étrangers qui demandent une autorisation
de séjour pour soins, ou encore ceux qui déposent une
demande d'« asile territorial » -- on pense notamment
aux Algériens). Une personne ayant demandé un certificat
d'hébergement pour un étranger qui, une fois arrivé
en France, solliciterait son admission au séjour pour un de
ces motifs pourrait vraisemblablement se voir opposer par la suite
ce « détournement de procédure ».
On peut se demander également sur quels critères le
préfet déciderait d'initier une enquête de police,
à moins que toute demande ne soit précédée
d'une enquête, ce qui paraît difficilement réalisable !
En résumé, le dispositif envisagé en matière
de certificat d'hébergement est conçu pour être
le plus dissuasif possible, notamment par la suspicion qu'il fait peser
sur toutes les personnes susceptibles d'établir des certificats
d'hébergement pour des étrangers, et par conséquent
pour diminuer les possibilités d'obtention de visa. On peut s'interroger
sur son efficacité par rapport au but officiellement poursuivi
-- la lutte contre l'immigration clandestine. En revanche, il est
certain que sa mise en place multiplierait les difficultés déjà
rencontrées par les étrangers qui souhaitent venir en
France dans le cadre de visites familiales et privées.
Une fois de plus, la hantise de la clandestinité conduit à
réduire les libertés : celles des Français
et celles des étrangers en situation régulière.
Les étrangers en situation irrégulière sur le territoire
français, notamment ceux qui font l'objet d'une mesure d'éloignement
du territoire, pourraient, aux termes d'un nouvel article 8-1 de
l'ordonnance, se voir confisquer leur passeport par les autorités
de police. Ils recevraient en échange un récépissé
valant justification d'identité. Le passeport serait restitué
lors de la sortie du territoire.
Commentaire :
Un des buts de la mesure proposée est de permettre d'éviter
que l'étranger ne se débarrasse de ses documents de voyage
pour éviter la mise à exécution d'une mesure d'éloignement.
Mais elle permet aussi, après tout refus de séjour et
avant même la notification d'une mesure d'éloignement,
de priver les étrangers de leur passeport. Ce qui revient, de
fait, à leur interdire d'entreprendre toutes démarches
ou actes de la vie civile qui nécessitent de produire une pièce
d'identité. En effet, il faut savoir que beaucoup d'étrangers
n'ont que leur passeport pour retirer un courrier recommandé
à la poste (notamment la notification d'un arrêté
de reconduite à la frontière !), pour demander la
scolarisation de leurs enfants, ou se marier. Et il est peu probable
que les services administratifs se satisfassent du récépissé
remis en échange du passeport.
Le passeport d'un étranger en situation irrégulière
placé en rétention administrative ou judiciaire peut être
momentanément dans les mains d'une autre personne (le conjoint,
l'avocat, la famille, un colocataire...). Dans ce cas, ces personnes
auront elles l'obligation de remettre le passeport aux autorités
administratives ? Le projet ne prévoit aucune sanction,
mais on se rappelle qu'en octobre 1995 la concubine d'un étranger
en situation irrégulière avait été poursuivie
pour aide au séjour irrégulier (art. 21 de l'ord.
du 2/11/1945) par le parquet de Toulouse qui lui reprochait notamment
d'avoir caché et refusé de remettre le passeport de son
compagnon. En l'espèce, l'intéressée avait été
relaxée, le TGI de Toulouse estimant que l'article 21 n'était
applicable dans le cas d'une aide fournie à titre désintéressé.
Mais il s'agissait là d'une interprétation qui reste minoritaire
dans l'état actuel de la jurisprudence. Il est donc légitime
de se poser la question des conséquences de cette obligation
à l'égard de l'entourage de l'étranger qui a confié
son passeport à une tierce personne.
La confiscation du passeport pose le problème des conditions
de sa restitution. Comment rendra-t-on son passeport avant son éloignement
à un étranger interpellé loin de son domicile et
donc de la préfecture qui le détient ? Dans quelle
mesure laissera t-on à un étranger la possiblité
d'exécuter de son plein gré l'injonction à quitter
le territoire dont il a fait l'objet si son passeport a été
confisqué ?
Les officiers, agents et agents adjoints de police judiciaire pourraient
procéder à la visite sommaire des véhicules circulant
sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières,
afin de lutter contre l'immigration irrégulière, dans une
zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les
États parties à la convention de Schengen et une ligne tracée
à vingt kilomètres en-deçà. Les services de
police doivent obtenir l'accord du conducteur ou, à défaut,
l'autorisation du procureur de la République.
Commentaire :
Comme les dispositions relatives au certificat d'hébergement,
la fouille des véhicules va encore porter atteinte aux libertés
individuelles de tous, qu'ils soient Français ou étrangers,
au nom de la lutte contre l'immigration clandestine. Les pouvoirs accordés
aux forces de police apparaissent totalement disproportionnés
au regard du but poursuivi. A partir de quels critères les policiers
vont-ils choisir de contrôler tel ou tel véhicule ?
Après les contrôles d'identité, va t-on assister
à des fouilles de véhicules au faciès ? De
plus, le fait de pouvoir relever toute infraction autre que celle ayant
trait aux règles sur l'entrée et le séjour permet
d'utiliser cette disposition à n'importe quelle autre fin. Certes
les policiers devront demander l'accord du conducteur avant de procéder
à la « visite sommaire » de son véhicule.
Pour pouvoir s'y opposer, faut-il encore être informé de
ce droit.
Rappel des dispositions existantes. (art. 12 bis de
l'ordonnance) - La carte de séjour temporaire
est délivrée de plein droit à dix-huit ans aux jeunes
étrangers entrés par regroupement familial pour rejoindre
un parent lui-même titulaire d'un titre temporaire [1]
ou qui justifient résider régulièrement en France
depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de six ans. Son titulaire
est autorisé à exercer une activité professionnelle.
Selon le projet :
Quatre nouvelles catégories de bénéficiaires
de plein droit d'une carte de séjour temporaire sont créées :
- les jeunes étrangers qui justifient avoir leur résidence
en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans,
s'ils justifient être dans l'impossibilité de poursuivre
toute vie familiale dans leur pays d'origine ;
- les étrangers non polygames qui justifient par tous moyens
résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;
- Les conjoints de Français mariés depuis au moins un
an à condition qu'ils soient entrés régulièrement
sur le territoire ;
- Les étrangers non polygames parents d'un enfant français
âgé de moins de seize ans, résidant en France,
à la condition qu'ils exercent même partiellement l'autorité
parentale et qu'ils subviennent effectivement à ses besoins.
Commentaire :
Jeunes entrés avant l'âge de 10 ans :
La loi du 24 août 1993 a supprimé le cas de délivrance
de plein droit de la carte de résident aux enfants entrés
avant l'âge de 10 ans. Elle prévoit la délivrance
d'une carte d'un an aux seuls jeunes entrés en France avant l'âge
de 6 ans. Cette modification a multiplié les cas de jeunes
entrés hors regroupement familial sans possibilité d'obtenir
un titre de séjour et qui peuvent aussi faire l'objet d'une mesure
d'éloignement à leur majorité. Le projet de loi
ne revient pas sur ces dispositions. Il se contente d'entrouvrir une
porte pour les jeunes entrés entre six et dix ans, qui pourront
prétendre à une carte de séjour temporaire à
leur majorité s'ils justifient être dans l'impossibilité
de poursuivre toute vie familiale dans leur pays d'origine. Face aux
difficultés prévisibles pour renvoyer des jeunes majeurs
qui auront vécu, pour certains, pendant douze ans en France,
le gouvernement se contente de reprendre un des critères posés
par la jurisprudence pour apprécier les atteintes au droit de
mener une vie familiale normale, au sens de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Résidence habituelle depuis plus de quinze ans :
Il s'agit aussi d'un cas de délivrance de plein droit d'une carte
de résident qui a été supprimé par la loi
de 1993. Mais la protection prévue contre l'éloignement
à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour
cette catégorie d'étrangers n'a pas disparu. Il en résulte
la création d'un cas supplémentaire de personne à
qui on refuse toute régularisation mais qu'il n'est juridiquement
pas possible d'éloigner du territoire. Le gouvernement tente
de mettre fin à cette aberration en ouvrant un droit à
la carte de séjour temporaire après 15 ans de séjour.
Toutefois, on peut s'interroger sur le sens d'une disposition qui consiste
à délivrer une carte de séjour temporaire, par
définition susceptible de ne pas être renouvelée
d'une année sur l'autre, à des personnes présentes
sur le territoire depuis si longtemps, et que le droit protège
de l'éloignement.
Les conjoints de Français :
Sous le régime de la loi Pasqua, les conjoints étrangers
de Français reçoivent une carte de résident dès
lors qu'ils sont en situation régulière et qu'ils sont
mariés depuis au moins un an. Pendant la première année
de mariage, ils bénéficient d'une carte de séjour
temporaire. Quant à ceux qui sont en situation irrégulière,
ils ne sont protégés contre une mesure d'éloignement
qu'à l'issue de la première année de mariage .
Pour autant cette protection ne leur permet pas de régulariser
leur situation. Ils doivent nécessairement quitter le territoire
pour obtenir - ce qui n'est pas acquis d'avance - un visa
dans leur pays d'origine. Mais dans ce cas, ils peuvent difficilement
prouver la communauté de vie qui est exigée pour obtenir
un titre de séjour.
Le projet Debré fait mine de régler le problème.
Selon le nouveau texte, les conjoints étrangers devront attendre
un an après leur mariage avant de pouvoir régulariser
leur situation. Ils recevront alors une carte d'un an. Mais pendant
la première année de mariage, ils n'ont droit à
rien. Ils sont pourtant contraints de se maintenir sur le territoire
français pendant cette période sous peine de ne plus remplir
la condition de communauté de vie. Ainsi, ils n'ont plus qu'à
vivre cachés en espérant passer au travers des mailles
du filet jusqu'au première anniversaire de mariage. L'irrégularité
du séjour devient un préalable obligé à
la régularisation !
Si le projet Debré est adopté, on aura donc, d'un côté,
les « bons » conjoints de Français dotés
d'une carte de résident ; de l'autre, les « mauvais »
conjoints de Français dotés d'une carte provisoire de
séjour. Tout semble décidément fait pour dissocier
encore un peu plus la délivrance d'une carte de résident
et la notion de plein droit.
Les parents d'enfants français :
Le projet de loi prévoit la délivrance d'une carte de
séjour temporaire pour les parents étrangers d'enfants
français qui, faute d'une entrée et/ou d'un séjour
réguliers, ne peuvent actuellement obtenir un titre de séjour
alors même qu'ils sont protégés contre l'éloignement.
Trois circulaires avaient, en 1995 et en 1996, tenté
de bricoler une solution « humanitaire » à
cette absurdité juridique. Le projet Debré introduit le
contenu de ces circulaires dans la loi. Cette option entraîne
l'attribution d'une carte provisoire de séjour à une partie
d'une catégorie d'étrangers qui, jusqu'à présent,
recevait une carte de résident.
Le glissement vers une précarisation généralisée
du séjour des étrangers en France est encore une fois
manifeste. Comme pour les conjoints de Français, il distingue
les « bons » parents - ceux qui obtiendront
d'emblée une carte de résident - des « mauvais »
parents - punis par la délivrance d'une carte d'un an, en
faisant mine d'ignorer qu'ils sont néanmoins tous des parents
d'enfants français. Le bon sens et l'objectif officiel d'intégration
des étrangers appelés à vivre durablement en France,
en théorie toujours d'actualité, ne résistent pas
au souci, de toute évidence primordial, de précariser
la situation du maximum d'immigrés.
Le projet de loi ne reprend pas textuellement les dispositions de
l'article 15 de l'ordonnance de 1945 en supprimant les conditions
d'entrée et séjour réguliers :
- les conditions d'exercice de l'autorité parentale et la prise
en charge des besoins effectifs de l'enfant ne sont plus alternatives
mais deviennent cumulatives. Cela constituera à n'en pas douter
un obstacle supplémentaire pour certains parents, surtout lorsque
l'on sait de quelle manière est interprétée l'exigence
de subvenir aux besoins de l'enfant par les préfectures :
hors d'un versement de sommes d'argent, l'apport affectif, la présence
aux côtés de l'enfant ne comptent pas. Et comment verser
de l'argent quand on n'a pas le droit de travailler ?
- le droit à la carte de séjour temporaire pour les
parents n'est ouvert que jusqu'au seizième anniversaire de
l'enfant. Cette disposition est conçue pour empêcher
la régularisation des parents des jeunes qui, en vertu de la
loi Méhaignerie, peuvent choisir de devenir français
entre seize et dix-huit ans par manifestation de volonté. Le
gouvernement ne souhaite pas qu'ils bénéficient du choix
de leur enfant de devenir français. On peut en conclure avec
certitude que, loin de disparaître, la catégorie des
parents étrangers d'enfants français en situation irrégulière
va se perpétuer.
Remarque sur une version alternative du projet :
Dans un avant-projet daté du 9 septembre 1996, cet
article comportait une version alternative qui prévoyait que,
en l'absence d'une entrée ou d'un séjour régulier,
les cinq premières catégories énumérées
à l'article 15 de l'ordonnance recevaient une carte de séjour
temporaire s'ils pouvaient se prévaloir du droit au respect de
la vie familiale prévu à l'article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Cette version non retenue dans l'actuel projet de loi visait les conjoints
de Français mariés depuis plus d'un an, les enfants étrangers
de Français, les parents d'enfants français, et les étrangers
titulaires d'une rente d'accident ou de maladie professionnelle ainsi
que leurs ayants-droits. La cinquième catégorie de l'article 15,
les conjoints et les enfants entrés par regroupement familial,
ne pouvaient bénéficier de cette disposition puisque,
par définition, ils sont entrés et séjournent régulièrement
sur le territoire.
Cette option correspondait à l'insertion dans la loi de la
jurisprudence du Conseil d'État qui oblige l'administration,
lorsqu'elle examine une demande de délivrance de titre de séjour,
à tenir compte des conséquences d'un éventuel refus
sur le droit de l'étranger au respect de sa vie familiale garanti
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La portée d'une telle disposition aurait donc été
à peu près nulle.
Rappel des dispositions existantes - Lorsque
le préfet envisage de refuser un titre de séjour à
un étranger mentionné à l'article 15 (carte
de résident de plein droit) et/ou art. 25 (protection contre
l'éloignement) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il
doit solliciter l'avis, émis à titre consultatif, de la
commission du séjour des étrangers. Cette commission est
composée de trois magistrats.
Selon le projet de loi :
La commission du séjour des étrangers est supprimée.
Commentaires :
Après avoir réduit la portée de son avis (il
n'est plus impératif mais seulement consultatif depuis la loi
Pasqua) et limité les cas de sa saisine, la mise à mort
finale de cette commission est programmée par le projet Debré.
De toute évidence, elle gêne les préfets, même
dans sa version édulcorée, en accordant à des magistrats
un droit de regard sur leurs décisions de refus de séjour.
Il s'agit d'une garantie de procédure importante qui risque de
disparaître.
Selon l'exposé des motifs, la suppression de la commission du
séjour est le corollaire de l'article 4 du projet de loi. Comme
si la cote mal taillée réservée aux étrangers
présents en France depuis quinze ans, ainsi qu'aux conjoints
de Français et aux parents d'enfants français, réglait
la totalité du contentieux relatif aux refus de séjour
des catégories mentionnées aux articles 15 et 25 de l'ordonnance.
Rien n'est plus faux car, d'une part, nous l'avons vu, l'article 4 du
projet Debré ne mettra pas un point final aux difficultés
rencontrées par ces personnes qui ont de fortes attaches en France
et, d'autre part, les catégories énumérées
aux articles 15 et 25 ne se réduisent pas à
ces trois cas.
Par ailleurs, la réglementation communautaire reconnaît
aux ressortissants de l'Union européenne le droit d'être
entendus , sauf urgence, par une autorité indépendante,
différente de celle qualifiée pour prendre la décision,
en cas de refus de renouvellement du titre de séjour. La commission
du séjour permet de satisfaire à cette exigence. En la
supprimant, le projet de loi ne respecte plus les garanties procédurales
prévues par la directive européenne 64/221.
Le projet Debré introduit au chapitre IV de l'article 22 bis
de l'ordonnance une référence aux nouvelles cours administratives
d'appel auprès desquelles les étrangers éloignables
pourront former, à partir du 1er septembre 1999, le recours
qu'ils forment actuellement devant le Conseil d'état dans l'hypothèse
où, en première instance, les tribunaux administratifs ont
confirmé la légalité des arrêtés préfectoraux
de reconduite à la frontière qui les frappent.
Rappel des dispositions existantes
Un demandeur d'asile a droit au séjour sur le territoire français
pendant toute la durée d'instruction de sa demande, d'abord devant
l'OFPRA, puis devant la Commission des recours des réfugiés.
Tout au long de cette procédure, il lui est délivré
un récépissé de demande de titre de séjour,
renouvelé de trois mois en trois mois. Son passeport est conservé
pendant l'instruction de sa demande par l'OFPRA, et lui est restitué
en cas de décision négative de l'Office. La décision
négative de la Commission des recours peut faire l'objet, de la
part du demandeur d'asile, d'un recours en cassation, mais sans que cette
initiative lui conserve son droit au séjour.
Toutefois, la préfecture peut refuser l'admission au séjour
du demandeur d'asile dans quatre cas :
- si l'examen de la demande relève d'un autre État
en vertu des accords de Schengen ou de la Convention de Dublin. L'étranger
n'est alors pas autorisé à saisir l'OFPRA et peut être
« remis » sans délai, et sans recours suspensif,
aux autorités du pays responsable ;
- s'il est admissible dans un État autre dans lequel il peut
bénéficier d'une protection effective ;
- si sa présence en France constitue une menace grave pour
l'ordre public ;
- si la demande d'asile repose sur une fraude délibérée,
ou constitue une recours abusif aux procédures d'asile, ou
a pour but de faire obstacle à une mesure d'éloignement.
Dans ces quatre cas, l'étranger ne reçoit aucun titre
de séjour ; il peut se voir notifier une mesure d'éloignement
et être placé en centre de rétention. Il peut cependant
saisir l'OFPRA de sa demande qui sera traitée en urgence, et
la mesure d'éloignement ne sera mise à exécution
qu'après la décision de l'OFPRA, mais avant une éventuelle
décision de la Commission des recours des réfugiés.
Selon le projet de loi :
La présentation de plusieurs demandes d'admission au séjour
au titre de l'asile sous des identités différentes constituerait
un recours abusif à la procédure d'asile.
Commentaire
Cette disposition brouille un peu plus les contours des notions « de
fraude délibérée » et « recours
abusif » en matière de demande d'asile introduite par
la loi Pasqua. La circulaire du 8 février 1994 qualifie les demandes
d'asile multiples sous plusieurs identités de « fraudes
délibérées ». Le projet de loi précise
maintenant qu'il s'agit de « recours abusifs à la procédure
d'asile ». Tout cela démontre bien que des notions
aussi floues permettent à l'administration de faire à
peu près n'importe quoi.
Rappel des dispositions existantes
Lorsqu'un étranger doit être éloigné du territoire,
il peut, pendant le temps nécessaire à son départ,
être maintenu par décision du préfet dans des « locaux
ne relevant pas de l'administration pénitentiaire » (art. 35 bis
de l'ordonnance). Cette rétention peut durer, dans un premier temps,
24 heures. Elle n'est prolongeable que par jugement du TGI, pour
une durée de six jours, puis, en cas d'« urgence absolue
et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public »
ou si l'étranger ne présente pas les documents de voyages
nécessaires, la rétention peut être encore prolongée
par le juge pour une nouvelle période de 72 heures (soit au
total 10 jours).
Les décisions de prolongation de la rétention sont susceptibles
d'appel devant un magistrat de la cour d'appel qui doit statuer dans
un délai de 48 heures. Le droit d'appel appartient à
l'intéressé, au ministère public et au représentant
de l'Etat dans le département ; ce recours n'est pas suspensif.
Dans le projet :
- Le préfet pourrait placer en rétention un étranger
sous le coup d'une mesure d'éloignement pendant 48 heures
(au lieu de 24 heures actuellement) avant qu'il soit présenté
à un magistrat du tribunal de grande instance pour une éventuelle
prolongation de ce délai. Du coup, la prolongation de la rétention
potentiellement fixée par ce magistrat passerait de six à
cinq jours, le total étant donc inchangé.
- Le recours en appel contre toute décision judiciaire relative
à la rétention resterait non suspensif. Toutefois, le
projet Debré prévoit que le juge de la Cour d'appel
peut conférer un caractère suspensif à cet appel
quand il est formé par le ministère public et seulement
par lui. L'étranger serait alors maintenu en rétention
jusqu'au moment où le magistrat de la cour d'appel statuerait.
Ce « maintien à la disposition de la justice »,
en dépit du fait que le juge de première instance aurait
libéré l'étranger, serait pris sans délai
sur la seule base des pièces contenues dans le dossier.
- L'étranger pourrait être à nouveau placé
en rétention dans les sept jours suivant la fin d'une précédente
rétention si la mesure d'éloignement n'avait pu être
exécutée.
Commentaire :
La modification de la durée des différentes phases de
la rétention et le retard de 24 heures de l'intervention
du juge judiciaire sont un « choix contraint »,
ainsi que le précise l'exposé des motifs. Faute de pouvoir
augmenter la durée totale de la rétention (10 jours)
en raison des limites fixées en la matière par le Conseil
constitutionnel, le projet de loi s'attache dans un premier temps à
retarder et à limiter les effets de l'intervention du juge judiciaire
dans la procédure ; et, dans un second temps, à permettre
le renouvellement de plusieurs périodes de rétention en
exécution d'une même mesure d'éloignement.
Le but avoué de ces modifications étant de « rendre
plus efficace le dispositif d'éloignement des étrangers »,
il faut en déduire que, selon l'administration, l'intervention
du juge au bout des premières 24 heures et les garanties
qu'elle représente en termes de protection des libertés
individuelles, nuisent à l'efficacité du dispositif. Cette
approche très contestable de la question est sûrement à
mettre en relation avec la récente décision de la Cour
de cassation du 22 mai 1996 (M. Onder) qui reconnaît
au juge de la rétention la possibilité, en tant que gardien
de la liberté individuelle, de se prononcer sur les conditions
d'interpellation de l'étranger placé en rétention
et de le libérer en cas d'irrégularité de la procédure.
De plus, en mettant fin à la concordance de durée entre
la présentation des personnes éloignables au juge judiciaire
de la rétention et le délai de recours devant le juge
administratif contre les arrêtés de reconduite à
la frontière, cette disposition supprime la possibilité
pour les étrangers de former un recours contre l'arrêté
de reconduite à la frontière au cours de l'audience du
35 bis - situation fréquente - , en bénéficiant
éventuellement de l'aide d'un avocat.
La possibilité de replacer plusieurs fois en rétention
un étranger pour l'exécution d'une seule et même
mesure d'éloignement a pour objet de neutraliser une autre décision
de la Cour de cassation (28 février 1996, Rasmi) qui
a estimé qu'une mesure d'éloignement ne peut permettre
qu'un seul placement de sept jours en rétention.
Quant à la reconnaissance de l'effet suspensif d'une décision
judiciaire de libération de la rétention au seul ministère
public, elle déséquilibre totalement la procédure
au dépend de l'étranger retenu. Jugé libérable
en première instance, un étranger sous le coup d'une mesure
d'éloignement restera en rétention si l'administration
espère que le juge d'appel sera plus sensible à ses arguments
que son collègue de première instance.
Rappel des dispositions existantes
La loi du 30 décembre 1993 a inséré dans
le code pénal et le code de procédure pénale des
dispositions qui prévoient, lorsque l'étranger ne présente
pas les documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure
d'éloignement du territoire ou ne communique pas les renseignements
permettant cette exécution -- ce qui constitue un délit
aux termes de l'article 27 al. 2 de l'ordonnance --, que
le juge peut ajourner le prononcé de la peine et placer l'intéressé
sous le régime de la « rétention judiciaire »
pendant un délai de trois mois en lui enjoignant de communiquer
les documents requis.
Selon le projet de loi :
L'étranger dépourvu des documents de voyage permettant
l'exécution d'une mesure d'éloignement et coupable de
l'infraction prévue à l'article 19 de l'ordonnance
(entrée ou séjour irrégulier qui peuvent être
punis d'un an de prison, 25 000 F d'amende et d'une interdiction
du territoire de trois ans maximum) pourrait être placé
en rétention judiciaire.
Commentaire :
A défaut de pouvoir augmenter la durée de la rétention
administrative, le gouvernement envisage d'étendre les possibilités
de placer les étrangers dépourvus de titre de séjour
en rétention judiciaire. Il ne s'agirait plus de retenir seulement
l'étranger qui refuse de remettre à l'administration les
documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement
prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements
permettant cette exécution, mais de retenir aussi celui qui est
dépourvu de documents de voyage. L'intention de faire obstacle
à l'exécution de la mesure d'éloignement ne serait
plus nécessaire, il suffirait seulement d'être en situation
irrégulière et de ne pas pouvoir matériellement
présenter un passeport, ce qui peut être le cas notamment
des demandeurs d'asile déboutés qui ont fui rapidement
leur pays, pour faire l'objet d'une mesure de rétention judiciaire.
Rappel des dispositions existantes
Les officiers de police judiciaires et, sur ordre et sous la responsabilité
de ceux-ci, les agents de police peuvent contrôler l'identité
de toute personne à l'égard de laquelle existe un indice
faisant présumer :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles
à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité
judiciaires.
Sur réquisitions du procureur de la République, l'identité
de toute personne peut être également contrôlée
dans les lieux et pour une période de temps déterminée
par ce magistrat.
Quel que soit le comportement de la personne, un contrôle d'identité
peut être effectué pour prévenir une atteinte à
l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes
ou des biens.
Dans le cadre de ces contrôles d'identité, les étrangers
sont tenus de présenter leur titre de séjour.
Selon le projet :
Les deux articles du projet de loi se combinent entre eux :
- L'article 10 crée un nouvel article 78-2-1 dans le code
de procédure pénale. Cet article autorise les fonctionnaires
de police, sur réquisition du procureur de la République,
à effectuer des contrôles d'identité dans des
lieux à usage professionnel, sauf s'ils constituent un domicile,
de toute personne y exerçant une activité en vue de
vérifier qu'elles sont inscrites sur le registre unique du
personnel et que les déclarations préalables à
l'embauche les concernant ont été effectuées.
- L'article 2 insère dans l'article 8 de l'ordonnance
la référence au nouvelle article 78-2-1 du code de procédure
pénale. Ce qui permet aux officiers de police judiciaire de
demander le titre de séjour à l'étranger qui
a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur son lieu
de travail
Commentaire :
Pour l'instant seuls les inspecteurs du travail peuvent effectuer
des contrôles sur les lieux à usage professionnel. L'attribution
de nouvelles compétence en la matière aux officiers de
police judiciaire risque de renverser les priorités en matière
de lutte contre le travail illégal. Le glissement sémantique
opéré par le gouvernement constitue un premier indice :
dans l'intitulé de la loi, on est passé du « travail
illégal » au « travail clandestin ».
Ce n'est pas par hasard si la notion de clandestinité, qualifiant
essentiellement pour l'opinion publique la situation des étrangers
sans titre de séjour, a été choisi de préférence
à la notion d'illégalité qui renvoie seulement
au non-respect des règles du code du travail. De même,
le fait d'insérer cette disposition dans un « projet
de loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration »
après l'avoir retirée du « projet de loi relatif
au renforcement de la lutte contre le travail illégale »
n'est pas anodin.
Cette présomption est fortement renforcée par le fait
que l'article 2 du projet de loi introduisant le nouvel article
78-2-1 du code de procédure pénale sous l'article 8
de l'ordonnance permettrait aux officiers de police judiciaire de vérifier
la régularité du séjour d'un étranger à
l'occasion de ces contrôles d'identité.
Ainsi que le précise (Le Monde du 24 septembre 1996)
l'association Villermé, qui regroupe des inspecteurs du travail,
on risque « d'assimiler la victime et le coupable »,
c'est-à-dire de poursuivre en priorité l'étranger
sans papiers qui se fait exploiter au lieu de rechercher la responsabilité
du véritable donneur d'ordres qui l'exploite.
[1]Si le regroupement familial a été
obtenu par un titulaire de la carte de résident, c'est cette
carte qui est délivrée à ses enfants à l'âge
de 18 ans (art. 15 et 29-III de l'ord. du 2/11/1945).
Le gouvernement a saisi le Conseil constitutionnel pour savoir si les
dispositions de l'ordonnance désignant les autorités administratives
habilitées à prononcer des arrêtés d'expulsion
en application de l'article 23 - en l'occurrence le ministre de l'intérieur -
relèvent du domaine réglementaire.
Le Conseil constitutionnel a répondu par l'affirmative à
cette question dans sa décision du 14 octobre 1996.
Cette décision va permettre de transférer aux préfets,
par décret, le pouvoir de prononcer des arrêtés
d'expulsion à l'encontre des étrangers qui constituent
une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur
restant compétent pour l'expulsion en urgence absolue ou constituant
une nécessité impérieuse pour la sûreté
de l'État ou la sécurité publique.
Commentaire :
Le prononcé d'un arrêté d'expulsion repose sur
une appréciation de la notion de trouble grave à l'ordre
public. En l'absence d'une définition législative précise
de cette notion, le ministre de l'intérieur dispose d'un large
pouvoir discrétionnaire pour apprécier si le comportement
d'un étranger constitue effectivement une menace grave pour l'ordre
public justifiant une mesure d'expulsion. L'émiettement de ce
pouvoir dans les mains de chaque préfet risque de générer
de fortes disparités d'un département à l'autre.
En raison de la gravité de cette mesure qui entraîne non
seulement l'éloignement du territoire mais aussi l'impossibilité
d'y revenir avant qu'elle ne soit rapportée, il ne serait pas
acceptable que la même règle soit interprétée
différemment selon l'endroit du territoire où l'arrêté
d'expulsion a été pris. Les risques d'arbitraire administratif
sont d'autant plus importants que, depuis la loi Pasqua, la commission
d'expulsion n'est plus en mesure d'imposer ses avis lorsqu'elle estime
qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'expulsion.
A noter que, comme pour les charters, les DOM ont servi de laboratoire
à cette innovation (art. 25 al. 3 de l'ord. du 2/11/1945),
même si les préfets de ces départements n'en font
pas fait un usage immodéré. Il n'en sera pas nécessairement
de même en métropole.
On peut enfin s'interroger sur l'opportunité - voire sur
la légalité - de conférer un pouvoir d'expulsion
aux préfets dans la mesure où, à la différence
des arrêtés de reconduite à la frontière,
il s'agit d'une mesure inscrite dans le casier judiciaire des victimes
et qui, de ce fait, s'apparente à une condamnation pénale.

Dernière mise à jour :
10-08-2004 16:05
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/publications/1996/debre/index.html
|







