|
|
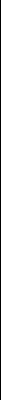
|
L'Europe et les exclus
de la libre circulation
par Claire Rodier
Texte publié dans « Les lois de l'inhospitalité »,
La Découverte, 1997. Reproduction interdite
sauf pour usage personnel.
Héritiers
de traditions trop différentes pour permettre d'envisager à
court terme la définition d'une politique commune en matière
d'immigration, les États de l'Union européenne sont néanmoins
amenés à coordonner leurs législations dans ce domaine
afin de les rendre compatibles. Ils sont en effet confrontés à
ce qu'il est convenu d'appeler une pression migratoire d'un type nouveau.
Celle-ci est due notamment à la mondialisation des courants migratoires
dont les années quatre-vingt ont marqué le développement.
L'effondrement de l'ancien bloc socialiste d'Europe de l'Est, l'instabilité
politique chronique du continent africain, les modifications macro-économiques
des échanges internationaux se combinent à l'intensification
des moyens d'information et de la mobilité pour alimenter une obsession
bien partagée au sein de l'Union européenne : la hantise
d'un afflux massif de migrants attirés par l'Eldorado européen.
Pour relever largement du fantasme — la déferlante d'Européens
de l'Est annoncée au début des années quatre-vingt-dix
n'est jamais arrivée —, cette obsession n'en contribue
pas moins à légitimer la recherche d'instruments juridiques
et techniques de plus en plus sophistiqués pour repousser l'« ennemi
commun » que représente le migrant potentiel.
Certes, les quinze États de l'Union européenne n'ont
pas tous la même approche des questions migratoires [Wihtol
de Wenden, 1995]. Les anciens pays d'immigration (le Royaume-Uni,
la France) ont une expérience rodée — sur le
plan politique et policier — de la gestion des flux de main
d'oeuvre, alors que l'Espagne et le Portugal, qui il y a une trentaine
d'années encore fournissaient leurs futurs partenaires communautaires
en bras pour le bâtiment, l'industrie et l'agriculture, n'ont
été confrontés que récemment à l'installation
d'étrangers sur leur sol. A ces facteurs historiques s'ajoutent
des raisons géographiques : l'Allemagne, point de passage
quasi obligé des migrants de l'Est vers l'Union européenne,
de même que l'Espagne, l'Italie et la Grèce, dont les côtes
offrent des centaines de points de passage aux migrants du Sud, sont
soumises à des pressions plus immédiates que la Grande-Bretagne,
protégée par son insularité, ou le Bénélux,
par le filtre que constituent ses voisins communautaires. On ne peut
enfin négliger des facteurs relevant de la politique interne
à chaque État membre, tels que l'utilisation tactique,
par certains gouvernements démunis devant une crise socio-économique
qu'ils ne parviennent pas à gérer, du spectre de l'immigration
clandestine et de la montée du racisme. La France en est un bon
exemple : bousculés par la menace électorale que
représente une extrême droite dont l'immigration est un
des thèmes favoris, ses gouvernants successifs — de
gauche comme de droite — laissent croire depuis quinze ans,
sans qu'aucune analyse économique sérieuse ne le démontre,
que les étrangers sont responsables du chômage.
Ces contextes dissemblables expliquent les différences apparentes
que revêtent les politiques nationales d'immigration menées
par les États membres : on oppose souvent les opérations
de « régularisation exceptionnelle » organisées
ces dernières années par l'Espagne, l'Italie et le Portugal,
puis plus récemment par la France, à la rigueur du mot
d'ordre « immigration irrégulière zéro »
brandi un temps par le gouvernement français. Il n'est pourtant
pas certain que cette opposition soit pertinente. Elle pourrait ne traduire
que la différence de méthode utilisée par les uns
ou les autres pour faire face à leurs besoins conjoncturels de
main-d'oeuvre dans les secteurs déficitaires (essentiellement
l'agriculture, le BTP, les services et la confection). De fait, alors
que l'ensemble les législations des Quinze reposent sur la protection
de l'emploi national, la plupart ménagent des brèches,
légales ou non, pour déroger à la règle.
Ainsi, l'Allemagne a développé une politique de contrats
saisonniers, donc de courte durée, et offre la possibilité
à des « frontaliers » — essentiellement
des Polonais — de travailler sur son sol, sans toutefois qu'ils
puissent y résider. L'Autriche mène de longue date une
politique de quotas annuels d'étrangers admis au travail, dont
le nombre (en diminution depuis quelques années) est adapté
aux besoins des entreprises. Les pays du sud de l'Europe, on l'a vu,
procèdent régulièrement à des opérations
de régularisation d'étrangers qui, bien qu'entrés
illégalement sur leur territoire, justifient y avoir trouvé
un emploi. On ne saurait nier enfin — bien qu'il ne s'agisse
naturellement pas d'une politique officielle — l'utilisation,
dans certaines branches de l'économie, d'une proportion importante
de travailleurs étrangers en situation irrégulière,
que les lois sur le travail « clandestin » ou « illégal »
n'enrayent guère.
L'objectif, finalement, est le même. Il s'agit, pour les États
membres, de conserver une marge de manoeuvre tout en affichant une politique
officielle de fermeture des frontières, tempérée
par la gestion maîtrisée des seuls flux légaux que
le respect des conventions internationales les oblige à admettre :
l'immigration familiale et l'accueil (bien limité) de réfugiés.
Cette politique s'appuie sur le contrôle matériel de leurs
frontières (terrestres, maritimes, aériennes) et, en amont,
se traduit par l'obligation pour les étrangers de présenter
des visas d'entrée.
Mais la construction de l'Europe communautaire a amené les
États membres à envisager l'adaptation des modalités
de contrôle de leurs frontières : le
traité de Maastricht (art. 7A) prévoit en effet l'instauration
d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la
libre circulation des marchandises, des biens, des capitaux et des personnes
est assurée.
En ce qui concerne les personnes, cet objectif a été
progressivement atteint pour les ressortissants communautaires. Le principe
de la liberté de circulation était déjà
posé par le traité
de Rome en 1957. Pendant longtemps, cette mobilité territoriale
offerte aux ressortissants des pays du Marché commun — et
seulement à eux — était lice à une mobilité
professionnelle. La liberté de circuler ne concernait que la
liberté d'exercer une activité économique (salariée
ou non) dans un autre État que celui dont on était originaire.
Peu à peu, ont été mises en place des mesures
destinées à assurer le droit au séjour des travailleurs
communautaires et des membres de leur famille dans un autre État
que le leur (1968), puis le droit d'y demeurer lorsqu'ils y avaient
travaillé (1970). On relèvera que l'adoption de ces mesures
stabilisatrices coïncide avec le démarrage de la croissance
économique de l'Italie et la baisse de l'émigration d'italiens
vers les autres pays membres. On retrouvera d'ailleurs le même
phénomène avec l'adhésion à la Communauté
européenne de l'Espagne et du Portugal : entrée officiellement
en vigueur en 1986, elle était assortie d'une période
de transition destinée à différer la liberté
de circulation des travailleurs, dont l'échéance avait
été fixée six ans plus tard. Le « risque »
ayant été surévalué, on réduisit
d'ailleurs cette période transitoire à cinq ans.
C'est avec l'Acte
unique européen, en 1986, qu'apparaît la notion d'espace
communautaire sans frontières, qui sera plus tard intégrée
au traité de Maastricht. Dans cette perspective, il s'agissait
d'élargir les possibilités de mobilité des ressortissants
communautaires au-delà des seuls travailleurs et de leurs ayants
droit. Des mesures sont ainsi adoptées en 1990 pour permettre
aux étudiants, aux personnes retraitées et enfin à
tous les « non-actifs » — c'est-à-dire
ceux qui ne sont ni travailleurs, ni étudiants, ni retraités —
d'exercer à leur tourleur droit à la liberté de
circulation et d'établissement dans tous les États membres.
À un détail près — les « non-actifs »
doivent justifier de ressources suffisantes pour s'installer dans l'État
d'accueil —, l'Europe des Quinze est bien devenue progressivement
un espace de libre circulation pour les ressortissants des États
qui la composent.
La mise en oeuvre complète de l'objectif de l'Acte unique supposerait
la suppression totale de tout contrôle aux frontières intérieures
de l'Union européenne. Mais se pose alors aux Etats membres le
problème des personnes à qui la libre circulation n'est
pas destinée et qui sont pourtant nombreuses : les étrangers
non communautaires. En effet, aucune des dispositions que l'on vient
d'évoquer ne les concerne : ceux qui résident légalement
dans un des États membres restent subordonnés à
la législation interne de cet État. Il n'est pas question,
pour eux, d'envisager de s'établir librement dans un autre pays
de l'Union; quant à leur circulation dans l'espace communautaire,
elle est pour l'instant toujours liée à l'obtention d'un
visa (sauf s'ils résident dans un État signataire de la
convention de Schengen, comme on le verra plus loin). Ceux qui ne résident
pas en Europe ne sont pas censés non plus, s'ils ont réussi
à pénétrer dans l'un des pays de l'Union européenne,
pouvoir se déplacer librement d'un pays à un autre.
Comment s'assurer du respect de ces règles spécifiques
aux étrangers non communautaires, dans un espace où les
contrôles aux frontières internes sont abolis ? On pourrait
poser la question plus crûment : comment superposer des législations
nationales, qui restreignent et contrôlent les uns, à une
loi européenne, qui ouvre les frontières aux autres ?
Faute d'avoir résolu l'équation, l'Union européenne
a été « contrainte » de différer
la suppression totale des contrôles aux frontières, qui
devait intervenir en 1993. Une publication officielle diffusée
par la Commission européenne, destinée à promouvoir
la réalisation du marché unique européen, explique
ainsi que, « alors que la libre circulation des marchandises,
des services et des capitaux est maintenant devenue une réalité,
les personnes sont encore soumises à des contrôles d'identité
au passage de certaines frontières intérieures. Le problème
consiste, en l'occurrence, à concilier les exigences de la mobilité
des individus avec la nécessité de contrôler le
crime international et de réduire l'immigration clandestine »
(on notera que les termes « personnes » et « individus »
ne désignent ici, de fait, que les ressortissants des États
membres).
L'association criminalité/immigration clandestine, classique
dans le discours politique français, est également ancienne
à l'échelon européen. Elle est à l'origine
de la mise en place, surtout à partir de 1986 — date
de l'adoption de l'Acte unique —, d'une multitude de groupes
de travail interétatiques destinés à prévenir
les incidences de l'ouverture des frontières sur la sécurité
intérieure.
La convention de Schengen
est le fruit du travail de l'un de ces groupes. Composé au départ,
en 1985, de cinq États membres (l'Allemagne, la France et les
trois pays du Bénélux), le groupe initial devait être
rejoint par l'Italie (1990), l'Espagne et le Portugal (1991), la Grèce
(1992), l'Autriche (1995), puis la Finlande, la Suède et le Danemark
(1996). Le dispositif opérationnel ne fonctionne cependant encore
qu'entre sept d'entre eux (les cinq fondateurs, l'Espagne et le Portugal).
On a souvent parlé du « laboratoire Schengen , en ce
qu'un de ses objectifs était de réaliser — à
petite échelle d'abord — ce vers quoi tend l'article
7A du traité de Maastricht, c'est-à-dire permettre la
libre circulation, et donc supprimer les frontières intérieures
d'un espace unique composé des pays signataires de la convention.
Si les préoccupations initiales visaient surtout à faciliter
les transports de marchandises en levant les contrôles douaniers,
les États partenaires se sont trouvés rapidement confrontés
à cette même difficulté qui bloque encore aujourd'hui,
au niveau de l'Union européenne, la concrétisation de
la mobilité totale des ressortissants communautaires : comment
éviter que la suppression des contrôles frontaliers ne
profite pas à ceux pour qui elle n'est pas prévue, autrement
dit les étrangers non communautaires ? Le paradoxe est traduit
de manière significative par le texte même de la convention;
riche de cent quarante-deux articles, elle en consacre un seul à
l'ouverture des frontières : « Les frontières
intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un
contrôle des personnes soit effectué », et pratiquement
tous les autres à l'aménagement de ce principe afin qu'il
n'en soit pas fait un usage indu. Ces « mesures compensatoires »
sont pratiquement dès l'origine considérées comme
indispensables par les signataires de Schengen, pour lesquels il semble
évident qu'ouverture des frontières signifie accroissement
de la criminalité, du terrorisme, de la fraude, et naturellement
de l'immigration clandestine. Car l'immigration vient rapidement au
centre des débats des concepteurs de la convention, notamment
de la part de sa composante française. En France, le thème
de l'invasion étrangère devient alors un enjeu de politique
interne, brandi par l'extrême droite et utilisé par la
gauche comme par la droite parlementaire pour justifier le durcissement
de la politique d'immigration. Bien que les événements
ne démontrent en rien la pertinence de l'amalgame, la vague d'attentats
de 1986 vient conforter le discours sur les liens entre terrorisme et
immigration. Dans ce contexte, Schengen vient à point nommé :
pour prévenir le « déficit de sécurité »
que ne manquerait pas de provoquer la suppression des contrôles
aux frontières, on va mettre en place un impressionnant dispositif
fondé sur une appréhension essentiellement policière
de la question. Dans un « double retournement »
bien résumé par C.-V. Marie [1994] :
« La protection des frontières extérieures
qui devait être une conséquence de la réalisation
de l'espace commun [...] en est devenue une condition préalable;
la coopération policière, prévue pour être
un instrument de la suppression des contrôles aux frontières,
est devenue un objectif à part entière. »
À l'égard des étrangers non communautaires (on
écartera ici le cas des demandeurs d'asile, auxquels la convention
consacre un volet important), le dispositif Schengen s'articule autour
de trois axes : dans le cadre d'une politique commune de délivrance
de visas, l'instauration d'un visa unique leur permettant l'accès
et la circulation dans tout l'espace Schengen pour une durée
maximale de trois mois, à condition de déclarer leur entrée
à chaque passage de frontière (« virtuel »
puisque, rappelons-le, les contrôles sont censés y être
abolis...) ; la possibilité pour les étrangers résidant
légalement dans l'un des États signataires de circuler
dans les autres sans avoir à produire de visa; la mise en commun
des données nationales relatives aux « indésirables »
de chaque pays, par le biais d'un fichier informatisé, le Système
information Schengen (SIS), obligeant, sauf cas exceptionnel, tous les
États partenaires à refuser le droit au séjour
ou à organiser l'expulsion des étrangers qui y sont inscrits.
On a ainsi pu voir un ressortissant algérien né en France
et y ayant toujours vécu en situation régulière
se voir retirer son titre de séjour en 1995 (date d'entrée
en vigueur de la convention de Schengen) par l'administration française,
au motif que son nom apparaissait au SIS : il y avait été
inscrit par la Belgique, à la suite d'une expulsion prononcée
par ce pays en 1988!
En créant un sous-espace (Schengen) dans l'espace (communautaire),
la convention multiplie les différences de traitement entre les
personnes, selon leur statut. Il faut en effet distinguer:
- d'abord, les ressortissants des « États Schengen »,
à qui est garantie la liberté de circulation sans contrôles
aux frontières internes ;
- ensuite, les ressortissants communautaires des pays non membres
de Schengen, qui jouissent aussi de la libre circulation aux frontières
internes, mais pas aux frontières externes de l'espace Schengen
(au sens de la convention, leurs pays sont des États tiers) ;
- puis les étrangers non communautaires, résidant dans
l'un des « États Schengen », qui peuvent
circuler librement à l'intérieur de l'espace Schengen
à condition de déclarer leur entrée à
chaque passage d'une frontière interne ;
- enfin, les étrangers non communautaires, non résidents
dans l'un des « États Schengen », soumis
à visa et tenus eux aussi à la déclaration d'entrée
sur le territoire.
Sachant que — postulat initial — les contrôles
aux frontières sont supprimés, comment vérifier
qu'une personne a l'une ou l'autre de ces qualités ? En
réalité, il n'existe pas d'autre moyen que de renforcer
les contrôles en dehors des frontières, mais... pas trop
loin : c'est pourquoi la loi française a introduit en 1993
la nouvelle possibilité d'effectuer des contrôles d'identité
dans la zone de vingt kilomètres qui court le long de la frontière
terrestre. Reste le problème du choix des personnes à
contrôler. À cet égard, les consignes à ses
fonctionnaires de M. Faussaire, directeur des Libertés publiques
au ministère de l'Intérieur français, seront claires:
« Il y aura lieu d'effectuer ces contrôles avec discernement,
notamment quand ils porteront sur un ressortissant d'un État
membre de l'Union européenne » (circulaire du 23 mars
1995). On ne saurait mieux inviter aux contrôles au faciès.
On pourrait, après deux ans d'application, multiplier les exemples
qui démontrent s'il en était besoin que le versant « libre
circulation » de Schengen a été rapidement supplanté
par son versant policier. Matériellement ingérable — Didier
Bigo estime à 1,7 milliard le nombre de franchissements annuels
des frontières extérieures de l'espace Schengen; pour
lui, ce chiffre rend « totalement irréalistes des mesures,
mêmes temporaires, de fermeture complète des frontières"
[Bigo, 1996a] —, la convention, au regard
de l'expérience française, aura surtout servi de prétexte
aux parlementaires pour durcir la législation sur les étrangers.
On peut donc tout craindre de la généralisation, au niveau
de l'Union européenne, du mécanisme Schengen. Cette généralisation
est en cours: depuis le sommet d'Amsterdam de juin 1997, la convention
est intégrée au traité d'Union — même
si tous les États membres n'y sont pas parties prenantes. Elle
a d'ailleurs déjà servi de modèle à l'Union,
notamment pour l'instauration d'un visa unique et la mise en place d'un
« Système information européen »,
grand frère du SIS. On va voir cependant que, s'agissant des
ressortissants d'États tiers, les préoccupations des Quinze
ne sont pas limitées aux problèmes des frontières.
Un rapport sur la politique d'immigration et d'asile, adopté
en décembre 1991 par les ministres chargés de la matière
dans les États membres, présentait l'« harmonisation »
comme une nécessité impérieuse dans la perspective
de l'avènement de l'espace européen sans frontières.
Le principal argument à l'appui de cette urgence était
que, la pression migratoire se renforçant (quoique de façon
inégale) pour tous les États membres, les politiques nationales
n'étaient plus adaptées pour y répondre. Il fallait
donc trouver une réponse commune à ce problème,
« pour éviter que la politique d'un État membre
n'ait des incidences négatives sur celle des autres »
(groupe ad hoc immigration, SN 4038/91 WGI 930).
Soucieux de définir une politique harmonisée — sinon
commune — en matière de gestion des flux migratoires,
les États de l'Union européenne ont, dans un premier temps,
délibérément écarté la question de
l'immigration du champ communautaire. Jusqu'au Conseil européen
d'Amsterdam, en juin 1997, elle relevait en effet exclusivement de la
coopération gouvernementale, échappant ainsi aux règles
institutionnelles de l'Union (vote à la majorité, contrôle
de la Cour de justice des communautés notamment) qui caractérisent
le traitement des questions économiques, monétaires et
sociales.
Si une ébauche de « communautarisation »
de la politique d'immigration est apparue avec le
traité d'Amsterdam, celle-ci reste très timide. Car
une telle transformation supposerait de renoncer à l'un des aspects
les plus sensibles de la souveraineté nationale, celui qui touche
aux questions de frontières et de police. Peu nombreux parmi
les Quinze sont ceux qui sont prêts à franchir ce pas.
À ce souci s'ajoute la défiance mutuelle qui caractérise
souvent leurs rapports : la « guerre de la drogue »
franco-néerlandaise, la méfiance à l'égard
de l'Italie et de la Grèce (considérées comme peu
fiables en matière de surveillance des frontières), les
accusations de complaisance du Royaume-Uni à l'égard de
certains groupes islamistes constituent autant d'entraves à la
« communautarisation » des questions d'immigration.
La méthode de la coopération intergouvernementale permet
de contourner le premier obstacle, car les décisions prises échappent
à tout contrôle des instances communautaires. S'il est
prévu que la Commission européenne est « pleinement
associée » aux travaux, elle est de fait privée
de toute compétence dans leur processus d'élaboration.
Le rôle du Parlement européen est tout aussi symbolique :
ses positions sont censées être « dûment
prises en considération » sans plus. Si elles sont
trop critiques, elles suscitent au pis l'indifférence, au mieux
l'agacement des Etats concernés (tel celui manifesté par
le gouvernement français, en réponse à l'avis très
sévère porté, début 1997, sur le projet
de loi Debré). Si l'on ajoute que, à de rares exceptions
près (les Pays-Bas et, dans une moindre mesure, l'Allemagne),
les États membres n'ont pas mis en place une procédure
d'examen préalable de leurs travaux par les parlements nationaux,
on prend la mesure du contexte dans lequel se construit la politique
d'immigration de l'Union européenne : en dehors de tout
contrôle démocratique (communautaire ou national), les
gouvernements — ou, le plus souvent, des hauts fonctionnaires
spécialisés dans les questions policières [Bigo,
1996b] — définissent entre eux les grandes lignes
de la gestion des questions migratoires.
La forme que prennent ces décisions est particulièrement
ambiguë : des « actions » et des « positions »
communes, des « résolutions », des « recommandations »
et des « conclusions » ont ainsi été
adoptées depuis 1992 dans les domaines de l'immigration et de
l'asile, sans qu'une définition juridique claire ne permette
d'en saisir la portée. À l'instar des actes communautaires,
ces textes définissent leur propre champ d'application, font
parfois référence à des objectifs communautaires,
prévoient des délais de transposition en droit interne
et semblent revêtir un caractère contraignant. Pour autant,
les principes qu'ils établissent ne lient pas formellement les
États, et les particuliers ne peuvent s'en prévaloir lors
d'actions éventuelles, ce qui fait estimer au Parlement européen
que « l'approche de l'harmonisation, via une pseudo-législation
qui se présente sous la forme de résolutions et de documents
analogues, laisse à désirer..
On ne s'étonnera pas de constater que l'asile et le regroupement
familial, qui correspondent, dans un contexte de fermeture des frontières,
aux seules sources légales d'immigration, ont constitué
les premiers chantiers d'harmonisation mis en oeuvre. La question de
l'asile a donné lieu depuis 1992 à trois résolutions,
une conclusion et une position commune, essentiellement orientées
vers la recherche d'outils susceptibles de permettre aux États
membres de refuser l'examen des demandes présentées par
des étrangers qui se prévaudraient « à
tort » de la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés.
La résolution sur l'harmonisation des politiques nationales
en matière de regroupement familial (juin 1993) définit,
quant à elle, des conditions très strictes pour l'admission
des familles de ressortissants d'états tiers légalement
installés dans un État membre. Adoptée un an après
la diffusion d'un rapport de la Commission des communautés préconisant,
au contraire, l'assouplissement des règles généralement
en vigueur dans les États membres, cette résolution est
caractéristique des dangers que représente la méthode
de l'intergouvernemental : sur une question qui met en jeu le respect
de droits fondamentaux consacrés par des conventions internationales
(Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Convention internationale des droits de l'enfant), elle pose, comme
on l'a vu, en dehors de tout contrôle supranational, des principes
qui tendent de fait à restreindre considérablement les
possibilités de réunification des familles.
La résolution sur le regroupement familial révèle
en outre le caractère auto référent des actes intergouvernementaux.
Il est notoire que la France a joué, au sein du Conseil des ministres
européens, un rôle prépondérant dans son
adoption; deux mois après celle-ci, en août 1993, le Parlement
français modifiait sa législation sur le regroupement
familial (loi du 24 août 1993, dite « loi Pasqua »),
en y introduisant des principes directement inspirés de la résolution
européenne.
Si elle n'a pas encore eu un impact aussi immédiat sur les
réglementations internes, la résolution « concernant
la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants
de pays tiers » (juin 1994) illustre de façon éclairante
un autre aspect de la politique européenne de l'immigration.
Cette résolution, rappelant le contexte de sous-emploi qui conduit
les États de l'Union européenne à renoncer à
une politique d'« immigration active », prétend
organiser la mise en oeuvre d'une « préférence
communautaire à l'emploi ». Elle préconise donc
le maintien ou le renforcement de mesures de restriction à l'admission
de travailleurs étrangers. On pourrait s'interroger sur la nécessité
d'entériner, par un acte intergouvernemental, des pratiques déjà
établies dans les États membres si, après l'exposé
de cet objectif, la résolution n'abordait la question des exceptions
au principe. On comprend alors que l'un des buts, sinon le principal,
de la résolution sur l'emploi est d'encadrer les inévitables
entorses à la règle de la préférence communautaire
que les États commettent. Car la préférence à
l'emploi national (ou, traité de Rome oblige, à l'emploi
communautaire) n'a jamais empêché, même en période
de crise, qu'il soit fait appel à l'immigration. Parmi les cas
pouvant justifier l'embauche de migrants non communautaires, la résolution
prévoit celui où un employeur est confronté à
l'« indisponibilité à court terme d'une offre
de main-d'oeuvre sur le marché national ou communautaire du travail,
qui porte sérieusement préjudice au fonctionnement de
l'entreprise ou à l'employeur lui-même ». Suivent
les règles à respecter : la durée du recrutement
de ces migrants ne saurait excéder quatre ans, délai qui
ne pourra qu'exceptionnellement être prolongé « mais
uniquement si [...] ils répondent toujours aux critères
appliqués initialement lors de la décision relative à
leur admission à l'emploi » (en clair, si le poste
ne peut toujours pas être pourvu par un national ou un communautaire).
Il n'est pas anodin de relever que, dans nombre de réglementations
nationales des États membres, l'accès à une stabilisation
du droit au séjour est ouvert à partir de cinq ans de
résidence. En limitant à quatre années la durée
des recrutements des travailleurs étrangers, la résolution
organise à titre préventif les obstacles à leur
installation durable dans l'État d'accueil.
Pour façonner sa doctrine en matière d'immigration,
l'Union européenne ne s'est inspirée que des principes
les plus rétrogrades en vigueur dans certains des États
qui la composent, utilisant la méthode de l'alignement par le
bas. Sourde aux mises en garde régulières d'un Parlement
européen préoccupé par les menaces qui pèsent
sur le respect des droits de l'homme, indifférente aux conseils
de la Commission, qui plaide pour l'égalité de traitement
(en matière de circulation et d'accès à l'emploi)
entre les ressortissants des États membres et ceux des pays tiers
qui résident sur le territoire de l'Union, la coopération
intergouvernementale a privilégié jusqu'à présent
une gestion essentiellement policière et utilitaire des flux
migratoires. En reproduisant la classique association immigration-insécurité-crise
économique, dont l'« efficacité »
est loin d'être démontrée au vu des problèmes
insolubles qu'elle continue à poser autour de la question des
frontières, cette doctrine s'est surtout traduite par une approche
idéologique de la gestion des mouvements de population.
On ne saurait nier l'influence prépondérante exercée,
au sein des Quinze, par les plus déterminés, telle la
France, à voir leurs principes érigés en modèle.
Soucieux de n'être pas désignés dans ce domaine
comme les mauvais élèves de l'Europe, les pays du Sud,
qui ont besoin du soutien logistique de leurs partenaires pour faire
face aux situations exceptionnelles qui peuvent menacer leurs frontières,
essentiellement maritimes, se soumettent d'ailleurs volontiers à
ces pressions.
Mais, au-delà de cette influence, il apparaît aujourd'hui
que, avec les instruments mis en place, la politique européenne
de l'immigration fonctionne de façon de plus en plus autonome:
résultat paradoxal de la mise à l'écart des institutions
communautaires. Échappant au contrôle de celles-ci, il
n'est pas certain qu'elle s'inscrive toujours dans la logique des États.
En témoigne sa remarquable continuité, indépendamment
de la couleur politique de leurs gouvernants qui, au gré des
alternances électorales, encouragent cette fuite en avant.
Loin d'unir leurs forces pour s'adapter aux conséquences des
profondes mutations économiques — l'immigration n'en
étant qu'une des composantes — qui bouleversent déjà
la planète, les États membres, dérisoires capitaines
d'un bateau devenu ivre, figent l'Union européenne dans la conception
dépassée d'un espace à défendre dont les
étrangers non communautaires sont les hôtes indésirables.
BIGO D.
MARIE C.-V. (1994), L'Union européenne
face aux détournements de population : raison d'états
et droits des personnes, onzième séminaire sur la
migration de l'Organisation internationale pour les migrations, Genève.
WIHTOL DE WENDEN C. (1995), « Les politiques
d'immigration européenne », Les Cahiers de la sécurité
intérieure, n° 19, p. 24-34.

Dernière mise à jour :
26-08-2004 18:30
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/presse/1997/rodier/europe.html
|



 En ligne
En ligne


 En ligne
En ligne
