|
|
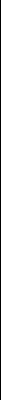
|
Plein Droit n° 58,
décembre 2003
« Des camps pour étrangers » Des camps en France
(1944-1963)
Marc Bernardot
Maître de conférences à l’Université
de Lille I, CNRS Clersé
Longtemps méconnue, l’histoire des camps
français, notamment ceux de la période vichyste, a fait
l’objet ces dernières années d’une importante
production scientifique. Cependant, des camps ont continué à
fonctionner en France après la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Certes, ils doivent être compris dans une logique d’exception
à la logique démocratique et non d’exclusion comme
ceux de la Collaboration. L’étude de ces formes moins connues
de mise à l’écart permet néanmoins de mieux
comprendre le phénomène de réapparition actuelle
des « camps ».
Plusieurs historiens ont montré les fréquentes
utilisations du camp en France durant la première moitié
du XXe siècle pour mettre à l’écart des « indésirables »
ou des « bouches inutiles ». Un camp est un regroupement
imposé et arbitraire de civils en dehors du système pénitentiaire
pour une durée indéterminée, visant à les
enfermer, les rééduquer ou les faire travailler ;
il est pratiqué sur un site ad hoc ou existant, le plus souvent
en dehors des villes, à des fins militaires, policières,
économiques et sociales.
A l’état de projet, à partir des années 1850,
la formule du camp moderne se développe vraiment durant la Première
Guerre mondiale pour retenir des civils étrangers et des Alsaciens-Lorrains.
Dans le même temps se mettent en place des casernements séparés
de « coloniaux » employés au front ou à
l’arrière dans l’effort de guerre. La généralisation
du camp (d’internement, de réfugiés, de travail)
en France se fait durant l’entre-deux-guerres, pour des populations
de toutes nationalités perçues comme une menace et qui
ne doivent pas se disperser dans le territoire. Très largement
constitué par la IIIe République, un réseau de
camps, d’Espagnols et de juifs principalement, va servir, en se
développant, la politique d’exclusion du régime de
Vichy.
Après la guerre, les camps ne disparaissent pas. Entre les centres
de séjour surveillé (CSS) de 1944 et les centres d’assignation
à résidence surveillée (CARS) de 1957, gérés
par le ministère de l’intérieur, le modèle
de l’internement politique semble même arriver à son
apogée. S’il a semblé disparaître pendant un
temps, cet espace singulier n’appartient pas au passé. Des
modes de gestion et de regroupement forcés de populations, notamment
étrangères, les zones d’attente et les centres de
rétention, d’accueil ou d’hébergement, existent
en France et en Europe. Le camp, d’accueil ou de rétention,
semble être ainsi redevenu une solution routinière de traitement
de situations d’urgence ou présentées comme telles.
Cette persistance conduit à s’interroger sur la généalogie
des techniques de l’internement.
Historiquement, les camps ne sont pas des lieux prévus à
cet effet ; ils sont envisagés comme des lieux provisoires
qui ne justifient pas la construction de bâtiments spécifiques
autres que des baraquements temporaires. Les sites les plus souvent
utilisés sont les casernes, les châteaux, les terrains
industriels laissés en friche ou encore les bâtiments ayant
des fonctions d’accueil collectif (hôtels, établissements
éducatifs et sanitaires).
Répression politique et gestion coloniale
Au-delà de la précarité des espaces de rétention
et du dénuement que cela entretient pour les populations internées,
c’est la permanence de leur emploi dans le temps qui apparaît
le plus marquant à propos de ces camps français. Certains
sites sont emblématiques de cette utilisation constante de certains
lieux. L’exemple de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
permet, par exemple, de suivre en raccourci cette continuité
entre les années trente et nos jours. Mais, malgré tout,
la « piste » des camps n’est pas facile à
suivre. Les dénominations des espaces de rétention euphémisent
plus ou moins leur fonction principale rendant plus complexe leur identification.
Les sites utilisés comme camps peuvent connaître des utilisations
changeantes en fonction des besoins. Et, lorsqu’ils sont détruits,
ils ne laissent pas plus de traces qu’un bidonville rasé
malgré quelques plaques commémoratives qui existent ici
ou là.
Un tableau succinct des modes d’internement et de placement en
camps en France de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux
années 1960 montre une double fonction, à la fois de répression
politique et de gestion coloniale. Il ne porte pourtant que sur la « métropole »
et non sur les déplacements et localisations forcés dans
les territoires coloniaux qui, par leur ampleur et les multiples formes
qu’ils prennent, dépassent le cadre de cet article.
Il existe une tradition de centres explicitement disciplinaires en
France installés pour l’essentiel dans des forteresses militaires.
Ils sont relativement rares jusqu’en 1939. Ils se développent
durant la Seconde Guerre mondiale et se généralisent entre
1944 et 1963 sous la forme de centres de séjour surveillé.
Les CSS fonctionnent en métropole sous le contrôle du ministère
de l’intérieur entre 1944 pour les premiers et 1946 pour
les derniers[1]. Plus de 170 centres
de séjour surveillé accueillent jusqu’à 50 000
personnes simultanément. Il s’agit d’individus suspectés
de collaboration avec l’ennemi et non des victimes innocentes comme
dans les camps de Vichy.
La réalité est en fait plus complexe : ces centres
accueillent des populations très hétérogènes,
parmi lesquelles on compte un fort contingent d’étrangers,
considérés comme des « civils ennemis ».
Par leur diversité de statut, de motif et de durée d’internement,
ces populations constituent une mosaïque modifiée au gré
des libérations et des internements (collaborateurs, miliciens,
délinquants économiques, civils allemands et étrangers
« indésirables », nomades). Il s’agit
d’interner rapidement, et sans le concours d’un juge, des
individus estimés dangereux pour la défense nationale
ou la sécurité publique. Les internés administratifs
sont dirigés vers des centres spécialisés, dont
la plupart ont déjà servi de camp dans les années
précédentes.
Compte tenu des difficultés de la vie quotidienne et de la désorganisation
des premiers temps de la Libération, les responsables doivent
composer avec les pénuries de matériel et de nourriture,
réclamer des moyens à diverses administrations et négocier
des prêts de fournitures. Le personnel vacataire des camps est
indiscipliné et difficile à recruter. Les conditions de
rétention sont très rudes, notamment dans les premiers
mois avant que l’organisation se mette en place. De plus, les « indésirables »
deviennent rapidement, du fait de leur internement, des « bouches
inutiles ». Le camp se transforme peu à peu en asile
dont les occupants doivent être secourus par des organisations
caritatives. Les internés sont employés dans divers travaux,
extraction, construction, coupes de bois, etc.
Le camp semble alors appartenir à une forme extrême du
modèle d’hygiénisme coercitif évoqué
plus tard à propos du logement en foyer des travailleurs migrants[2].
A partir de juillet 1945, le nombre de détenus va être
progressivement réduit. En 1946, un seul camp d’internement
est censé exister par région où seuls quelques
ressortissants étrangers restent internés.
Les paradoxes d’une « colonie algérienne »
Mis en sommeil durant quelques années en France métropolitaine
avec la fermeture de la plupart des centres de séjour surveillé,
l’internement administratif collectif va retrouver une application
de grande ampleur avec la guerre d’indépendance en Algérie.
La politique de lutte contre la rébellion algérienne en
métropole est véritablement mise en place à partir
de 1957 lorsque les services de police se plaignent du décalage
entre les moyens de répression dont ils peuvent user et ceux
dont disposent les autorités en Algérie.
En effet, la politique dite des « pouvoirs spéciaux »
de 1956 n’est effective que dans les départements algériens,
dans lesquels plusieurs camps de répression sont déjà
en fonctionnement. Le ministère de l’intérieur obtient
finalement, avec la loi du 26 juillet 1957 puis l’ordonnance du
8 octobre 1958 la possibilité de recourir à l’internement
administratif[3]. Plusieurs centres
d’assignation à résidence surveillée sont
créés pour des Algériens suspectés d’être
membres du FLN. Leurs modalités de fonctionnement présentent
de nombreux points communs avec les centres de l’Épuration.
Mais certaines caractéristiques diffèrent profondément,
notamment l’aspect de guerre politique et psychologique menée
dans le camp.
Les camps sont installés par le ministère de l’intérieur
dans des sites militaires à Larzac (Aveyron), Vadenay (Marne),
Thol (Ain), Saint-Maurice l’Ardoise (Gard) et Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
qui forment un dispositif qui concernera près de 14 000
Algériens au total. Des prisons centrales (Tulle, Lyon, Marseille,
Remiremont, Annecy, Rion) et un centre d’identification (Vincennes)
complètent le système répressif qui se traduit
par plus de 44 000 arrestations. Contrairement aux périodes
précédentes, ces camps sont créés en petit
nombre et sont exclusivement installés dans des sites militaires.
Le plus important est le camp de Larzac dans l’Aveyron, à
la fois par sa taille (plus de 3 000 hectares, près de 4 000
assignés et plusieurs centaines de membres du personnel, garde
comprise) et par sa place dans l’organisation centrale de l’internement
au plan national.
Si cette organisation apparaît plus opérationnelle qu’auparavant,
les problématiques logistiques auxquelles sont confrontées
les autorités gestionnaires des camps sont les mêmes que
pour les CSS. Les moyens financiers et de fonctionnement sont insuffisants
et, comme ses prédécesseurs gestionnaires de camp, le
directeur de celui du Larzac ne cesse de se plaindre des difficultés
de recrutement et du manque de compétence du personnel.
Les fortes rivalités entre services de police, CRS et armée,
compliquent la gestion. Les contraintes pour faire vivre des milliers
de militants politiques dans un espace réduit et peu adapté
sont considérables. Il est en effet indispensable de veiller
à l’alimentation et à la santé des assignés.
Une épidémie de grippe à Larzac durant l’hiver
1959-1960 touche plus de 600 internés mais aussi plus de
30 % du personnel. L’antenne sanitaire qui y est implantée
assure environ 40 000 consultations par an. Il faut surveiller
le camp et ses abords, et cela mobilise plusieurs compagnies de CRS.
Il est surtout indispensable d’éviter la reconstitution
trop rapide d’une organisation FLN au sein de la population du
camp.
Car, à l’instar des camps de miliciens espagnols des années
1939-1940, ces espaces d’assignation visent des militants politiques
en lutte ouverte contre l’administration. Les assignés refusent
de se plier à la discipline militaire et multiplient les actions
de contestation, les refus de soin, les grèves de la faim, les
revendications politiques et les plaintes contre les gardes, etc. Pour
faire face à cette mobilisation permanente et structurée
des assignés, les autorités mènent une guerre psychologique
et matérielle intense, fouilles systématiques, interrogatoires
poussés par les antennes des renseignements généraux,
« retournement » des internés, cloisonnements
stricts du camp entre différentes factions, transfèrements
d’assignés vers d’autres camps ou vers l’Algérie.
A la différence d’autres camps, ceux de la période
algérienne constituent une réponse politique et stratégique
à une guerre. Ils servent concrètement à mettre
hors d’état de nuire des « rebelles »
traités comme des criminels de droit commun.
L’instrument central de gestion du centre est le règlement
intérieur qui précise l’organisation et la discipline.
Il s’inspire largement du caractère militaire de ceux établis
pour les périodes précédentes. Une nouveauté
d’importance doit néanmoins être relevée. « Les
internés ne sont pas astreints au travail, ils doivent observer
les règles élémentaires d’hygiène et
de décence, nettoyer les locaux qu’ils occupent »,
précise le règlement intérieur. L’hygiénisme
reste présent dans le règlement mais le travail forcé
en disparaît. C’est un changement radical par rapport à
la tradition de l’assignation à résidence et de l’internement
administratif qui ont longtemps été liés avec l’idée
d’une réparation par le travail d’un prétendu
préjudice causé à la collectivité par les
« indésirables » ou les « bouches
inutiles ».
Autre particularité significative due à la force collective
que représentent les assignés, l’administration du
camp se voit contrainte, faute de moyens en personnel suffisant, de
« déléguer » une part considérable
de la gestion quotidienne du camp à l’organisation FLN des
centres. C’est le cas pour la « cantine »
et pour le courrier comme traditionnellement dans les camps de militants politiques.
Mais, et c’est plus surprenant, cette « orga »
parallèle se voit confier officieusement une part de la discipline
et de la justice internes assurées par un corps de près
de 200 « vigilants » issus des rangs des internés
chapeautés par un « tribunal suprême ».
Le camp devient ainsi un espace original dans lequel se développent
luttes, contestations et collaborations entre les internés et
les autorités du camp. Le directeur du camp de Larzac évoque,
en 1959, « un monstre à petite tête et à
grand corps, un diplodocus lourd à conduire »
et, en 1961, peu avant la libération des internés, il
considère qu’en voulant « éliminer
des individus suspects, on a institué un séminaire FLN,
une colonie de l’Algérie libre ».
A partir de 1961, des militants OAS prennent la place des militants
FLN dans ces mêmes camps et cela jusqu’en 1963. La discipline
est légèrement adoucie. Enfin, ces camps perdront leur
caractère strictement disciplinaire pour accueillir des « réfugiés »
en particulier des Harkis. Une partie du personnel de gestion sociale
des CARS sera par ailleurs embauchée par des opérateurs
de logement social spécialisés dans l’accueil des
migrants.
Camps de transit humanitaire
Dès l’été 1945, les pouvoirs publics utilisent
des formes de camps de transit pour gérer certains mouvements
de populations. Il ne s’agit plus seulement de faire face, dans
l’urgence, à un problème d’ordre public mais
bien aussi d’un moyen efficace et reconnu de planifier et d’organiser
le contrôle des flux de populations « à risque ».
C’est le cas avec le rapatriement des réfugiés civils
nord-africains depuis la métropole, « sujets sensibles »
après les révoltes du mois de mai en Algérie.
Le camp de transit dit du Grand Arénas, dans le quartier de
Mazargues à Marseille[4], en
activité depuis les années 1930, est très représentatif
des camps de cette époque. Il est affecté dans les années
1950 à l’accueil de déportés « apatrides »
qui veulent gagner Israël puis de juifs d’Afrique du Nord
quittant le Maroc et la Tunisie pour se rendre aussi en Israël.
Si le camp est officiellement placé sous la responsabilité
du commissaire principal du secteur portuaire, les réfugiés
sont concrètement « accueillis par l’Agence juive
en attendant leur départ pour Israël ».
Le Gouvernement provisoire hérite aussi de camps bien « encombrants ».
Certains des camps de travail qui accueillent, depuis 1939, environ
20 000 Vietnamiens et Chinois, travailleurs « requis »
pour des travaux en métropole, existent encore au moment de la
Libération. A Marseille (déjà à Mazargues
en 1939), Agde, Bergerac, Montauban, Oissel, Roanne, St Florentin dans
l’Yonne, Sorgue dans le Vaucluse, Toulouse et Vénissieux
sont placées dans des casernements fermés ces Compagnies
de la main-d’œuvre indochinoise ; les derniers fermeront près
de dix ans après leur ouverture comme par exemple dans la région
de Toulouse. Beaucoup de travailleurs ont été employés
par la Société des poudres (SNPE) à des travaux
harassants et dangereux. Leur gestion est si autonome, leur mise à
l’écart si implacable, la discipline si militaire, que ces
travailleurs « non spécialisés »
sont quelquefois oubliés sur place après la guerre sans
que les autorités du ministère du travail ne veuillent
prendre de décision pour leur rapatriement. Cette situation durera,
pour certains, jusqu’en 1948, le retour prenant une forme de « déportation
politique ».
Dans le même ordre d’idée, on peut évoquer
les camps de nomades ouverts en 1940 par la IIIe République,
et dans certains desquels restent encore des familles en décembre
1945 (Jargeau dans le Loiret notamment). En effet, ni la loi de 1912
ni les décrets de novembre 1939 et d’avril 1940 interdisant
la circulation des nomades ne sont abrogés après la guerre
(ce dernier le sera en mai 1946). Et, les préfets restant très
méfiants à leur encontre, des nomades continuent d’être
arrêtés. Ces différents centres ont en commun les
conditions de vie misérables et la dépendance presque
totale envers les autorités gestionnaires, qu’elles soient
publiques ou associatives, en raison de la coupure instaurée
avec le monde extérieur.
Progressivement, les centres d’accueil vont se structurer et perdre
en partie leur caractère répressif. Les centres d’accueil
des Français d’Indochine (CAFI) vont être créés
à partir de 1954 et annoncent les centres d’accueil des
rapatriés d’Algérie (CARA) pour les Harkis et leur
famille de 1962. Le cas de ces 42 500 Harkis est significatif.
Les lieux choisis pour installer ces familles algériennes et
françaises à la fois reflètent bien le sentiment
de malaise qu’elles provoquent. Le Larzac, vide des militants internés,
accueille plus de 12 000 d’entre eux dans des tentes.
D’autres anciens camps de Juifs et d’Espagnols, comme Rivesaltes,
Bias et Sainte-Livrade-sur-Lot, vont aussi servir de lieux d’accueil.
Les conditions de vie y sont très difficiles et la gestion est
désastreuse. Pourtant, la prise en charge de cette population
va peu à peu se structurer. Une partie des familles est transférée
dans des « cités familiales » gérées
par la Sonacotra dont certaines existent encore. D’autres sont
affectées dans des « hameaux forestiers »
et sont employées par l’ONF à des travaux de sylviculture
notamment. Les jeunes gens qui refusent ces conditions de vie sont malgré
tout envoyés dans des camps disciplinaires dont celui de Saint-Maurice
l’Ardoise.
Il faut également signaler les centres d’accueil de réfugiés
hongrois entre 1957 et 1958 qui sont accueillis dans des conditions
bien meilleures. Environ 9 000 personnes fuyant la Hongrie sont
hébergées dans une quinzaine de centres en France, au
Havre, à Montluçon, à Nancy ou encore à
Strasbourg. Des organisations comme la Croix-Rouge et la Cimade en assurent
la gestion alors qu’elles ne pouvaient intervenir que par des visites
et des actions ponctuelles dans les camps précédents.
Cette amélioration de la qualité de l’accueil ne
tient pas qu’à un processus de « civilisation ».
Les circonstances sont spécifiques parce que ces réfugiés
sont perçus comme des victimes « légitimes ».
L’émotion suscitée par l’invasion soviétique
et l’employabilité des jeunes hongrois facilitent leur intégration.
On peut constater, au cours du XXe siècle une certaine humanisation
des camps de réfugiés, jusqu’à l’institutionnalisation
des centres provisoires d’hébergement et des centres d’accueil
pour demandeurs d’asile (CADA). Ils marquent néanmoins une
distinction entre ceux qu’il faut insérer et ceux qu’il
faut éloigner. L’épisode de l’accueil, dans
le camp militaire de Fréjus, des Kurdes de l’East Sea[5],
mais aussi les solutions de logement d’urgence dans des CHRS et
les foyers de travailleurs migrants pour les réfugiés
Kosovars montrent que les circonstances exceptionnelles peuvent remettre
en cause cette institutionnalisation.
Une solution considérée comme légitime
On peut ensuite repérer une tendance au perfectionnement des
techniques et des techniciens de l’internement administratif, avant
une courte disparition dans les années 1960 et sa réapparition
discrète sous la forme « miniature » des
centres de rétention administrative (Arenc en 1975 et encore
quelques cas de militants politiques espagnols assignés à
résidence avant 1981). Mais cette solution globale est toujours
restée disponible dans les répertoires d’action du
ministère de l’intérieur. Des centres sécurisés
aux statuts variés sont d’ailleurs réapparus depuis
quelques années en France et plus généralement
dans l’Europe de Schengen ou à ses frontières. Les
pouvoirs publics semblent considérer à nouveau que le
camp, en l’occurrence de rétention ou d’éloignement,
offre une solution avantageuse même si encore « améliorable »,
et surtout légitime dans le cadre du durcissement de la politique
d’asile et d’immigration.
Dans la première moitié du XXe siècle, le modèle
français du camp, caractérisé par l’influence
coloniale, s’est institutionnalisé. Depuis lors, il a peu
à peu perdu ses spécificités, entraîné
dans un mouvement mondial de globalisation des techniques d’identification,
de sécurisation et de mise à l’écart. Ce changement
semble s’appliquer de deux manières. Quelques lieux de concentration
spécifiques et spectaculaires (le centre de Sangatte, par exemple)
médiatisent l’inhospitalité occidentale à
destination notamment des pays des candidats au voyage.
Pour les autres, les plus nombreux, ils se « miniaturisent »
et s’invisibilisent ou sont déplacés à la
périphérie des « forteresses continentales ».
Ce faisant, ils réduisent les contraintes et les coûts
de gestion des populations indésirables et minimisent les risques
de réaction des opinions publiques. Sur l’ensemble de la
période contemporaine, il apparaît alors qu’on puisse
parler de l’apparition d’un nouveau modèle de contrôle
social. Le « Grand éloignement » objective
une figure moderne de l’Etranger, celle du migrant du Sud, du réfugié
économique non désiré et du déviant.
Notes
[1] Cette politique est basée sur un arrêté
de mars 1944 largement inspiré des textes qui régissaient
préalablement l’internement administratif.
[2] Alain Jeantet, « Les
foyers en question », in Le logement des immigrés
en France, G. ABOU-SADA et J.-P. TRICART (dir.), Lille, Ominor, 1982,
pp. 179 à 204.
[3] Benjamin Stora, « La
politique des camps d’internements », in L’Algérie
des Français, prés. par C.-R. AGERON, Paris, Seuil,
1993, pp. 295 à 299.
[4] Emile Temime et Nathalie Deguine,
Le camp du Grand Arénas, Marseille, 1944-1966, Paris,
Autrement, 2001.
[5] Dans la nuit du 17 au 18 février
2001, un cargo transportant plus de 9 000 Kurdes fuyant leur
province s’est échoué à Saint-Raphaël
(Var). Les réfugiés ont été hébergés
dans une caserne désaffectée de Fréjus.

Dernière mise à jour :
15-01-2004 10:28
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/58/france.html
|



 En ligne
En ligne



 En ligne
En ligne

