|
|
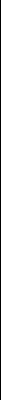
|
Plein Droit
n° 49, avril 2001
« Quelle Europe pour les
étrangers ? »
ÉDITO
Dans leur combat opiniâtre pour inciter l'Europe à construire
des barrières contre les arrivées inopinées de
réfugiés, les autorités françaises jouent
de malchance. Voici que, sans crier gare, des gens qui ne sont pas des
Américains ont débarqué le 17 février
dernier sur nos côtes de Provence. Un millier de Kurdes venus
d'Asie ? En général, ces exodus des temps
présents avaient la décence de s'arrêter sur les
côtes grecques ou italiennes, ce qui permettait de ne pas douter
de notre grande fermeté : pas de ça chez nous, il
faudrait bien voir que la France accorde une prime à l'asilobusiness !
Ainsi, après Noël 1997, quand les côtes italiennes
reçurent presque autant de Kurdes, Rome leur accorda des sauf-conduits,
ce qui lui valut — s'en souvient-on ? — de
vives remontrances des voisins, France en tête. Et, réunis
en urgence, les ministres des Affaires étrangères de l'UE
parlèrent de trouver des solutions européennes. On en
était resté là.
Seulement voilà : c'est au tour de la France d'être
prise au piège d'une pseudo-politique d'asile qui révèle
chaque jour davantage son absurdité, autant que son injustice,
aux termes de laquelle le seul bon réfugié est... le réfugié
qui reste chez lui. Une politique au jour le jour, encore plus rigide
que celle de nos voisins (rappelons-nous l'accueil d'Algériens
au compte-goutte en pleine période de guerre civile), que l'on
cherche à convaincre de la justesse de notre modèle :
halte au laxisme en matière d'asile, n'a-t-on cessé de
clamer en France jusqu'à l'épisode de Fréjus.
Dans la doctrine de nos gouvernements successifs depuis plus de vingt
ans, tout réfugié est a priori quelqu'un qui cherche
à abuser du droit international et de notre réputation
de « terre d'asile et des droits de l'homme » — un
cliché devenu encombrant pour un pays qui s'est fait une spécialité
de faire les gros yeux à ses voisins, jugés trop perméables
au « risque migratoire ». Car la chose est jugée,
même s'il se trouve parfois peu de dirigeants pour dire tout ce
qu'ils pensent vraiment. C'est à un ancien ministre de l'Intérieur,
Charles Pasqua, qu'est échu le devoir d'affirmer très
vite : « Nous sommes devant un problème qui
est celui de réfugiés économiques, il ne s'agit
pas de réfugiés politiques. Si nous les acceptons sur
notre territoire, nous ouvrons toute grande une brèche, donc
on ne peut pas les accepter », demandant donc, en toute
logique, « qu'on les rapatrie d'où ils viennent » [1].
Le parti socialiste a, sans attendre, emboîté le pas de
celui dont il fustigeait naguère la xénophobie, par le
biais d'une sentence à peine rosie de son premier secrétaire
François Hollande : ces réfugiés, il faut
les soigner et les accueillir avec humanité, « mais ne
pas donner l'illusion et l'espoir d'une intégration dans notre
pays » [2] — déclaration d'une étonnante
gratuité quand on sait que ces Kurdes n'avaient visiblement pas
la France pour destination !
Au fil des ans, l'argumentaire anti-réfugiés s'est affiné
et diversifié. Ce ne sont plus aujourd'hui seulement, aux yeux
de nos autorités, des immigrants économiques déguisés
en réfugiés politiques — une distinction au
demeurant inepte quand on veut l'appliquer à des minorités
persécutées. Ce sont aussi des « clandestins »,
des « malheureux », victimes de passeurs sans scrupule
et de trafiquants de main-d'œuvre : entériner leur
présence sur notre sol, ce serait donc « une formidable
incitation à tous les trafics », a également
dit M. Hollande, vite relayé par le Premier ministre, Lionel
Jospin, qui a sorti les grands mots en parlant de « ne
pas donner une prime aux entreprises criminelles de transport d'hommes
et de femmes » [3]. On gomme ainsi une réalité que
chaque tentative de forcer nos portes rend plus évidente :
l'« incitation » et la « prime »
en question, c'est notre impossible politique de fermeture des frontières
qui, en amont, les produit. À l'occasion des guerres en ex-Yougoslavie,
on a également mis au point l'argument « républicain »
universaliste : ainsi, accueillir en nombre les Albanais du Kosovo,
c'était se rendre complice des déportations perpétrées
par les Serbes [4]. Étrange casuistique, qui revient à
dire que la persécution ethnique n'existe pas parce qu'elle n'est
pas convenable, et à confondre reconnaître et accepter.
Au nom de tous ces beaux principes, le premier réflexe de nos
gouvernants est celui de la rigidité : aux demandeurs d'asile,
on commence par répondre « non ». Puis, si
les médias s'en emparent et si l'opinion s'émeut, on fait
prudemment marche arrière. Pour ne pas paraître se dédire,
on avance la solution du traitement des dossiers « au cas
par cas » : les vrais réfugiés resteront,
les autres partiront. Solution juridiquement irréprochable mais
totalement inadaptée lorsqu'on est confronté à
un débarquement collectif. Alors, futur maire socialiste de Paris,
Bertrand Delanoé a déclaré sans rire qu'il allait
falloir « prévoir le rapatriement de certaines de
ces personnes vers leur pays d'origine » [5] (en l'occurrence l'Irak, avec lequel la France n'entretient
plus de liaisons aériennes).
On connaît la suite : le fiasco de la fausse zone d'attente,
créée en toute hâte dans un camp militaire, la fronde
des juristes, l'impossibilité matérielle d'instruire préalablement
tous les dossiers un par un, tous les Kurdes relâchés dans
la nature avec un sauf-conduit, et — honte suprême —
nos voisins allemands rappelant la France à ses engagements communautaires
en lui renvoyant quelques fugitifs. Depuis lors, il est probable que
la majorité des réfugiés auront rejoint leur destination
projetée, et l'on est prié d'oublier vite l'incident.
Un pilotage à vue qui a dû rétrospectivement faire
sourire certains de nos partenaires, à l'heure où l'on
reparle de trouver des « solutions européennes » :
notre pays contraint à son tour d'invoquer le burden sharing
(expression consacrée qui désigne le demandeur d'asile
comme un fardeau qu'on doit se partager).
Mais la palme revient sans doute à l'ancien ministre de l'Intérieur,
Jean-Pierre Chevènement, qui a attendu la remise en liberté
des Kurdes de Fréjus pour sortir de son mutisme. Admettant qu'il
s'agit de personnes dignes de considération, à cause de
l'embargo subi par l'Irak, il a déclaré qu'il fallait
« donner des directives très fermes à la
marine nationale pour repérer de tels arrivages et les arraisonner » [6]
— on notera la délicatesse de la formule. Faute de
quoi, ajoutait-il, cela risque de se reproduire. En effet, mais alors ?
Que feront, au large, nos vaillants garde-côtes devant « de
tels arrivages » ? Inciter, par le seul fait de leur
menace, les capitaines à les jeter à la mer ? En
Méditerranée, l'hypothèse n'est hélas pas
absurde. Les reconduire, mais jusqu'où, et avec quelles garanties
d'intégrité et de vie sauve pour les voyageurs, une fois
sortis des eaux territoriales ? Quelle cynique incohérence
de la part d'un homme prêt à admettre la légitimité
de ces réfugiés !
Personne, dans les milieux politiques, ne paraît pressé
de tirer un bilan de l'épisode tragi-comique de l'East Sea,
si révélateur d'un incapacité générale
à penser la question de l'asile autrement que par une surenchère
de mesures inefficaces mais vexatoires, sinon contraires aux droits
de l'homme. La forteresse Europe va probablement multiplier miradors
et barbelés de toute nature face à ce qui est défini
comme un « risque ». Avec le peu de succès
que l'on prévoit : MM. Pasqua et Chevènement
ont raison, cela n'est pas fini.
Notes
[1] Libération,
19/2/2001, p. 5.
[2] Ibid.
[3] Libération,
20/2/2001, p. 3.
[4] Cf. le dossier « Quel
asile pour les Kosovars ? », Plein Droit, n° 44,
décembre 1999.
[5] Ibid.
[6] Le Monde, 24/2/2001.

Dernière mise à jour :
23-10-2001 16:10
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/49/edito.html
|



 En ligne
En ligne



 En ligne
En ligne

