Nous nous trouvons aujourd’hui face à une situation étrange, à tous égards paradoxale.
Premier paradoxe : jamais le GISTI n’avait, au cours de ses vingt années d’existence, bénéficié d’une telle notoriété médiatique ; or jamais non plus nous n’avons éprouvé à ce point un sentiment d’impuissance face à un gouvernement et une majorité parlementaire bien décidés à mener une politique régressive et répressive en matière d’immigration et d’asile.
L’action du GISTI a trouvé, c’est vrai, un écho inaccoutumé auprès des médias en sortant au mois de mai le projet Pasqua de sa clandestinité, puis à nouveau à l’automne en dénonçant publiquement, photos à l’appui, le scandale du dépôt de la préfecture de Paris. Mais si l’on s’interroge sur les retombées de cette médiatisation en termes d’efficacité concrète, force est de constater que le bilan est maigre, pour ne pas dire nul. Ce n’est pas avec deux minutes d’antenne par-ci, trois minutes par là que nous pouvions espérer convaincre une opinion publique peu réceptive et mal informée — quand elle n’est pas victime d’une désinformation systématique — du caractère inéquitable, dangereux, et moralement inacceptable de nombreuses dispositions des textes en préparation.Tout au plus notre présence sur les ondes aura-t-elle réussi à atténuer l’impression de consensus autour de la loi Pasqua.
Second paradoxe : plus il y a de raisons de se battre, moins il y a de gens prêts à le faire. La combativité n’est plus de mise, en ces temps de morosité et de déprime. C’est ce constat qui a amené le Gisti à se retirer de la Commission consultative des droits de l’homme où il siégeait depuis 1988. L’arrivée de la droite au pouvoir n’aurait pas suffi à nous faire prendre cette décision : il y a longtemps que nous n’attendions plus rien d’un gouvernement prétendûment de gauche sur le plan de la protection des droits des étrangers, longtemps par conséquent que nous nous interrogions sur le sens de notre présence au sein de la Commission, et plus généralement sur le rôle même de celle-ci dès lors que ses mises en garde étaient ignorées par les pouvoirs publics. Ce qui nous a convaincu qu’il n’était plus possible de rester, c’est le fait que la Commission consultative des droits de l’homme, au lieu d’adapter la vigueur de ses réactions à l’aggravation de la situation consécutive à la politique Pasqua, ne réagissait plus qu’avec une extrême mollesse, comme si elle craignait d’attaquer de front le nouveau pouvoir. Il était urgent, dans ces conditions, d’en partir sous peine de servir de caution à un gouvernement bien déterminé à marquer sa différence non seulement en matière d’immigration mais plus généralement dans tous les domaines touchant aux libertés.
Troisième paradoxe : plus la situation est désespérée pour tout le monde, plus nous sommes sollicités sur des cas particuliers. Et ce déséquilibre, signe de notre impuissance, nous amène à nous interroger non seulement sur l’utilité mais sur le sens même de nos interventions.
Là encore, l’arrivée de la droite au pouvoir n’a fait qu’accentuer et précipiter une évolution déjà bien entamée. Jadis installés au rez-de-chaussée, nous nous sommes réfugiés au troisième étage d’un immeuble ; nous nous barricadons dans nos locaux en éconduisant les visiteurs inopinés ; notre permanence juridique ne fonctionne plus désormais que sur rendez-vous — des rendez-vous qui s’obtiennent, ou plus souvent ne s’obtiennent pas, en composant un numéro de téléphone qui sonne désespérement occupé... Permanents submergés, usagers mécontents : le comble de l’inefficacité en termes de gestion. Et le comble de l’inefficacité en termes de résultats aussi.
Mais comment faire autrement ? Tant que l’administration acceptait d’examiner les cas que nous lui présentions, que nous obtenions de temps à autre une réponse favorable, nous pouvions garder l’illusion que toute cette énergie n’était pas dépensée en vain. Non sans quelque ambiguïté : car pour maximiser nos chances de succès, nous étions amenés par la force des choses à trier les dossiers en fonction de critères d’acceptabilité définis par les préfectures et les administrations centrales ; et nous leur permettions de se forger à bon compte une image d’ouverture puisqu’en acceptant de traiter en priorité les cas soumis par les associations elles reconnaissaient implicitement l’utilité et la valeur de notre travail.
L’évolution récente pourrait bien nous libérer de ces états d’âme. Car la question n’est plus de savoir si l’énergie dépensée l’est à bon escient et si nous ne servons pas d’alibi à une administration soucieuse de cultiver son image « humanitaire ». La question est plus brutalement de savoir si cela a encore un sens, à l’ère pasquaïenne, de continuer à gérer les problèmes juridiques des étrangers à travers une approche individualisée et au cas par cas, alors que le législateur a pris soin de verrouiller toutes les issues par lesquelles il était encore possible d’obtenir des régularisations, et que l’administration dit de son côté systématiquement « non » à toute demande présentée à titre « humanitaire ».
Face à l’offensive gouvernementale, il faut donc inventer d’autres réponses, recourir à d’autres formes de mobilisation.
Il faut d’abord convaincre les syndicats et les associations d’intégrer les droits des étrangers dans leurs préoccupations et leurs revendications ; c’est aux syndicats de défendre les droits des travailleurs étrangers, c’est aux associations familiales de se mobiliser pour défendre le droit des étrangers comme des Français de vivre en famille.
Il faut aussi favoriser l’auto-organisation des étrangers eux-mêmes sur des bases inter-communautaires : les conjoints de Français, les parents d’enfants français, confrontés à des difficultés insurmontables pour obtenir un titre de séjour, ont déjà commencé à se regrouper pour pouvoir mieux faire entendre leur voix auprès des administrations compétentes et demander aux associations familiales qu’elles reprennent leurs revendications à leur compte.
Il faut enfin, même si elle ne peut déboucher qu’à long terme, entamer une réflexion sans a priori sur la question des migrations, en refusant de considérer comme un dogme intouchable la problématique de la fermeture des frontières dont on a bien vu les méfaits depuis vingt ans, sans avoir véritablement profité de ses bienfaits, et qui de surcroît entrave toute pensée libre et novatrice en la matière.
L’absence de perspective à gauche, l’impression que la société implose, le repli sur soi provoqué par la peur du chômage : tout cela, bien sûr, ne rend pas la tâche aisée. Mais pouvons-nous baisser les bras sans donner raison à ceux dont nous combattons les idées et la politique ?

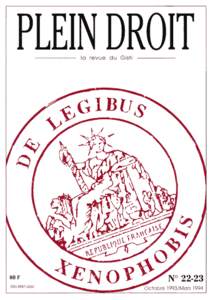
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?