|
|
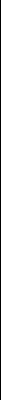
|
ARTICLES
La vie familiale bafouée
des étrangers
Trois ans après, la loi Chevènement
reste peu et mal appliquée
Article de Charlotte Rotman publié dans Libération
le 1er février 2002
La France reconnaît-elle enfin le droit des étrangers
à vivre en famille? C'était l'une des propositions phares
de la loi Chevènement, en 1998. Un ajustement législatif
prometteur affirmait alors le droit des étrangers d'avoir une
vie familiale et privée en France. Un autre prévoyait
l'octroi d'un titre de séjour après dix ans de présence.
Plus de trois ans après la promulgation de la loi, ces avancées
semblent avoir été égarées dans les méandres
administratifs, passées à la moulinette des habitudes
préfectorales. Le Gisti (Groupe d'information et de soutien des
immigrés) en dresse aujourd'hui un bilan amer, estimant que,
finalement, « la loi Chevènement a fait beaucoup
de bruit pour rien ».
Et pourtant, l'article 12 bis, alinéa 7 avait
été salué comme « une innovation
capitale » par la coordination française pour
le droit de vivre en famille. Il accordait une carte de séjour
à l'étranger « dont les liens personnels
et familiaux en France sont tels que les refus d'autoriser son séjour
porteraient à son droit au respect de sa vie privée et
familiale une atteinte disproportionnée ». Cet
article intégrait en fait dans le droit français les exigences
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Découragement. Aujourd'hui, faire valoir ce droit reste difficile.
De préfecture en préfecture, les exemples abondent. Monsieur B.
est marié à une résidente. On lui a refusé
le regroupement familial, la voie légale pour rejoindre un conjoint
ou parent, car sa femme gagnait 300 euros de moins que le Smic et ne
remplissait donc pas les conditions de ressources exigées. Il
y a cinq ans, ne supportant plus la séparation, il rentre sur
le territoire français avec un visa de court séjour,et
reste. Deux enfants naissent. La préfecture du Nord a pourtant
refusé une régularisation au titre de l'article 12
bis, 7. Un recours est en cours.
D. est un jeune Marocain entré en France en 1995, à l'âge
de 13 ans, pour rejoindre son père, qui y réside
depuis plus de trente ans avec sa soeur aînée. Il suit
une scolarité normale. En 1997, le regroupement familial lui
est refusé, ainsi que sa demande de titre de séjour. Le
préfet invite le jeune homme à quitter le territoire,
neuf mois avant ses 18 ans. Son affaire est pendante au tribunal
administratif.
Deux cas typiques. Car beaucoup d'étrangers qui sollicitent
une régularisation au titre de l'article 12 bis, 7
sont les mêmes qui, pendant longtemps, étaient en attente
d'un regroupement familial, procédure longue et délicate,
mais ont fini par se décourager et passer outre. Ce qui leur
est reproché ensuite. « L'administration masque
en fait sa mauvaise foi à reconnaître aux ressortissants
étrangers et à leurs familles le droit de mener une vie
privée et familiale normale derrière une accusation de
détournement de procédure », écrivent
ainsi les juristes Olinda Pinto et Haoua Lamine (1).
Soupçons. La coordination française pour le droit
de vivre en famille réclame donc la prise en compte d'une « présomption
de l'existence d'une vie familiale ». Dans les préfectures,
c'est plutôt l'inverse qui prévaut. « L'administration
regarde les dossiers avec suspicion. Elle se demande d'abord :
"Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui triche?" Leur
état d'esprit, c'est souvent de penser que les étrangers
se marient et font des enfants pour être régularisés »,
explique Daniel Richter, du Cefy, le comité Français-étrangers
des Yvelines.
En plus, une circulaire d'application (12 mai 1998) établissant
une liste de critères a verrouillé le dispositif en imposant
une interprétation restrictive. Ainsi, « sous l'apparence
trompeuse d'une délivrance de plein droit, l'administration conserve
intact son pouvoir discrétionnaire », estime Danièle
Lochak, professeur de droit à Paris-X. Pour Jean-Pierre Alaux,
permanent au Gisti, la circulaire revient à « reprendre
aux étrangers des droits qu'on a fait mine de leur reconnaître ».
Cette attitude soupçonneuse se retrouve dans l'application d'autres
dispositions, notamment celles de l'article 12 bis, 3. Sorte
de processus de régularisation permanente, cette mesure prévoit
de donner un titre de séjour aux étrangers présents
sur le territoire pendant dix années (quinze pour les étudiants).
Normalement, selon la circulaire d'application, les préfets sont
invités à ne « pas faire montre d'une trop
grande exigence » et à accepter tout document
susceptible de prouver cette présence. Dans les faits, les préfectures
retiennent souvent les critères de 1997, bien plus restrictifs.
Exit les témoignages privés. Seuls sont pris en compte
les documents administratifs. Et encore. Les collectifs de sans-papiers
collectionnent les refus pour manque de preuves. Comme pour ce Malien,
arrivé en 1988. Sa régularisation a été
refusée en 1999 par la préfecture de Seine-Saint-Denis,
pour « justificatifs non probants ». Son
dossier a été à nouveau présenté
en juillet 2001, avec deux preuves par an : ANPE, versements sur
compte bancaire, bulletins de paie, factures, photographies datées
et localisées. Nouveau refus en septembre. Pour la juriste Violaine
Lacroix : « L'article fait naître la sensation
étrange qu'il a été créé pour ne
pas servir. »
Autre exemple fréquent : celui d'un Malien, arrivé
en 1991, à qui on refuse un titre de séjour parce qu'en
1996 il est retourné deux mois au Mali pour se marier. « Peu
importe que les gens soient rentrés pour des vacances ou pour
voir la famille : la rupture de continuité du séjour
est considérée comme rédhibitoire »,
explique Daniel Richter, du Cefy.
Ping-pong. Enfin, l'administration peut jouer au ping-pong entre
les différents articles de loi. C'est toute l'histoire d'Aïcha.
Née en 1962 au Maroc, elle épouse en 1990 un Marocain,
résident en France depuis 1970. Elle le rejoint en 1991, a un
enfant avec lui. Aïcha vit dans l'ombre de son mari, elle a donc
peu de preuves personnelles de séjour à fournir. En 2001,
elle demande sa régularisation sur la base du 12 bis,
7 (liens familiaux). La préfecture de Seine-Saint-Denis refuse
d'accepter sa demande : celle-ci doit être faite au titre
du 12 bis, 3 (dix ans de présence). Aïcha
modifie sa demande. Sa régularisation est à nouveau refusée.
Motif : insuffisance de preuve pour les années 1992-1996.
(1) Plein droit, la revue du Gisti, n° 47-48, janvier 2001.
« Loi Chevènement :
beaucoup de bruit pour rien. »

Dernière mise à jour :
5-02-2002 11:03
.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/presse/2002/rotman/vie.html
|



 En ligne
En ligne


 En ligne
En ligne
